Encore une nuit sans sommeil. Aux petites heures du mardi 16 septembre 2008, c'est le remords qui tient éveillé Ben Bernanke, le président de la Fed. Le remords et la peur. La veille, le coeur du réacteur a fondu. À l'annonce de la faillite de Lehman Brothers, la quatrième banque de Wall Street, c'est toute la finance mondiale qui a disjoncté. Le crédit s'est asséché d'un coup. La crise systémique, cet accident décrit dans les manuels d'économie ? lui-même en a écrit plusieurs ?, est en train de se matérialiser. « Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait, que va-t-il se passer maintenant ? » se lamente Ben Bernanke.
Il savait bien, pourtant, qu'il ne fallait pas laisser couler un acteur central du système financier. Grand spécialiste de la crise de 1929, il avait plusieurs fois théorisé ce point. En novembre 2002, lors d'un colloque organisé pour les 90 ans de l'économiste néolibéral Milton Friedman, il avait même présenté, sur le mode de la plaisanterie, les excuses de la Fed pour les erreurs commises au début des années 1930. Milton Friedman avait écrit dans un célèbre article de 1963, cosigné avec Anna Schwartz, que laisser les banques s'e[ondrer avait alors puissamment contribué à aggraver la crise. « Sur la grande dépression, vous aviez raison, Milton et Anna. Nous sommes désolés de ce que nous avons fait. Mais, grâce à vous, nous ne le referons pas ! » avait chaleureusement déclaré Ben Bernanke. Et voilà, six ans plus tard, il l'avait fait.
Quand il s'était agi de sauver Bear Stearns, à la mi-mars, il n'avait pas tergiversé. Après avoir examiné de près l'importance de la banque sur le marché de la titrisation, la Fed avait organisé sa reprise par JP Morgan et avait racheté son portefeuille de crédits immobiliers. Durant l'été, il avait apporté son soutien à Henry Paulson, le secrétaire au Trésor, pour qu'il obtienne du Congrès le droit de soutenir sur des fonds publics Fannie Mae et Freddie Mac : ces deux agences fédérales de crédit à l'habitat étaient menacées de ruine par le retournement du marché immobilier et la crise des subprimes. En pleine campagne présidentielle, cet interventionnisme d'État mettait en fureur la base républicaine. Dans chacun de leurs discours, John McCain et sa colistière Sarah Palin dénonçaient les profiteurs de Wall Street, leur opposant les vertus frugales de Main Street, l'équivalent américain de « la France qui se lève tôt ».
Mais Ben Bernanke, en universitaire bon teint, était surtout blessé par les reproches de ses pairs. En avril, Paul Volcker, ancien président de la Fed sous Ronald Reagan, avait critiqué devant un parterre d'experts le renflouement de Bear Stearns : « Le métier de la Fed est d'agir comme gardien de l'argent de la nation, pas de charger son propre bilan de plusieurs milliards d'actifs incertains », avait-il asséné. Bernanke lui avait écrit pour se justifier : la Fed avait dû improviser face à une situation d'urgence, il ne s'agissait en aucun cas d'un changement de doctrine. En août encore, à la conférence annuelle de Jackson Hole, consacrée au Credit Crunch, le président de la Fed avait dû subir le démolissage en règle de son action par ses amis économistes. Seul un ancien banquier central japonais, Yutaka Yamaguchi, l'avait soutenu en rappelant les leçons de sa propre expérience : face à une crise bancaire, les baisses des taux d'intérêt ne suosent pas, il faut recapitaliser le système financier « très tôt et très fort », à coups d'argent public.
Que ne l'avait-il écouté ? Paulson et lui, le 14 septembre au soir, avaient choisi de ne pas secourir Lehman Brothers. Plus tard, il expliquerait que Lehman ne disposait pas de suo- samment d'actifs valables pour que la Fed puisse lui faire un prêt : « On a essayé, mais on n'avait ni mécanisme, ni options, ni règles de conduite, ni financement. » Il était formel : faute de repreneur, les régulateurs étaient désarmés. Selon un témoin de ces moments cruciaux, ils avaient surtout voulu faire un exemple pour rétablir le « moral hazard », en français l'aléa moral, ce risque de faillite censé empêcher les banquiers de se prendre pour des cascadeurs avec l'argent des autres. Au passage, ils avaient négligé une autre règle d'or des crises financières : certains sont simplement « too big to fail », trop gros pour faire faillite.
Au matin du 16 septembre, en arrivant à son bureau de Constitution Avenue, dans le quartier de Washington si bien nommé Foggy Bottom, « Fond du brouillard », Ben Bernanke découvre l'étendue des dégâts. À l'ouverture de la Bourse, l'action AIG n'est plus qu'à 1,25 dollar, contre 70 dollars un an avant. AIG, qui fut un temps la 18e plus grande capitalisation boursière du monde, est tout bonnement l'assureur de 74 millions de clients dans 130 pays. Et aussi, pour son malheur, le garant des crédits immobiliers transformés en obligations et revendus un peu partout sur la planète. Le numéro un mondial de l'assurance est la première victime du krach de Lehman. Les analystes, regardant de près son bilan, ont constaté qu'il valorisait ses actifs adossés à des prêts immobiliers risqués deux fois plus cher que ne le faisait la banque faillie. Or, via sa filiale londonienne, AIG Financial Products, il est devenu un géant de la titrisation. Les agences de notation, qui n'avaient rien trouvé à redire jusque- là, décident alors de dégrader la note d'AIG. Conséquence immédiate, la crise de liquidités : l'assureur ne peut plus emprunter sans mettre en face des garanties, soit plus de 10 milliards de dollars à trouver dans la journée. Au milieu du chaos qu'est devenu Wall Street, la Fed essaie désespérément de rassembler 75 milliards auprès d'investisseurs privés. Pratiquement au même moment, elle autorise la liquidation de Washington Mutual et la reprise de Wachovia par JP Morgan, et elle accorde à Morgan Stanley et à Goldman Sachs un changement de statut : devenues banques à part entière, elles pourront bénéficier d'aides publiques.
Et AIG ? Le patron historique de l'assureur, Maurice R. Greenberg, surnommé Hank (comme le secrétaire au Trésor Henry Paulson), se propose en sauveteur, lui qui a été éjecté trois ans plus tôt lors d'un scandale sur des pratiques frauduleuses. Sec refus de son successeur, Robert Willumstad. Quand, le 16 septembre au soir, Ben Bernanke et Henry Paulson annoncent que l'État octroie une ligne de crédit de 85 milliards de dollars à AIG, en échange de 79,9 % de son capital, Hank Greenberg n'a que ses yeux pour pleurer : l'assureur dont, en trente-cinq ans, il a fait un géant mondial, vient d'être nationalisé ; et les 2,7 milliards de dollars de parts qu'il possédait comme actionnaire principal d'AIG n'existent plus.
Le lendemain, Ben Bernanke convainc Henry Paulson de demander l'aide du Congrès. « On ne peut pas continuer comme ça. D'abord, parce que la Fed n'a pas les ressources nécessaires et, ensuite, pour des raisons de légitimité démocratique. Il est important que le Congrès prenne le contrôle de la situation. » Le 3 octobre, les élus adoptent le plan Paulson d'un montant de 700 milliards de dollars.
Et AIG ? L'assureur est devenu une épine infectée dans le pied des autorités : chaque mois ou presque, une nouvelle demande de fonds s'accompagne d'un nouveau scandale. Malgré la quasi-faillite, personne chez AIG ne songe à renoncer aux avantages de la prospérité. Séjour de rêve en Californie pour les cadres : 440.000 dollars (fin septembre) ; chasses en Angleterre pour la direction : 86.000 dollars (octobre) ; séminaire de luxe à Phoenix, en Arizona : 343.000 dollars (novembre). Au printemps, la presse révèle qu'AIG s'apprête à payer 165 millions de dollars de bonus à ses dirigeants et, en tout, 1,2 milliard à son personnel. L'indignation est à son comble. Après 150 milliards de dollars de subventions, AIG est devenue l'une des firmes les plus détestées aux États-Unis. n

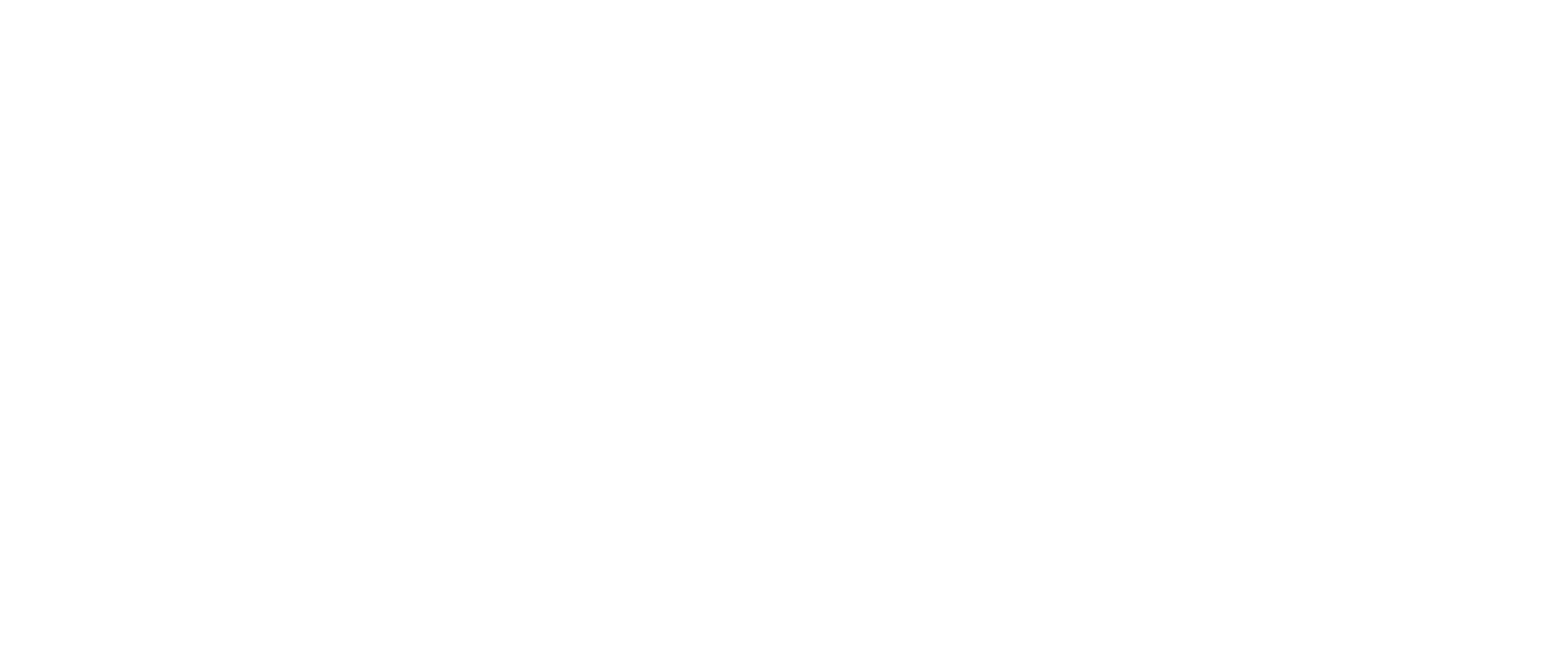


Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !