Un vieil homme à l'air perdu récite avec peine une tirade écrite à l'avance : « Notre économie, je crois, est toujours... enfin..., les fondamentaux de notre économie sont forts, mais ce sont des moments très, très di?ciles. » Ce matin du lundi 15 septembre, John McCain est en campagne à Jacksonville, en Floride. Le secteur financier américain vient de subir un infarctus avec la faillite de Lehman Brothers mais le sénateur républicain n'a pas changé de discours : les fondamentaux sont bons. Barack Obama, lui, se trouve en meeting à Grand Junction, au Colorado. Sans méchanceté, mais avec acuité, il épingle son rival. « Je crois tout simplement qu'il ne sait pas. Il ne voit pas ce qui passe entre la montagne de Sedona où il habite et les couloirs de Washington où il travaille. Sinon pourquoi dirait-il, justement un jour comme aujourd'hui, que les fondamentaux de l'économie sont toujours forts ? » Et d'une voix tout à coup puissante, il porte l'estocade : « Sénateur McCain, mais de quelle économie parlez-vous ? » À ce moment-là, très précisément, Barack Obama a gagné la course à la Maison-Blanche.
Jusque-là, la campagne républicaine avait réussi à attiser la peur de l'inconnu en affublant Barack Obama d'une série de défauts : jeune, inexpérimenté, socialiste, musulman et... noir. Le candidat démocrate s'était sorti avec brio d'une polémique provoquée par les propos anti-blancs de son pasteur, le révérend Wright, en prononçant un discours courageux sur la question des races en Amérique. Mais l'arrivée de Sarah Palin comme colistière de McCain avait redynamisé l'image des républicains et terni la nouveauté de celle d'Obama. L'avance dans les sondages dont il jouissait avant l'été 2008 avait fondu comme neige au soleil. L'opinion ne percevait pas la gravité de la crise financière qui s'approchait. Au contraire, les Américains avaient retrouvé le moral depuis que le prix du pétrole s'était mis à baisser, après un an de folle hausse.
Et puis soudain, début septembre, Freddie Mac et Fannie Mae, les deux célèbres sociétés parapubliques de prêts hypothécaires, avaient dû être secourues. Nationalisées, pour parler clair. John McCain avait applaudi l'intervention du Trésor. Pourtant le 15 septembre, après la chute de Lehman, il expliquait encore que « le temps était passé où les contribuables étaient considérés comme la solution à tous les problèmes », et promettait de réduire le fardeau que représentait l'État. La contradiction devenait patente. Et plus le ticket républicain s'engageait à « nettoyer Wall Street et Washington », plus il soulignait l'échec de leur propre camp, celui du président Bush. Grâce à la crise, l'heure de Barack Obama approchait. Il avait tant rêvé d'être le nouveau Roosevelt ! Transformer l'Amérique, la régénérer avec un sens retrouvé de la solidarité. Pourtant, lecteur de Marx, il savait bien que l'histoire ne se répète que sous forme de farce.
À quel moment le sénateur de l'Illinois at- il compris que sa présidence serait très différente de ce qu'il avait imaginé et préparé ? Sans doute le vendredi 26 septembre, le jour où il s'est rendu à la Maison-Blanche avec John McCain, à l'invitation de George Bush. Malgré l'impopularité du président sortant, les deux candidats ont accepté de soutenir avec lui le plan Paulson face à un Congrès réticent : ils montrent ainsi aux Américains à quel point la situation est grave et prennent avec éclat leurs responsabilités d'hommes d'État. Mais ils se lient les mains. Quatre mois avant son investiture, désormais probable, Barack Obama contresigne un chèque de 700 milliards de dollars. Ni pour la couverture maladie généralisée, ni pour l'amélioration de l'école, ni pour la croissance verte, ses trois chantiers prioritaires, mais pour secourir Wall Street. Sans aucune garantie de succès.
Lorsque Barack Obama est élu président, le 4 novembre 2008, une vague de bonheur submerge l'Amérique et le monde. L'un des plus heureux semble John McCain, le battu, qui prononce un véritable panégyrique de son excollègue du Sénat. Le premier président noir de l'histoire américaine savoure sa victoire, nul doute à cela, mais il sait que réussir son mandat sera infiniment compliqué. Le sauvetage de la finance a déjà commencé, brouillon, frénétique, inéquitable, à la fois coûteux et incontrôlé. Obama en a accepté le principe. Et pour quel résultat ? Après l'adoption du plan Paulson, le 3 octobre, les Bourses du monde entier sont retombées lourdement. Quinze jours de pure démence ont elacé entre le quart et la moitié de la capitalisation selon les places. Leurs innombrables acteurs ont réalisé, bien avant les politiques, que la crise avait muté. Les entreprises, dans un ensemble parfait, ont tout arrêté : les embauches, les investissements, les projets, la reconstitution des stocks. La récession est là, et aucune solution uniquement financière n'y changera rien.
La Constitution américaine instaure un délai de deux mois et demi entre l'élection d'un président et sa prise de fonctions. Sage précaution, en temps normal, pour permettre à un novice de se préparer à la magistrature suprême. Mais délai funeste quand toute l'économie subit un coup d'arrêt catastrophique. Tandis que les signes de la récession s'accumulent, Barack Obama doit choisir : attendre d'être au pouvoir tout en alûtant ses équipes et son plan de relance, ou négocier avec les républicains pour agir plus vite ? Peut-être parce qu'il a le sentiment de s'être fait piéger avec le plan Paulson, il opte pour la première solution, l'attente. Au président Bush d'assumer les grandes réunions internationales ? le G8 extraordinaire réclamé par Nicolas Sarkozy se transforme en un G20 réuni à Washington en novembre. À lui aussi d'éviter la faillite de l'industrie automobile américaine : en décembre, il étendra par décret le plan Paulson pour que les trois grands de Detroit puissent en bénéficier. Mais de plan de relance, point. Ce sera un trimestre perdu pour la plus grande économie du monde.
Une fois passées les solennités de l'Inauguration Day, le mandat d'Obama commence enfin. L'hiver glacial est une métaphore de la conjoncture, la pire qu'ait connue le pays depuis les années 1930. Le 10 février 2009, le nouveau secrétaire au Trésor, Timothy Geithner, présente un plan de stimulation économique de 900 milliards de dollars. Geithner n'est pas un homme neuf. Président de la Banque de réserve de New York, il a participé et au laxisme des années de bulle, et aux opérations de sauvetage de 2008 à Wall Street. Il vient certes du public et non du privé comme son prédécesseur Henry Paulson, ex-patron de Goldman Sachs, mais il est d'emblée soupçonné de complaisance envers les financiers cupides. Barack Obama a pris un risque en s'appuyant sur lui, et sa propre popularité en pâtit. Le scandale des bonus d'AIG éclate début mars. L'opinion outrée découvre que 165 millions de dollars de bonus vont être distribués par l'assureur, alors qu'il a englouti 180 milliards de dollars d'argent public en six mois. Tim Geithner semble tomber des nues, mais on apprend que ses services discutent le sujet avec AIG depuis des semaines. Il est si fragilisé que la question de sa démission est posée. À la télévision, Barack Obama prend sa défense sur un ton patelin : « S'il me proposait de démissionner, je lui répondrais, mon pote, tu gardes ton job. » Il n'empêche, une faille s'est ouverte entre le président et le Congrès : les représentants votent une loi pour taxer à 90 % les bonus des dirigeants de firmes qui ont reçu des aides d'État, lui prend ses distances et torpille le projet. Pour le bien de l'économie, il soutient la finance : « On ne va quand même pas se couper le nez pour punir notre visage ! » s'exclame-t-il.
La polémique ne sera pas sans conséquences. Quand Barack Obama, à l'approche de l'été 2009, aborde enfin le coeur de son programme, l'assurance-maladie pour tous, sa cote d'amour est déjà amoindrie. Le bourbier de la finance est devenu son bourbier à lui. Son conseiller budgétaire, Peter Orszag, en fait la rude expérience. Invité du « Daily Show », célèbre émission de satire politique, il s'entend poser la question redoutable entre toutes par l'animateur Jon Stewart : « Cela n'a rien à voir avec le budget, mais ça me taraude. Ces sauvetages en série, là. Mais pourquoi a-t-on sauvé les banques ? Pourquoi pas plutôt les emprunteurs ? » Réponse du conseiller d'Obama : « Le problème, c'est que si vous aidiez les gens qui ne payaient plus leurs traites, c'était un énorme encouragement à ne plus payer. » Large sourire de Stewart : « Alors que les banques, c'était dilérent ? » Pour l'animateur vedette, comme pour l'Américain moyen, la cause est entendue : dans la crise financière, Obama aussi est responsable.

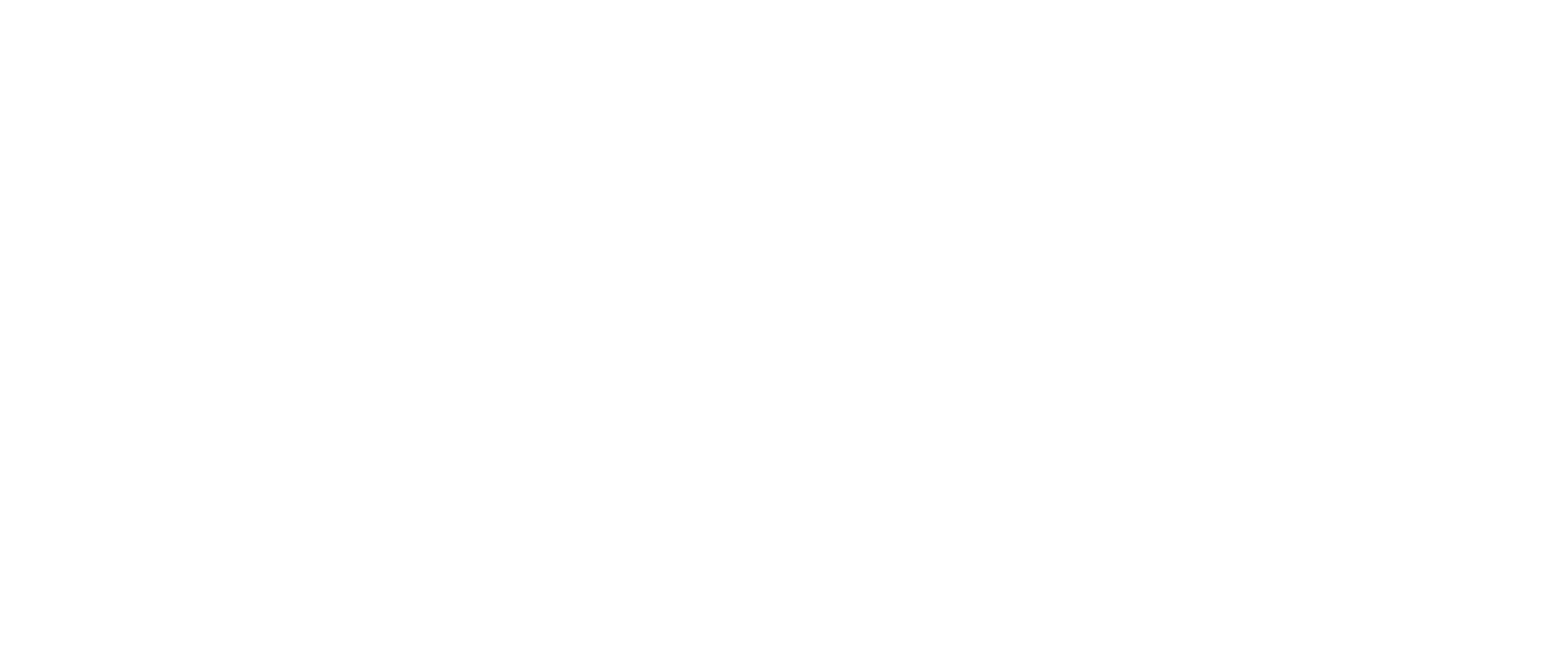


Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !