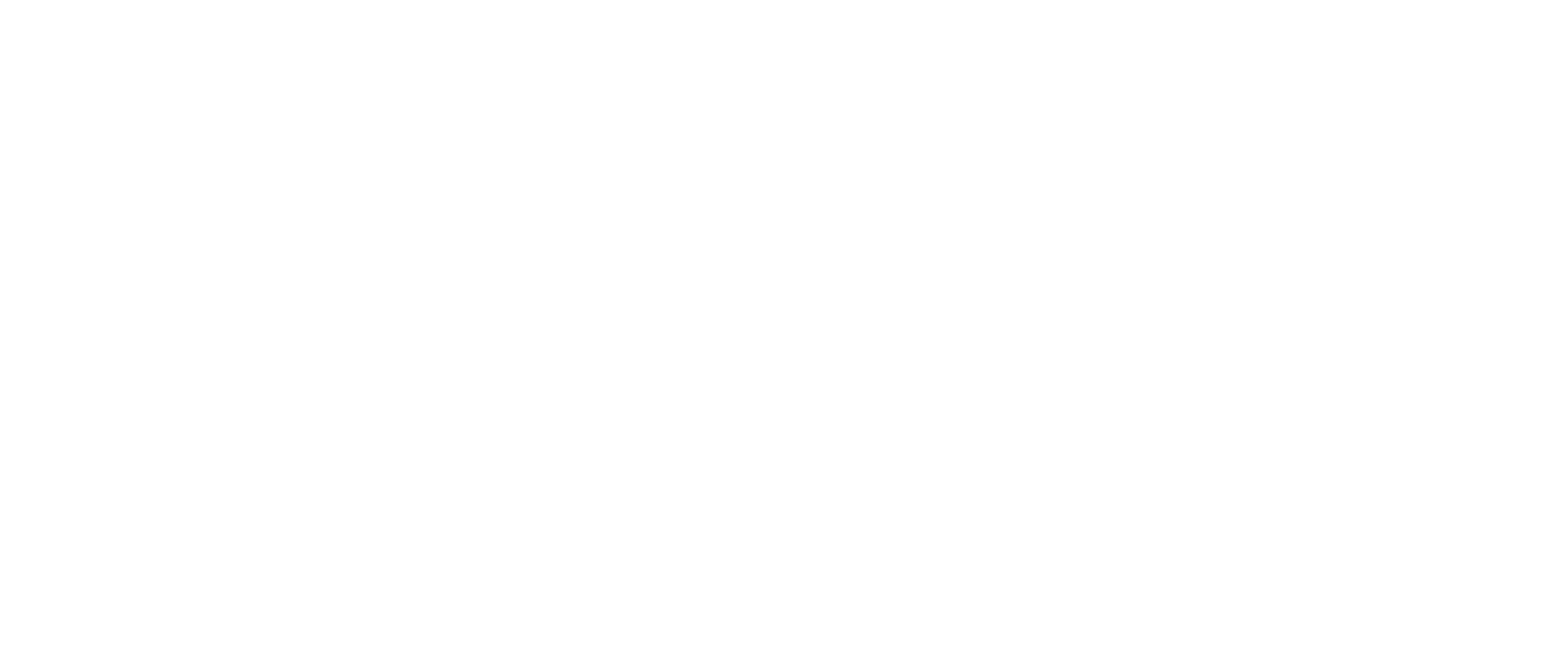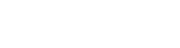1 - L'Europe des 27 existe-t-elle encore ? Le Conseil européen des 8 et 9 décembre a respecté à la lettre la dramaturgie des sommets historiques : nuit blanche, conférences de presse peu avant l'aube, échanges de regards vengeurs entre le président français et le Premier ministre britannique.Le monde en a retenu le divorce entre Londres et le reste de l'Union européenne. Ce fut effectivement un moment de vérité, « l'accomplissement d'une longue dérive des Britanniques qui, sur quinze ans, ont multiplié les ?opt-outs? », tranche une source diplomatique. Et d'ajouter : « À un moment, cela ne marche plus. »
Il n'y a pas que les Britanniques qui aient dérivé depuis le traité d'Amsterdam de 1997, qui vit la dernière tentative sérieuse de rafistoler l'union monétaire en musclant le Pacte de stabilité et de croissance. Sur le fond, comme dans la méthode, le Conseil du 9 décembre se lit comme une tentative de repartir sur de nouvelles bases, de réécrire le pacte noué vingt ans plus tôt jour pour jour lors du sommet européen de Maastricht. Effacés le traité de Lisbonne et ses tentatives d'avancées démocratiques. « Le fait que ce soit un accord intergouvernemental permet de contourner tout un tas de procédures, comme la réunion d'une convention » avec parlementaires et dirigeants nationaux et européens, confirme cette source. Pas de convention. On revient à l'ancienne méthode des conclaves entre chefs d'État et de gouvernement.
C'est à se demander si la France et l'Allemagne ne se sont pas servies de Londres comme d'un alibi pour se défaire du carcan du traité de Lisbonne. En parlant d'adopter une régulation financière spécifique à la zone euro, les deux puissances continentales ont fait perdre son sang-froid à David Cameron. Le Premier ministre britannique a décidé d'abandonner sa stratégie de défense du marché intérieur à Vingt-Sept, qui était pourtant une manière sûre de garder un oeil et de l'influence sur les réformes à venir de l'Eurozone, tout cela en faveur de demandes d'exemptions exorbitantes au bénéfice de la City qui risque de lui reprocher de s'être fait exclure du jeu.
C'est ainsi que paradoxalement, au nom de l'union politique et fiscale, on en revient à une approche plus intergouvernementale. Vingt ans après le Conseil européen de Maastricht, les chefs d'État et de gouvernement cherchent à remettre à plat l'union monétaire. C'est un pari risqué mais qui s'avère peut-être indispensable. Par Florence Autret
2 - La convergence budgétaire, consistant à harmoniser les préparations des budgets nationaux de façon à respecter le Pacte de stabilité - un niveau inférieur à 3 % du déficit public et 60 % de la dette rapportés au PIB -, est l'une des grandes avancées de l'accord. L'objectif est de renforcer le pouvoir d'intrusion de l'Union européenne dans les préparatifs des budgets, en contraignant les pays à revoir leur copie si les projets ne rentrent pas dans le cadre imparti. Pour éviter une révision des traités, longue et risquée, les présidents de l'UE, Herman Van Rompuy, et de la Commission, José Manuel Barroso, ont proposé vendredi de suivre une procédure plus rapide et plus souple. Celle-ci résiderait essentiellement dans le changement du protocole annexé au traité de Lisbonne, qui concerne les procédures de déficit excessif. Surtout, elle n'aurait besoin que d'un feu vert des dirigeants des 27 pays de l'UE. « Cela pourrait être réglé en deux ou trois mois » et donc permettre d'avoir un « résultat rapide » en couvrant la plus grande partie des mesures envisagées pour durcir la discipline budgétaire, argumente un responsable européen sous couvert de l'anonymat, cité par l'AFP. S'il reste encore à attendre de voir dans les prochaines semaines comment concrètement cette disposition sera appliquée, il n'en reste pas moins que l'intention contenue par l'accord des 26 pays (hors Grande-Bretagne) était attendue depuis longtemps par les marchés financiers. À ce titre, c'est une avancée. En effet, malgré l'annonce ces derniers mois par chacun des pays de la zone euro de plans d'austérité accentuée, les marchés financiers n'ont pas été jusqu'ici convaincus. Cet accord rend au moins plus crédible la volonté de la zone euro d'oeuvrer collectivement et de façon coordonnée à la résolution de la crise. Par Robert Jules
3 - Que deviennent les traités ? La crise de la zone euro aura démontré que les traités qui régissent l'Union européenne n'étaient pas adéquats pour répondre à certaines situations. S'ils ne sont pas caducs, ils ont besoin d'être modifiés. L'impossibilité d'imposer aux pays des mesures contraignantes telles qu'évoquées par Angela Merkel dans le cadre actuel du traité de Lisbonne, notamment sur le non-respect du Pacte de stabilité, a été un déclencheur. C'est du moins le constat fait par la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Nicolas Sarkozy qui ont poussé à en modifier certains aspects pour adapter les textes à la nouvelle situation. « Je pense qu'après de longues négociations, il s'agit d'un résultat d'une très grande importance car nous avons appris des erreurs du passé et qu'à l'avenir nous aurons des décisions qui nous engageront, plus d'influence de la Commission européenne, plus de communauté et avec cela, plus de cohérence », s'est réjouie vendredi la chancelière à l'issue du Conseil.
Selon les conclusions du sommet, les institutions actuelles de l'Union européenne pourront être utilisées dans ce nouveau traité, qui sera rédigé d'ici à mars mais ne devra pas obligatoirement faire l'objet d'un référendum dans les pays qui le signeront et sera intégré le plus rapidement possible au cadre communautaire. Les modalités juridiques précises doivent désormais être discutées mais, sur le fond, ce nouveau traité s'inspirera très largement de la lettre franco-allemande transmise cette semaine à Herman Van Rompuy, ainsi que des propositions de ce dernier. En attendant, la remise en cause des garanties en matière de souveraineté qu'offrent les traités européens actuels devrait donner lieu à débat dans les pays concernés. Même en France, Nicolas Sarkozy dans son discours de Toulon plaidait pour davantage de processus intergouvernementaux plutôt que pour un renforcement du contrôle de la Commission ou de la Cour européenne. R. Ju.
4 - Quelles conséquences pour la Grèce ? Une fois n'est pas coutume, la Grèce ne focalisait pas tous les regards lors du dernier Conseil européen. Si le pays doit rester une « exception » en ce qui concerne la participation des investisseurs privés au « hair cut » de sa dette, le projet de texte sur le renforcement de la discipline budgétaire laisse de toute façon peu de marge de manoeuvre à Athènes. Son seul problème est de pouvoir remplir les objectifs du plan de façon à pouvoir obtenir trimestriellement sa tranche d'aide, vitale pour faire fonctionner le pays. Si de facto les Grecs sont sous tutelle bruxelloise, comme le Portugal et l'Irlande qui bénéficient eux aussi d'une aide conjointe de l'Europe et du FMI même si c'est à un degré moindre, le nouveau texte peut leur assurer une solidarité européenne plus réelle de la part des autres membres de la zone découlant de la convergence budgétaire à venir en attendant la convergence politique. Car le scénario d'une sortie de l'euro reste pour Athènes une aventure terriblement coûteuse et risquée et aux conséquences à long terme difficiles à évaluer. R. JU.
5 - Où va la Grande-Bretagne ? L'histoire se répète au Royaume-Uni. Il y a exactement vingt ans, le gouvernement de Margaret Thatcher était profondément divisé sur l'Europe. Ce week-end, celui de David Cameron était ébranlé par sa décision de poser son veto au nouvel accord européen, seul pays des 27 à refuser de signer. La fissure oppose, d'un côté, ses partenaires libéraux-démocrates qui estiment qu'il s'agit d'une grave erreur stratégique, isolant le Royaume-Uni et, de l'autre, la majorité des députés conservateurs, qui crient victoire. Une anecdote résume le sentiment des tories. Arrivant vendredi soir à un dîner avec une vingtaine de députés conservateurs, David Cameron a été longuement applaudi. Pour eux, la politique du « splendide isolement » (« splendid isolation », nom de la politique étrangère britannique du XIXe siècle) est la bonne. « Le Premier ministre a pris une décision historique et nous sommes ravis », lance Andrew Rosindell, l'un des plus eurosceptiques de tous.
La City se frotte aussi les mains. C'est en son nom que David Cameron a posé son veto. En échange de sa signature, il exigeait l'insertion de deux protocoles : le premier pour garantir le marché commun ; le second pour défendre la place financière britannique, et bloquer une taxe sur les transactions financières. « Le Royaume-Uni a montré qu'il savait résister à l'érosion de son industrie financière », se félicite David Blair, du cabinet d'avocats d'aff Osborne Clarke.
Beaucoup rejettent cependant cette analyse. À commencer par les libéraux-démocrates, traditionnellement le seul parti proeuropéen britannique. Nick Clegg, le vice-Premier ministre, après avoir initialement soutenu David Cameron, semble avoir changé d'opinion, l'accusant d'avoir mal mené les négociations et d'isoler le pays. Vince Cable, autre ténor lib-dem, est surpris que ce soit la City qui soit à l'origine de la rupture, en ces temps de crise financière : « Il est faux de dire que les intérêts nationaux britanniques sont synonymes de banques et services financiers », lance-t-il. « Nous sommes les grands perdants de cette affaire, ajoute Charles Grant, directeur du think tank Centre for European Reform. Notre position avait toujours été de dire : nous devons être à la table européenne, pour influer sur les réformes. Désormais, nous risquons d'être tout seuls. » Même certains eurosceptiques rejoignent cette analyse : lord David Owen, ancien ministre des Affaires étrangères, s'énerve contre la frange très active des conservateurs europhobes : « Notre politique est-elle faite par 80 à 90 députés qui veulent sortir de l'Union européenne ? ». Par Eric Albet, à Londres
6 - Quelles sanctions ? Pour éviter toute dérive des budgets nationaux liée au non-respect du Pacte de stabilité, le Conseil européen a décidé du principe de sanctions automatiques - sous la forme d'amendes - si le déficit public dépasse le plafond de 3 % du PIB ou si le seuil de la dette souveraine franchit 60 % du PIB. C'est un point que défendait l'Allemagne et auquel s'est ralliée récemment la France. Dans ce cadre, et en attendant que les modalités de ces sanctions soient toutes fixées dans le marbre, le principe « d'automaticité » est acté, « à moins qu'une majorité qualifiée d'États membres de la zone euro ne s'y oppose » a suggéré la Commission (soit 85 % des voix, ce qui de facto donne le droit de veto à l'Allemagne et la France). Jusqu'alors, une majorité simple suffisait. Parmi les sanctions, il y aura l'obligation d'un dépôt de 0,2 % du PIB pour le pays qui sera visé par une procédure du déficit excessif, comme l'avait proposé la Commission en octobre. Cette automaticité des sanctions représente un transfert de souveraineté majeur, même si la philosophie de la mesure est la recherche de la vertu budgétaire. R. Ju.
7 - Quel rôle pour la BCE ? À ceux qui réclament que la Banque centrale européenne joue le rôle de prêteur en dernier ressort des États - ce que les traités lui interdisent - le président de l'institution, Mario Draghi, a opposé un refus catégorique. Il convient de rappeler que la BCE a opté pour un rôle de prêteur en dernier ressort des banques, à l'origine de 75 % du financement de l'économie de la zone euro. Et qu'elle ne ménage pas ses efforts pour que ce rouage essentiel soit aussi bien huilé que possible, avec l'extension pas plus tard que jeudi de ses opérations de refinancement à long terme, à taux fixes et en quantités illimitées, portées d'une durée maximale de treize mois à trente-six mois. Selon la Lloyds Bank britannique, cette extension, jointe à l'assouplissement des titres acceptés par la BCE en garantie de ses prêts - les collatéraux - pourrait contribuer à faire baisser les rendements à long terme en donnant aux banques les capacités de soutenir le marché des dettes souveraines. Des mesures qui, selon la banque, peuvent être assimilées à une forme d'assouplissement quantitatif, le QE anglo-saxon, mais sans création monétaire.
C'est sans aucun doute l'analyse qu'en font les responsables de la BCE qui, à l'issue du sommet européen, ont fait savoir que ses rachats d'obligations souveraines restaient plafonnés à 20 milliards d'euros par semaine, le chiffre officieux et révisable qui circulait depuis mi-novembre. Un chiffre que le lobby européen du QE sous-estime systématiquement. Car, depuis le lancement de son programme de rachat d'emprunts d'État des pays de la zone euro en détresse, elle a engrangé 207 milliards d'euros de titres de dette, dont les deux tiers ont été acquis depuis sa relance en août dernier. C'est dire qu'en moins de quatre mois, la BCE a acheté l'équivalent de la moitié de ce qu'avait accumulé la championne du QE qu'est la Réserve fédérale, lors de la deuxième phase de son programme qui s'échelonnait de novembre 2010 à juin 2011. Toujours sans création monétaire, puisque ces achats sont « stérilisés » (voir « La Tribune » du 9 décembre).
Mais malgré l'opposition affichée par Mario Draghi à toute accélération du programme de rachat de dette, la BCE a prouvé depuis 2007 qu'elle n'était pas doctrinaire et savait même être hyperréactive si nécessaire. Gilles Moec, économiste à la Deutsche Bank, souligne en particulier qu'elle pourrait infléchir sa position d'ici à février lorsque l'Italie se retrouvera face à un « mur de remboursement » de dette de 36 milliards d'euros. Par Isabelle Croizard
8 - Que va faire le FESF ? C'est selon le gouverneur de la Banque d'Italie, Ignazio Visco, « la grande nouvelle » du sommet européen. Dès jeudi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, avait devancé le communiqué final du Conseil européen en annonçant que « la BCE est disposée à agir comme agent du FESF [le Fonds européen de stabilité financière créé en mai 2010, Ndlr] dans ses opérations de marché ». Une nouvelle étape dans la mise en oeuvre des décisions du 21 juillet sur l'extension des capacités d'intervention du Fonds pour contenir la spéculation. « [Le FESF] ne sera plus considéré comme une entité dont personne ne connaît les responsables », a estimé vendredi Ignazio Visco, ajoutant que « si cela marche, les obligations d'État attaquées sur les marchés remonteront ».
Concrètement, c'est la BCE, via les banques centrales nationales, qui conduira pour le compte du FESF ses opérations d'achat sur les marchés d'obligations d'État des différents pays membres de la zone euro. Les émissions de dette du FESF servant à financer ces interventions seront également conduites par la BCE, via la Bundesbank. Cette dernière a annoncé, vendredi, qu'elle conduirait le 13 décembre une première adjudication de 2 milliards d'euros de titres à 3 mois pour le compte du FESF, dans le cadre de son programme à court terme dévoilé mercredi en complément des émissions à 5 et 10 ans lancées cette année. Un placement certes limité mais qui marque enfin le début des interventions du Fonds, réclamées depuis des semaines par la BCE. Conçues à l'origine pour supplanter les achats de la banque centrale, lancés dans l'urgence le 10 mai 2010 pour contenir la flambée des taux souverains, les interventions du FESF ont été avalisées en septembre par les Parlements européens.
Substitution partielle
Selon un stratégiste d'une banque française, le FESF pourrait ne se substituer que partiellement au programme de soutien de la BCE. Aux côtés de ses propres achats « stérilisés » (voir question 7), la banque centrale déterminerait quand le Fonds doit intervenir et conduirait ses opérations. Ce qui renforce ainsi durablement le rôle de la BCE au sein du dispositif de stabilité financière sans contrevenir à son interdiction de financer directement les États membres.
Outre le FESF, qui poursuivra jusqu'à la mi-2013 le financement des programmes d'aide à l'Irlande et au Portugal, la BCE sera également l'agent du mécanisme européen de stabilité (MES). Ce dernier remplacera de manière anticipée en juillet 2012 le FESF dans ses fonctions de soutien des marchés et disposera d'un capital de 80 milliards d'euros de fonds propres pour 500 milliards de capacité d'action. Par Julien Beauvieux
9 - Quelle place pour le FMI ? Devant les difficultés à démultiplier la force de frappe du Fonds européen de stabilité financière, l'option renflouement du Fonds monétaire international (FMI), dont les 300 milliards d'euros disponibles apparaissent bien faibles face à une éventuelle contagion de la crise en zone euro, a gagné du terrain. La négociation est encore loin d'être achevée. L'Europe s'est donné dix jours pour confirmer son intention d'augmenter sa contribution au FMI de 200 milliards d'euros - 150 pour la zone euro, 50 pour le reste de l'Europe -, sous la forme de prêts bilatéraux. Avec l'espoir que cet effort déclenchera un élan parmi la communauté internationale... Reste à éclaircir qui accordera ces prêts bilatéraux. Certains souhaiteraient voir la BCE ou les banques centrales nationales à l'oeuvre. Pour Mario Draghi, l'esprit des traités serait bafoué si les montants prêtés étaient exclusivement réalloués aux pays européens. Vendredi, la Bundesbank a indiqué qu'elle n'était pas « fondamentalement opposée » à l'idée et qu'elle discutait avec le gouvernement allemand sur les modalités de ces prêts. C. F.
10 - Les banques européennes sont-elles sorties d'affaire ? Que la zone euro ait décidé, vendredi, de ne plus imposer aux banques créancières de participer systématiquement au sauvetage d'un pays est une bonne nouvelle. Tout comme l'avait été, la veille, la décision de la BCE de lancer deux opérations de prêts à 3 ans en faveur des banques de la zone euro, afin d'améliorer leur accès aux liquidités. Pour autant, les banques européennes ne sont pas sorties de l'ornière. La preuve avec Moody's, qui a dégradé vendredi les notes de solvabilité de BNP Paribas, de la Société Généralecute; Générale et du Crédit Agricolegricole. L'agence d'évaluation financière pointe du doigt la dégradation de leurs conditions de financement. Fortement consommatrices de financements en dollars, les banques françaises en particulier - et les banques européennes en général - pâtissent depuis cet été de la défiance des investisseurs monétaires américains à leur égard. En novembre, les huit principaux fonds monétaires américains ont ainsi réduit de 68 % leur exposition aux banques françaises. Certes, la plupart des grandes banques européennes s'efforcent de diminuer leurs activités en dollars, afin de s'adapter à cette nouvelle donne. Mais tous les actifs mis en vente ne trouveront pas preneur, les acquéreurs potentiels n'étant pas légion (« La Tribune » du 9 décembre).
Hausse du coût du risque
Parallèlement à ces problèmes de financement, Moody's invoque la dégradation de la conjoncture économique dans la zone euro, qui débouchera sur une hausse du coût du risque pour les banques européennes. De quoi être inquiet au sujet de leurs performances financières à moyen terme, prévient Édouard de Vitry, responsable du suivi des banques chez UBS. Par Christine. Lejoux