La crise, dites-vous dans votre livre, était à la fois attendue et impensée. Qu'entendez-vous par là ?Que tous les mécanismes ont été vus, mais que cela n'a servi à rien. Je suis allé voir ce qu'en disaient les économistes, et j'ai trouvé pas moins de cinq écoles d'explication de la crise. 1) L'école des déséquilibres globaux, pour laquelle tout le mal vient de l'écart croissant entre les excédents chinois et les déficits américains ; 2) l'école de la politique monétaire laxiste ; 3) l'école de l'innovation financière ; 4) l'école des troubles de la régulation ; 5) l'école des interventions politiques dans l'économie : c'est l'utopie du logement pour tous qui donne naissance aux subprimes aux États-Unis.Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de synthèse ?Pour une raison simple. Le monde de la théorie économique n'est pas celui de la théorie financière. Pour les financiers, la théorie de l'efficience dispense a priori de toute inquiétude dans la mesure où, à tout instant, le marché a toujours raison. Pour la plupart des économistes, la finance est neutre. Mais comment alors expliquer que les déséquilibres globaux ne débouchaient pas sur les corrections normalement observées quand un pays accumule les excédents et un autre les déficits, comme c'était le cas entre la Chine et les États-Unis ? Certains ont inventé une théorie béquille, dite « Bretton Woods II », selon laquelle s'était formée une zone monétaire unique yuan-dollar : dès lors pas besoin d'avoir recours à l'une des trois corrections classiques, soit la dévaluation de la monnaie du pays déficitaire, soit la hausse des taux d'intérêt sur sa dette, soit la restriction de sa demande intérieure en vue de rétablir l'équilibre.Cette explication ne tenait donc pas la route ?Non, car elle ne rendait pas compte du rapport réel entre la Chine et les États-Unis. Les Chinois investissaient certes dans le dollar, mais ne voulaient pas acheter des produits risqués. C'est pourquoi il fallait que se développe une industrie financière sophistiquée, capable de leur proposer des investissements notés AAA à partir de dettes en réalité risquées. La coupure théorique entre l'économie et la finance prend là toute sa dimension.Vous mentionnez dans votre livre un autre type d'explication, plus sociologique et politique...Oui, c'est celle proposée par Simon Johnson. Pour lui, le complexe financiaro-politique a remplacé le complexe militaro-industriel décrit par Galbraith dans les années 1960. Et il ne s'agit pas seulement de la puissance du lobbying, comme on l'entend dire parfois. C'est en fait plus compliqué parce que la finance, à certains moments, a pu passer pour progressiste. Dans les années 1970, devant la sclérose de l'économie américaine, s'est installée l'idée qu'il fallait la libérer de ses bandelettes. À chaque mesure de libéralisation a correspondu une innovation financière. Ainsi quand Nixon a renoncé aux changes fixes, il a fallu inventer la couverture de change. Chaque innovation financière, en soi géniale parce qu'elle favorise la croissance, peut se transformer en poison. Mais on ne le découvre qu'après-coup.C'est vrai que dans la phase d'euphorie qui précède les crises, il semble difficile de faire entendre les objections de bon sens...Exactement, face à la preuve par le succès, comment aller contre ? Puisque, à chaque fois qu'il y a eu des signaux d'alerte, la fin du monde n'a pas eu lieu, n'est-ce pas la preuve qu'on sait gérer les accidents ?Vous soulignez le rôle sous-estimé de la liquidité...Toutes les crises récentes de la finance globale ont été des crises de liquidité : des actifs théoriquement liquides cessent de l'être quand la panique s'installe. Personne n'a vraiment pensé ce phénomène. Pour les particuliers, cela se traduit par une ruée aux guichets des banques. Et pour les entreprises, quand tous les actifs du bilan considérés comme liquides cessent d'être, tout se bloque.Comment penser l'après-crise ?Je suis pessimiste. La globalisation financière régulée par des institutions de gouvernance n'a pas empêché l'apparition de la crise. On peut toujours dire : ce modèle reste le bon, cette fois on va y arriver. Je n'y crois pas. La Chine est devenue très assertive, l'Europe est éclatée et les États-Unis sont profondément clivés en leur sein, ce qui rend plus difficile l'élaboration d'une réponse commune. On peut imaginer une déglobalisation, des régressions vers le niveau national, mais des chaînes mondiales très puissantes s'y opposent. On peut voir émerger un scénario régional, avec des régions fortement intégrées qui négocient entre elles. Dans ce cas de figure, l'Europe ne serait pas la plus mal placée. Je pense plutôt qu'on va bricoler des bouts de solutions et que pendant ce temps, le monde va changer de base. On n'abandonnera rien, ni la globalisation, ni les ensembles régionaux, ni les petites nations, parce que nous ne sommes pas après la Seconde Guerre mondiale ou après la chute du Mur. Restons lucides : tous les grands discours sur la refondation du système sont à bannir. Propos recueillis par Sophie Gherardi « Penser la crise », par élie Cohen. Fayard (320 pages, 22 euros).Je suis pessimiste. La globalisation financière régulée par des institutions de gouvernance n'a pas empêché l'apparition de la crise.
« Toutes les crises récentes ont été des crises de liquidité »
-
Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.

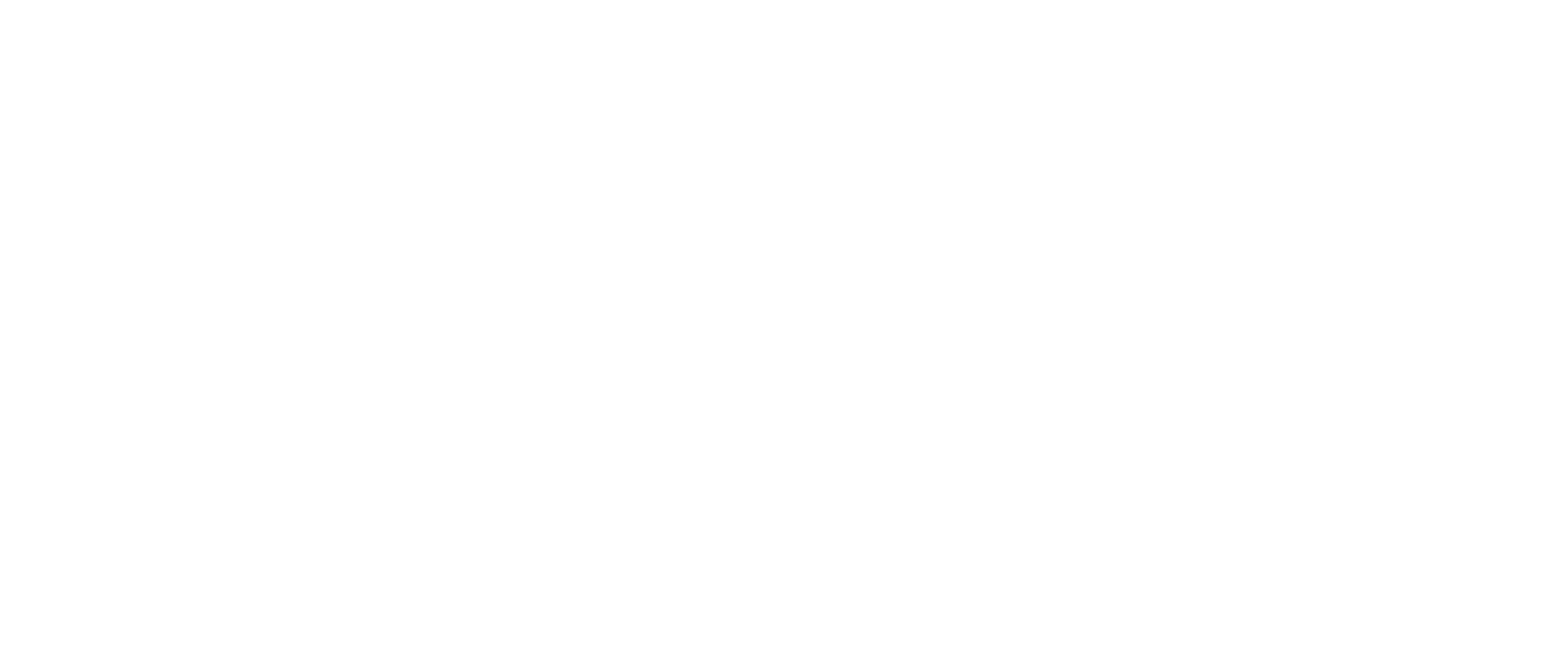

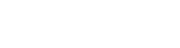
Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !