
Urgence climatique, crise de la Covid-19, accroissement des inégalités, émergences de nouvelles propositions sociétales et de nouveaux dangers... Dans la période troublée que nous traversons, nous ressentons désormais unanimement la nécessité d'engagement, comme un nouveau besoin prenant la forme d'un call to action à l'anglo-saxonne, nous enjoignant à agir avant qu'il ne soit trop tard. Pour canaliser les bonnes intentions, ONG, partis politiques, clubs et associations, charité religieuse et philanthropie rivalisent d'inventivité. Si bien que plus l'horizon s'assombrit, plus les bonnes volontés s'additionnent et se multiplient, parfois de manière désordonnée. « Au fil de notre vie, explique la philosophe Marie Robert, nous sommes tous amenés à faire preuve d'engagement. Qu'on s'engage à tenir une promesse ou à épouser quelqu'un, l'engagement ne fait pas partie de ces concepts flous qui nous semblent lointains, étrangers à notre quotidien. Pourtant, si on prend le temps de le regarder d'un peu plus près, le terme n'est pas aussi limpide qu'il n'y paraît. L'étymologie rappelle que l'en-gage-ment exige de "mettre quelque en chose en gage". L'engagement n'est donc pas gratuit, il coûte. Mais quoi au juste ? Est-ce le prix de notre indifférence ? » Son usage recoupe, aujourd'hui, différentes pratiques qui ne sont pas identiques. L'engagement peut être une ligne de conduite. « Par exemple, on s'engage à suivre certaines règles, ou l'on s'engage à respecter les termes d'un contrat. Mais cette manière de considérer l'engagement est quelque peu restreinte, et ne dit pas grand-chose de la fougue qui habille si souvent ce mot. Car s'engager, c'est avant tout une action. C'est prendre volontairement une décision qui implique de mettre notre personne au service d'une cause ou d'un combat que l'on croit juste » analyse l'auteure du Voyage de Pénélope, Une odyssée de la pensée (Flammarion, 2020). C'est qu'à travers les siècles, l'engagement a pris des formes diverses, allant de la simplicité originelle du message christique à la complexité des mécanismes socio-économiques de la social-démocratie. Autant de modalités parfois antagonistes, de formats d'engagements ayant chacun à leur tour contribué à changer la donne de la vie en société. Désormais, RSE oblige, c'est bien le monde de l'entreprise qui dicte le tempo de l'engagement, tant sur le plan philosophique qu'au niveau pratique, dans une volonté renouvelée d'efficacité. L'idée vient de plus loin qu'on ne le pense. Prolongeant la théorie de John Stuart Mill sur l'homo oeconomicus, la RSE s'appuie en effet sur l'existence d'un homme rationnel qui utilise les ressources dont il dispose de manière à en tirer la satisfaction, ou l'utilité, la plus élevée possible. Ce que Bernard Maris, dans Plaidoyer (impossible) pour les socialistes (Albin Michel, 2012), interprétait ainsi : « Homo oeconomicus est l'homme d'Adam Smith, de Marx ; l'homme des eaux glacées du calcul égoïste. Égoïste. Narcissique. Ne pense qu'à lui. Réalise le bien social à partir des égoïsmes privés. Vices privés, vertu publique ». Là précisément se trouve le génie de la RSE en termes d'engagement, transformant peu à peu les homo economicus que nous serions en homo socius ouverts au monde, à l'écoute des autres, désireux de poursuivre une quête morale après avoir satisfait des besoins primaires. De son temps, Kant évoquait déjà l'existence de « rapports sociaux de production » eux-mêmes travaillés par une « disposition de l'homme à l'humanité ». D'une certaine manière, grâce à la RSE, la boucle est bouclée et le concept d'engagement réapparaît. Il resurgit même avec une telle force qu'il devient une notion cardinale dans une société traversée par deux inquiétudes majeures : la volonté de croissance économique et la quête de sens... Reste à savoir pour quoi s'engager et sous quelles modalités ? Et comprendre, surtout, comment nous en sommes arrivés au tournant de l'engagement 2.0, sous l'égide de multinationales et autres GAFA désormais plus puissantes que des États et disposant de leur propre vision du monde...
Appel du divin et engagement terrestre
Au commencement était la religion... C'est bien par la croyance que l'homme a commencé à s'engager. À s'engager concrètement pour propager la parole divine, l'enseignement des prophètes et les nombreux commandements du Texte. Une manière comme une autre de canaliser la volonté de faire le Bien, en l'orientant vers les canons bibliques et la possibilité d'un contrat social et moral, comme dans le cas du tikkun olam, ce concept tiré de la tradition juive et visant à la réparation du monde par le biais de l'action des hommes et de la justice sociale. Un objectif expliqué par Bernard-Henri Lévy, dans Pièces d'identité (Grasset, 2010) : « Non plus sauver le monde. Encore moins le recommencer. Mais juste le réparer, à la façon dont on répare les vases brisés. Il est très beau, ce mot de réparation. Il est modeste. Il est sage. Mais il est aussi vertigineux. [...] Il ne dit plus, ce concept de réparation, la nostalgie d'un corps plein ou d'une pureté perdue, il ne rêve plus d'un vase d'avant la brisure ou d'un vase dont on hallucinerait qu'il n'a jamais été brisé. Il ne véhicule rien qui ressemble à de l'eschatologie ou de la théodicée. Il nous parle du présent. Du présent seulement. De ce présent dont un autre grand juif [Marcel Proust] a dit qu'il est juste un instant que l'on a su et pu sauver. Et dont il aurait pu dire qu'il est la seule réponse à la mauvaise prophétie de Nietzsche sur le bel avenir du Mal ». On le mesure ici : dès l'origine, l'engagement religieux oscille entre volonté de pureté et nécessité de composer avec un réel sinon chaotique du moins largement imparfait, que les hommes auraient la charge de « réparer ». Si les religions posent, chacune par ses figures, ses mythes et ses rites, les bases d'un engagement terrestre concret, leur cause commune est immense et surplombe tout : c'est bel et bien la croyance en Dieu qui les guide. On connaît la suite : de minoritaires, le peuple des croyants monothéistes ne cessera de gagner du terrain. D'aucuns diront des parts de marché ! Au fil des siècles, le polythéisme antique et les rites païens vont ainsi reculer. L'empire romain, initialement en guerre contre les juifs et opposé à la ferveur chrétienne, n'aura d'autre choix que de se rendre à l'évidence : combattre la masse de ces néo-croyants qui se multiplient de façon exponentielle lui est impossible et dangereux. Il va lui falloir composer avec leur foi, les intégrer. Et bientôt songer à se convertir. Mais qu'est-ce que, au juste, la vocation religieuse ? Dans un texte intitulé « S'engager dans la vie religieuse ? »[1], le frère dominicain Jean-Claude Lavigne explique : « Parler de vocation, c'est souvent se représenter une voix de l'extérieur (Dieu) qui nous appelle à une conversion et nous invite à nous mettre au service de Dieu et de l'Église. Il me semble nécessaire de changer cette représentation. La vocation apparaît plutôt comme un appel intérieur à aller vers soi-même, à rejoindre notre vérité profonde. » C'est bien là le génie de l'engagement religieux : faire dialoguer un appel intérieur et une injonction religieuse. Un besoin personnel et une demande divine. On estime aujourd'hui à un peu plus de 30 000 le nombre de religieux et de religieuses catholiques sur le territoire français. Un chiffre faible qui cache, en fait, un inestimable réservoir de vocations en sommeil, comme en témoigne une étude réalisée en 2015 par l'institut OpinionWay pour la Conférence des religieux et religieuses de France (Corref) et publiée par La Croix. Ces résultats ne laissent aucun doute quant à la prégnance du motif de l'engagement religieux puisqu'un Français sur dix a déjà pensé s'engager dans la vie religieuse catholique - celles des frères, sœurs, moines et moniales -, qui bénéficie d'une bonne image pour 65 % des personnes, selon le sondage. Mieux encore : l'étude révèle « un regain inattendu de la vie spirituelle chez les 18-24 ans », dont 15 % ont déjà songé à l'engagement religieux. Une quête de sens somme toute logique dans un monde en perte de repères...
Humanisme et Renaissance de l'idée d'engagement...
La passion pour l'engagement religieux connaîtra son acmé au cours du Moyen Âge, moment charnière dans lequel églises et abbayes concentrent, dans le silence de leurs salles d'étude et de prière, les plus grands trésors de la pensée humaine. Jusqu'au bouleversement de la Renaissance et l'arrivée progressive de nouveaux motifs d'engagement : l'idée de nation d'abord et la (re)découverte du pouvoir de l'individu, ensuite. À mesure que l'idée de territoire et de frontière émerge, on en vient à s'engager ailleurs que pour la gloire divine, c'est-à-dire pour un seigneur, pour un Roi, pour la défense d'une région ou d'un territoire. Moralement, l'idée est forte. Aussi forte qu'elle concurrence désormais l'optique religieuse et crée une nouvelle forme d'engagement : l'engagement militaire. Partout à travers le continent, châteaux et places fortes se construisent. On se défend et on attaque alors en vertu de l'idée selon laquelle il faut combattre pour ses valeurs. Une confrontation se fait jour, non plus intime mais bien avec un « Autre », souvent dépeint sous les traits du barbare... De nouvelles valeurs émergent, héritées du monde mythique de la chevalerie. Une forme d'engagement militaire qui se superpose d'ailleurs parfois avec l'engagement religieux : c'est le principe de la croisade et plus globalement celui de la « guerre sainte ». Autrement dit : l'union de deux causes, du pouvoir temporel et du pouvoir divin fabriquant des saints et des martyrs.
On notera tout de même un glissement. À mesure que le souverain devient l'incarnation vivante d'un État et le représentant de dieu sur Terre, il permet l'épanouissement et l'expression d'un nouveau genre d'engagement, plus personnel. L'œuvre de scientifiques et d'artistes racontant sa grandeur explose. En despote (parfois) éclairé, voilà ce dernier non plus seulement chef de guerre ou conducteur de la foi mais désormais protecteur des peintres, des architectes, des hommes de lettres et des scientifiques qui remettent l'homme au centre du débat. Copernic, Galilée, Erasme, Léonard de Vinci, Raphaël, Montaigne deviennent, à leur tour, de nouvelles incarnations glorieuses de l'idée d'engagement. Ils seront bientôt suivis par les penseurs des Lumières. Tous risquent leur vie pour publier leurs œuvres et éclairer l'humanité de leurs savoirs. D'officiel, l'engagement devient ainsi plus personnel. Une révolution est en marche.
« Ce qui change, avec la Renaissance et les Lumières, c'est la rigidité du cadre, explique la philosophe Marie Robert. L'Église et l'Armée ritualisent l'engagement, anticipent les moments de doute. Dans les arts ou les sciences, c'est bien plus mouvant. On a conscience que l'on crée, mais a-t-on conscience que l'on s'engage ? L'engagement n'est pas un fantasme, ni un devoir, encore moins une obligation, dont l'absence doit susciter de la mauvaise conscience, au contraire. Il n'est pas question d'en faire une corvée mais plutôt une expérience... Détaché de l'idée de contrainte, l'engagement devient une chance, une manière d'être touché par l'extérieur. Néanmoins, comment être touché sans s'exposer ? Sans interagir ? Sans connaître le quotidien, les besoins, les peines, les convictions d'autres hommes ? Pour s'engager, il est donc essentiel de se confronter et de découvrir. À la Renaissance, on s'engage pour soi, certes, mais on s'engage en résonnant avec l'extérieur. Les créations artistiques et scientifiques en sont la preuve parfaite, des hommes seuls entrent en lien avec le monde... »
Grandeur et décadence de l'espérance politique
L'influence de ces œuvres de la pensée remettant l'homme au centre du monde sera puissante. Partout où ils le pourront, tantôt par la guillotine tantôt par la voie pacifique, les peuples chercheront à se libérer du joug despotique et de l'emprise religieuse. La nature ayant horreur du vide, une nouvelle classe de représentants, une nouvelle élite d'engagés, va naître : les politiciens. Et plus précisément encore, ceux dont le métier est justement de s'engager pour représenter, porter la voix et administrer la vie et les attentes de leurs concitoyens. Le bouleversement est, là encore, de taille. C'est désormais dans le sillage de ses tribuns du peuple, au sein de partis et de mouvements, que l'on s'engage avec ferveur. Les XIXe et XXe siècles verront ainsi leurs plus brillants esprits combattre dans le cadre très codifié de motions, de propositions de loi, de discours et de tentatives putschistes parfois. C'est que l'époque, comme le chantait Bob Dylan, a changé. Après l'ère des révolutions, l'engagement se délivre de sa notion d'absolu. Il perd alors en noblesse ce qu'il gagne en romantisme, tant la politique se vit alors comme une aventure moderne, emportant les passions d'une époque passionnée, jusqu'à l'excès, par les concepts. Pour le meilleur et pour le pire, voilà que les idées, dans toute leur diversité, dirigent le monde. L'horreur nazie et les millions de morts du communisme n'y changeront rien. De l'euphorie messianique des groupuscules trotskistes au rigorisme feutré de la démocratie chrétienne, les formations politiques représenteront longtemps l'idée que l'on se fait de l'engagement. Mais pour qu'un tel glissement s'opère, il a bien fallu que l'individu se libère. Car, comme le rappelle Marie Robert, « en s'engageant, l'individu prend la mesure de sa responsabilité face à une situation et décide de la modifier. Il y a dans l'engagement une forme d'élan qui nous conduit littéralement à "nous mettre en lien". S'engager, c'est n'avoir pas d'autre choix que de faire. C'est ensuite seulement qu'on affine, qu'on construit, qu'on précise le lieu de nos engagements. Mais à l'origine, il est question de revenir au fil rouge de notre humanité, celui du "vivre ensemble", qui n'est pas qu'une expression creuse. "Vivre ensemble", avec nos conjoints, nos parents, nos familles, nos tribus, nos voisins, et puis, les autres, tous les autres, qui constituent notre monde et qui conditionnent notre survie. L'individualisme est une construction. Même seul, je suis en lien avec l'architecte et l'entrepreneur qui ont construit mon toit. Je suis en lien avec ceux qui me nourrissent, ceux dont je croise le regard dans la rue. Bref, peut-on réellement vivre en société sans s'engager ? Sans être tendu vers l'autre ? » La réponse apportée par la politique est claire : impossible de ne pas militer, de ne pas s'engager pour être tout à fait dans le monde. Sartre ne dit pas autre chose lorsqu'il popularise le concept d'existentialisme dans lequel l'individu s'illustre par ses propres choix, ses propres actions. De la politique au monde des idées, une éthique de l'engagement, ne tarde pas à se créer. Une philosophie exigeante, bientôt prolongée, au-delà de la sphère politique, par l'action de quelques penseurs charismatiques qui incarneront la figure de l'intellectuel engagé. Avec Hugo, Zola puis Sartre, Aron, Beauvoir et Malraux, c'est l'heure du combat d'idées mené avec honneur et superbe par les livres, dans les revues, dans des discours grandioses et autres tribunes interposés. Une avant-garde intellectuelle se forme. Elle ne va pas tarder à dessiner les contours et donner le tempo des débats qui intéressent l'opinion. Son apport est inestimable. Pas d'affaire Dreyfus sans intellectuels engagés, pas de remise en cause des grands systèmes dictatoriaux du xxe siècle ni même de libération des mœurs en Mai 68 sans leurs interventions remarquées. L'engagement intellectuel, porté par quelques figures respectées enviées et plébiscitées, est alors à son point culminant...
L'avenir ? Du business et du sens !
L'émergence de la radio puis celle de la télévision donneront une seconde jeunesse à la figure de l'intellectuel engagée. C'est ainsi qu'au tournant des années 1970, le modèle se renouvelle, se dépoussière dirait-on même, avec l'arrivée des Nouveaux Philosophes : ils s'appellent Glucksmann, Bruckner, Lévy et Finkielkraut, portent les cheveux longs et manient les concepts avec aisance. Autant d'esprits agiles et modernes pour une société post soixante-huitarde désireuse de « changer le monde ». Reste qu'au fil du temps, cette stratégie de la posture et du coup d'éclat permanent ne va pas tarder à lasser. Il n'y a qu'à voir Bob Dylan, encore lui, le regard dans le vague au moment de rejoindre ses camarades du show-business pour l'enregistrement du morceau caritatif We are the world. Quelque chose s'est rompu, il n'y croit plus... Intellectuels et autres artistes engagés passent désormais pour des « professionnels de l'engagement ». Surfent-ils sur le malheur du monde pour leur propre gloire ? « Il y a toujours le risque de la posture, analyse Marie Robert. L'engagement, c'est l'action. Or, plus on parle moins on agit, non ? Il faut surtout parler de la crainte d'être déconnecté du "terrain". La frontière est mince entre l'engagement, l'incitation à l'engagement, et le côté "donneur de leçon" qui tend vers la culpabilité. De l'idée d'évidence, de lien au monde, la figure de l'intellectuel devient progressivement celui hors-monde. » C'est alors l'impasse. Une « fin de l'Histoire », comme le prédisait la théorie de Francis Fukuyama, qui coïncide douloureusement avec la disparition des grandes espérances politiques. Sans souffle et sans destination, comment l'engagement pouvait-il renaître pour influer, à nouveau, sur le cours de l'Histoire ? Et plus encore : dans un contexte de chute des idoles et de mort des idéologies, où et comment s'engager au xxie siècle ? La question est devenue cruciale à mesure que l'inquiétude environnementale et l'attention portée aux combats sociétaux (nouvelles formes de l'antiracisme, résurgence du féminisme et des causes LGBT) se transformaient en urgence. Première piste pour une renaissance : le retour aux fondamentaux. Autrement dit, un retour en grâce de la pratique religieuse en vertu de la célèbre phrase de Malraux, « Le XXIe siècle sera mystique ou ne sera pas », ou bien encore un retour puissant de la volonté d'ordre (armée, police) dans une société en proie au terrorisme et à l'insécurité. Autant de refuges jugés rassurants mais sans vraie perspective d'avenir. Il fallait inventer une autre solution, plus novatrice. Ce sera l'engagement au sein de l'entreprise, comme s'il fallait que de notre nouveau siècle émerge une nouvelle forme d'engagement, à la fois plus efficace, plus dynamique et plus connectée à nos modes de vie. Du business et du sens !
Ce serait la formule d'Olivier de la Chevasnerie, président du Réseau Entreprendre et persuadé que l'entreprise peut changer le monde : « Il faut que tous les entrepreneurs aient conscience qu'ils sont capables de changer le monde. Ils ont cette capacité à changer les choses, à aller dans la bonne direction, à inventer l'entreprise et les emplois de demain. Quand la crise sera passée, il ne faut pas qu'ils repartent sur le modèle d'avant, mais qu'ils soient convaincus au contraire qu'ils peuvent aller vers un monde meilleur, plus respectueux de la planète, plus responsable, plus solidaire. »[2]
L'avenir est là et il se pourrait bien que du cœur battant du capitalisme surgisse la révolution qui vient. En mettant leur puissance, leurs capitaux, leur force de frappe et leurs équipes au service de causes rassembleuses, mastodontes et PME, GAFA et start-up se réinventent en acteurs vertueux. Reprenant à leur compte le modèle des mécènes de la Renaissance, Google, Amazon, Facebook font naître des fondations en leur sein. Depuis la Silicon Valley, Tel Aviv, ou Bangalore, des laboratoires, des think thank et des médias éclosent à nouveau. Et tout le monde y gagne visiblement : le public et le privé, le salarié du dedans et le monde au dehors, l'idée de justice sociale, de vivre-ensemble, de bien commun. « L'enjeu, conclut Marie Robert, n'est pas de distribuer des bons ou des mauvais points mais plutôt de saisir une démarche. Le penseur Peter Singer explique parfaitement l'intérêt de l'altruisme efficace. Une forte puissance de frappe permet d'aller plus loin, plus vite, plus efficacement. Quelle excellente nouvelle que d'imaginer que ces entreprises profitent de leurs capitaux pour agir. Après, comme souvent, attention à l'écran de fumée... Exactement comme pour les mécènes. S'agit-il de s'acheter une conscience ou de s'engager réellement ? » La question se pose, depuis la nuit des temps !
[1] Article publié sur le site Internet de La Croix.
[2] Interview « Olivier de la Chevasnerie : "Ce sont les entrepreneurs qui changent le monde" » par Valerie Loctin, Entreprendre, 25 septembre 2020.
___________________________________________________



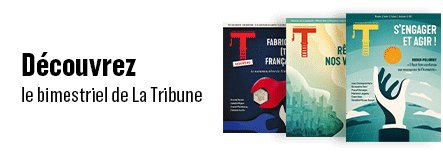
 Economie de guerre : Nexter se dit capable de fabriquer 12 canons Caesar par mois
Economie de guerre : Nexter se dit capable de fabriquer 12 canons Caesar par mois


Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !