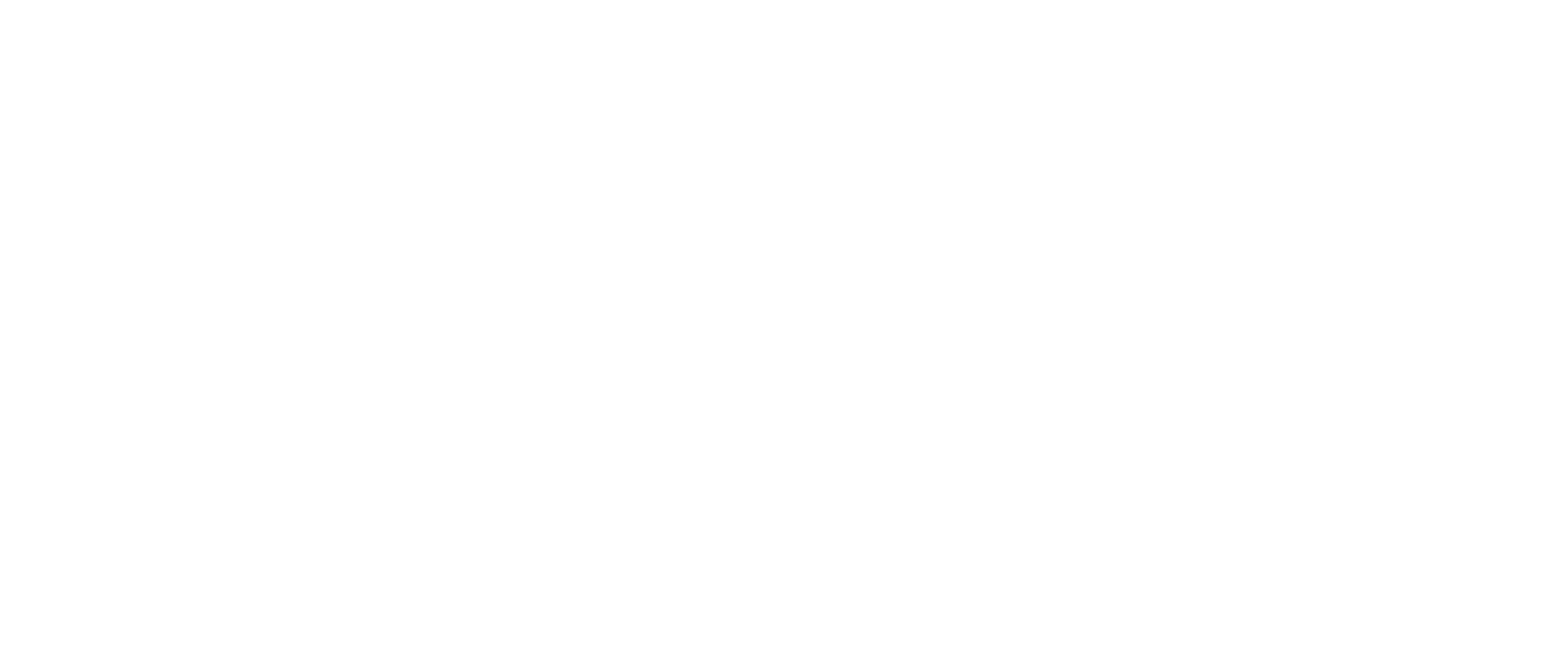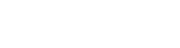Le 21 juillet 1926 au matin, le président du Conseil français Edouard Herriot, qui vient de former un gouvernement, reçoit une lettre d'Emile Moreau, gouverneur de la Banque de France qui est alors une institution privée et indépendante. Cette lettre enjoint au président du conseil de réclamer un vote explicite du parlement pour augmenter le plafond des avances accordées par la Banque au gouvernement. Faute de quoi, la Banque cessera immédiatement ses paiements pour le compte du Trésor. La France sera alors immédiatement en faillite.
Aussitôt connue, cette lettre provoque un vent de panique chez les épargnants qui, craignant un impôt forcé sur les dépôts, se ruent aux guichets. Le franc s'effondre, il faut 235 francs pour une livre sterling (contre 25 avant la guerre et 179 un mois avant). Tous savent combien la majorité du gouvernement est fragile. En fin de journée, Edouard Herriot se présente devant la Chambre et est renversé par 290 voix contre 237. Pour sortir de l'Assemblée, il doit attendre que la police disperse la foule hostile qui entoure le Palais Bourbon. Le Cartel des gauches, élu deux ans plus tôt, a péri définitivement sous les coups d'une simple lettre d'un gouverneur de la Banque de France. Quelques jours plus tard, Raymond Poincaré, l'idole des marchés, battu en 1924, revient aux affaires.
Un souvenir de 1926...
On ignore si Mario Draghi connaît cet épisode de l'histoire de France qui a donné naissance à une expression, le "mur de l'argent". Mais les similitudes avec la situation de ce mois de février 2015 sont frappantes. Le « Cartel des gauches » avait en effet remporté - du moins en sièges sinon en voix - les élections de 1924 sur un programme qui n'est pas sans rappeler - toutes choses étant égales par ailleurs - celui d'Alexis Tsipras : rétablir l'équilibre budgétaire par l'application rigoureuse de l'impôt sur le revenu - voté en 1914 mais encore appliqué sans convictions - et renforcer les lois sociales, notamment sur le temps de travail, le respect du droit syndical et les assurances sociales.
D'emblée, ce programme déplut aux puissances économiques françaises et aux banques américaines qui font alors la pluie et le beau temps sur le marché des changes. A l'instar du programme de Syriza qui déplaît aujourd'hui aux marchés. Pendant deux ans, la pression exercée sur les gouvernements du Cartel va en réalité les empêcher d'agir réellement et aggraver les dissensions internes entre socialistes, radicaux et républicains modérés. Jusqu'à ce que, le 21 juillet 1926, la Banque centrale porte l'estocade pour le compte des milieux d'affaires par un simple ultimatum qui n'est pas sans rappeler celui du 4 février 2015.
La BCE, acteur politique
Comme en 1926, ce 4 février 2015, le mythe de l'indépendance de la BCE a volé en éclat. La BCE, en tant que seule vraie institution « fédérale » de la zone euro, se considère comme le garant d'un ordre économique qu'elle veut défendre, semble-t-il, à tout prix. Ceci est logique : la BCE est la seule force capable, via les banques grecques, d'exercer une véritable pression sur Athènes. Rappelons en effet que les traités ne prévoient rien qui ressemble à une expulsion d'un mauvais élève budgétaire de la zone euro, même en cas de défaut sur la dette.
En revanche, si la Grèce se retrouve dans l'impossibilité pratique de disposer d'assez de liquidités, elle devra de facto sortir. Le geste politique est d'autant plus éclatant que la BCE fonde sa décision de mercredi sur une simple interprétation, sur une croyance, celle qu'aucun « programme » n'est susceptible de voir le jour. A priori, une institution indépendante aurait dû attendre de constater un échec des négociations. La partie se joue donc au niveau politique entre Athènes et Francfort. Comme entre Matignon et la Banque en 1926.
De quel jeu parle-t-on ?
De quelle partie s'agit-il ? Il s'agit d'intimider le plus possible l'autre joueur pour le faire « craquer » et accepter de céder sur l'essentiel. La question centrale de ce jeu, c'est évidemment de savoir jusqu'où l'autre est prêt à aller. En réalité, le véritable enjeu qui n'est jamais évoqué directement par les parties prenantes, c'est le Grexit. Chacun fait le pari que l'autre ne le veut pas.
Là où la partie est un peu vicieuse, c'est que pour faire craquer l'autre, on avance vers le Grexit pour tenter de lui faire croire que l'on est prêt à tenter ce saut. D'où une stratégie de la tension permanente... Tout ceci se fait évidemment très diplomatiquement, jamais explicitement. La question reste de savoir si ce jeu de dupes peut mal tourner ou non.
Le coup grec et la réplique de la BCE
Ainsi, vendredi, la Grèce avait pris l'initiative en « tuant » la troïka. Elle mettait une pression certaine sur la BCE qui a conditionné le soutien à la Grèce à un accord avec la troïka. Dès lors, le choix pour Mario Draghi était soit d'accepter le fait accompli et d'engager des négociations, mais alors sur la base grecque et acceptant la mort d'une troïka dont elle fait partie, soit de répondre au coup de force par un autre coup de force, celui de menacer de couper les vivres à Athènes. C'est cette dernière voie qu'elle a emprunté. L'équilibre est donc rétabli.
Un jeu de bluff
Certes, si on y regarde de près, les deux joueurs, tout en durcissant leur jeu, laissent des portes ouvertes à un accord, à un « match nul » par accord mutuel, comme il en existe aux échecs. Athènes a ainsi fait des propositions lundi et la BCE n'a pas coupé le robinet puisqu'elle a maintenu jusqu'au 28 février l'accès du système financier grec au programme d'accès à la liquidité d'urgence (ELA). Mais si les ponts ne sont pas coupés, à chaque fois qu'un joueur tente un coup de bluff, on se rapproche d'une fin que ni l'un, ni l'autre ne souhaite officiellement : que la table soit renversée. La BCE menace désormais clairement Athènes d'un Grexit, comme Athènes a menacé d'un défaut unilatéral vendredi.
La situation grecque
Après la décision de la BCE, la balle est dans le camp d'Alexis Tsipras. La question est de savoir si, comme le disait le ministre des Finances Yanis Varoufakis, « le gouvernement Syriza ne se comportera pas comme le gouvernement irlandais en 2010. » Autrement dit, s'il cédera comme Dublin voici 4 ans ou comme Edouard Herriot en juillet 1926. Mais la situation du nouveau Premier ministre grec semble plus forte. Il vient d'être élu, 70 % des Grecs le soutiennent et il dispose d'une majorité parlementaire qui semble solide et unie sur la question européenne. Cette force lui donne des obligations : celle de ne pas faiblir. S'il le faisait, il perdrait la confiance d'une partie de son électorat et sans doute de son allié de droite et d'une partie de son propre parti. S'il cède trop, il pourrait certes s'allier avec les « pro-européens », mais il sanctionnerait alors sa conversion en nouveau George Papandréou et celle de Syriza en nouveau Pasok. Le parti communiste et les néo-nazis pourront se frotter les mains. Compte tenu de ses forces intérieures, Alexis Tsipras ne peut guère faiblir. Mais s'il joue le durcissement, le gouvernement grec devra désormais préparer concrètement les esprits au Grexit - sans en parler ouvertement pour ne pas couper les ponts - pour faire croire qu'il ne bluffe pas. Au risque de se laisser emmener plus loin qu'il ne voudrait...
La situation de la BCE
La BCE est-elle mieux lotie ? Pour le moment, oui. Mais à mesure que la date du 28 février s'approchera et le risque du Grexit se précisera, la pression deviendra de plus en plus forte sur Mario Draghi dont on voit mal comment il pourrait accepter la responsabilité d'une rupture de l'irréversibilité de l'euro. La position de force de la BCE n'est que temporaire. Et Athènes pourrait être tentée de jouer la montre pour réduire les exigences de Francfort qui, du coup, sortirait perdante de l'affaire, surtout si elle doit accepter une renégociation de la dette et une remise en cause de l'austérité. Mario Draghi devra aussi prendre garde à ne pas apparaître comme le bourreau de la démocratie, mais il ne pourra pas non plus donner l'impression d'avoir trop reculé après s'être montré ferme. La crédibilité de la BCE est en permanence sous l'œil des marchés.
Le jeu est donc plus équilibré qu'en 1926. Il est aussi plus confus. Les deux parties recherchent sans doute un compromis, mais à leur avantage. Et la marge de manœuvre des deux acteurs est fort limitée. Un « Happy End » n'est pas certain dans ce jeu grec.