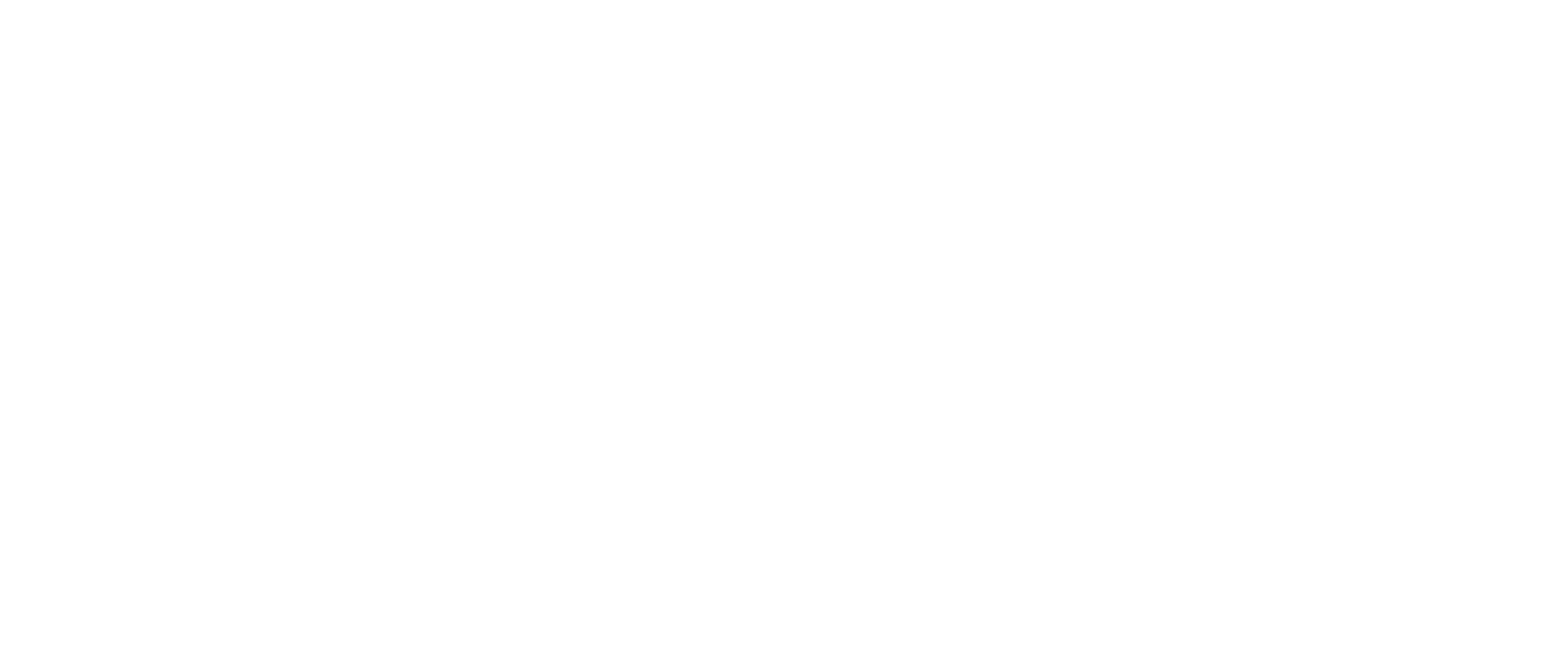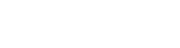La nuit est tombée sur Saint-Germain-des-Prés, Marin Karmitz a 25 ans, il cherche Marguerite Duras. Un bistrot reste ouvert, proche des Éditions de Minuit ; le jeune homme entre, la romancière est là. « Je picolais très largement autant qu'elle à l'époque, souligne Karmitz. Je lui ai fait ma proposition, elle a accepté. » L'apprenti cinéaste, assistant d'Agnès Varda et de Jean-Luc Godard, a reçu une commande, réaliser un documentaire sur les ravages de l'alcoolisme. Mais ce qu'il a vu dans les hôpitaux psychiatriques l'a horrifié. Il refuse de montrer des êtres dans un tel état de délabrement. Déjà, il combat « ce voyeurisme esthétique de la souffrance ». Passionné par le Nouveau Roman, il comprend que l'écriture est la solution. Le doc devient une fiction et Duras sa scénariste. Le court-métrage s'intitule Nuit noire, Calcutta. Voilà Karmitz : audace et combativité, exigence et obstination. La première fois que nous le rencontrons, silhouette trapue, regard perçant, 85 ans, il tient sous le bras un journal. Et il s'énerve. En une, une photo de cadavres, des corps de civils criblés de balles sur un trottoir. Nous sommes le 9 octobre, Israël vient d'être attaqué par les terroristes du Hamas. « Cette photo n'aurait pas dû être publiée. On ne sait pas qui sont ces gens, on ne peut pas s'intéresser à eux. C'est le spectacle de la mort et c'est insupportable. On tue la réalité ainsi, on fait de nous des amateurs de crimes. Il faut se méfier de l'image. »
On est à un point de retour au nazisme ou au stalinisme. Il se passe des choses inacceptables, impensables. Il est impossible de ne pas prendre position
L'image, pourtant, est son premier métier. Étudiant à l'Idhec, l'école de cinéma de Paris, dans la section des chefs opérateurs, il apprend à photographier et à développer, des journées entières en chambre noire. Un temps photoreporter, il couvre les luttes des ouvriers de l'usine Renault à Boulogne-Billancourt, au début des années 1970. Et remarque que la violence des affrontements décuple quand il sort son objectif. Jusqu'au drame qui lui fait abandonner le reportage. Le meurtre, par un garde de l'usine, d'un jeune ouvrier chargé de la sécurité d'un collègue photographe. « Il vaut mieux s'intéresser à la parole, dit-il. Ce sont les mots qui donnent envie de résister. » Résister, le verbe revient sans cesse dans sa bouche. Résister contre les extrêmes, résister contre la barbarie, résister pour changer le monde. Est-ce qu'être de gauche, c'est résister? demande-t-on à celui qui fut lycéen communiste, soixantehuitard maoïste, défilant boulevard Saint-Michel avec Daniel Cohn-Bendit et le mouvement du 22 mars, puis sympathisant socialiste. « Oui, mais aujourd'hui les partis de la Nupes, LFI, PS et écologistes ne peuvent être considérés comme de gauche. Ils sont les complices d'assassins. Mélenchon nous explique que les institutions sont pourries, que les juges, les députés, les banquiers, les ministres sont pourris. Ce populisme est à terrasser. Au même titre que les idées d'exclusion, de haine et de nationalisme de Le Pen et Zemmour. » Cet homme en colère porte haut et fort les valeurs d'humanisme et d'universalisme d'une gauche à l'agonie. « J'ai une admiration sans borne pour les résistants français et le plus grand mépris pour les collaborateurs, ajoute-t-il. Aujourd'hui, même s'il reste des résistants, les collaborateurs l'emportent. » Dans les salles du Centre Pompidou, il présente ses photos, des œuvres anciennes, rares, cotées, qu'il a d'abord accrochées chez lui, réunies ici en une exposition qu'il présente comme son « dernier film », une consécration inestimable de l'institution pour son œil de collectionneur. Le réalisateur Romain Goupil, son ami depuis les années 1960, et qui s'apprête à lui consacrer un documentaire, explique: « Cette expo, c'est l'aboutissement de ses réflexions. Des regards et des corps d'hommes et de femmes qu'il veut protéger de l'horreur, non parce qu'il la nie, mais parce qu'il l'a connue. Transmettre une espérance en l'humanité. Avoir une attention au monde, sans misérabilisme. Marin a un engagement politique au sens noble, celui de s'occuper de la cité. »
Les débuts de la success story
Marin Karmitz naît en Roumanie en 1938, au sein d'une famille juive de Bucarest dont les ancêtres sont vendeurs de légumes. Prémices de success story : la génération de son père s'enrichit grâce à une prospère entreprise familiale de pharmacie-chimie. Les Karmitz survivent aux années de guerre lors desquelles furent massacrés 400000 Juifs. Mais la peur rôde en permanence. Marin et sa fratrie sont interdits d'école. Les Soviétiques arrivent au pouvoir et ils sont de nouveau traqués, cette fois-ci parce que riches. En échange de l'intégralité de leurs biens, ils obtiennent des passeports et fuient, en quelques heures, sans savoir où. Le bateau sur lequel ils embarquent est refusé dans chaque port de la Méditerranée. Seule la France accepte ces migrants juifs et démunis, pestiférés. Reconnaissance éternelle de celui qui plus tard est décoré de la Légion d'honneur. À Marseille, le garçon de 9 ans peut enfin apprendre à lire. À Paris, au lycée Carnot, il découvre la philosophie et les salles de cinéma du Quartier latin. Le militantisme communiste aussi, grâce à un prof de philo et la lecture de Sartre et d'Aragon. Un engagement qui coûte cher à sa famille. L'administration française refuse d'accorder la naturalisation aux parents d'un secrétaire de cellule. Un fils rouge... Le traumatisme est terrible pour ceux qui ont échappé de peu au régime roumain, la blessure indélébile. « Je ne me pardonne toujours pas d'avoir tant peiné mon père », confie Marin Karmitz. En 1972, son troisième long-métrage Coup pour coup, sur une grève de femmes dans une usine textile, fait grand bruit. Partout, des ouvriers bloquent les chaînes de production après avoir visionné ce percutant film dans lequel jouent de véritables ouvrières. « Ça a fichu un tel bordel dans le pays que j'ai été blacklisté », se souvient Karmitz, qui n'a plus jamais trouvé de prêt bancaire pour produire ses propres œuvres. Sous Pompidou puis Giscard, l'engagement militant, même sur grand écran, a de lourdes conséquences. Karmitz comprend qu'il ne sera pas réalisateur, un renoncement difficile. Mais l'adversité est source de créativité. Pour contourner les interdits politiques, les déprogrammations et l'absence de financement, pour protéger ce qu'il a de plus précieux, sa liberté et son autonomie, il ouvre sa propre salle de cinéma, baptisée 14 juillet, à la Bastille, bien loin du quartier doré des producteurs du 8e arrondissement. À la marge donc, en périphérie, Karmitz programme des films révolutionnaires boliviens, du cinéma d'auteur, produit et diffuse les œuvres dont personne ne veut. Un scénario de Louis Malle fait le tour de Paris avant d'atterrir sur son bureau. Au revoir les enfants est un succès mondial, Lion d'or à Venise, prix du meilleur film aux Césars, nommé aux Oscars. Avant, il y eut Sauve qui peut (la vie), de Godard, viennent ensuite les chefs-d'œuvre de Claude Chabrol, d'Alain Resnais, d'Abbas Kiarostami, de Krzysztof Kieslowski et le triomphe de La vie est un long fleuve tranquille, d'Étienne Chatiliez. MK2 s'étend dans la ville, investissant des coins délaissés comme le 19e, offrant aux Parisiens un cinéma en version originale, inédit, exigeant. Ailleurs en France existent déjà des exploitants indépendants ; Karmitz décide de se concentrer sur la capitale, d'où il est possible de conquérir le marché mondial. Sans avoir peur de fâcher. En 2004, par exemple, il refuse, à contre-courant, de diffuser La Passion du Christ de Mel Gibson, « un film fasciste et antisémite ».
Un proche de Françoise Giroud
Il vit dans le si beau 6e arrondissement, près du jardin du Luxembourg, avec sa compagne, la pédopsychiatre Caroline Eliacheff, fille de Françoise Giroud et du producteur Anatole Eliacheff, une partenaire de choc, co-scénariste de Chabrol, médecin réputée, de nos jours violemment attaquée pour ses positions sur la transidentité. Elle a déjà deux fils, ensemble ils en ont deux autres. Famille nombreuse où l'on dîne entouré d'œuvres d'art, bercée de discussions continues sur le cinéma et la politique. Françoise Giroud, figure tutélaire du journalisme, intellectuelle affûtée, plus femme à poigne que « mamie gâteau », vient déjeuner le dimanche. À ses petits-fils, elle martèle : « Faites ce que vous voulez, mais soyez les meilleurs. » Ambiance bourgeoise et engagée, éducation disciplinée et libertaire, formidable chaudron d'une gauche décriée parce que fortunée. Les Karmitz connaissent les critiques redondantes adressées à ceux qui gagnent beaucoup sans perdre rien de leurs opinions. Et alors, disent-ils ? Ils font de l'argent l'outil de leur indépendance, vivant dans l'aisance sans cesser de lutter. « Il a toujours été conscient de ce grand écart, indique Goupil. Mais pour mettre en lumière des choses différentes, il faut des moyens. » Les attaques redoublent lorsque Nicolas Sarkozy nomme Karmitz à la tête du Conseil de la création artistique, en 2009. « Marin est un enfant d'émigrés, immensément reconnaissant envers la France, décrypte Nathanaël, son aîné. L'État fait appel à lui ; il accepte, bien sûr, même si c'est Sarkozy. » Faire tourner une entreprise privée en gardant une mission d'intérêt général, défendre l'altérité, s'ouvrir à l'étranger, sans négliger son chiffre d'affaires, c'est l'objectif assumé. Une philosophie de la dialectique qu'ils doivent, assurent père et fils, à leur culture juive. Sans être pratiquant, l'ancien exilé relit chaque année le Talmud. Il considère comme sien le fils aîné de Caroline Eliacheff et de Robert Hossein, devenu rabbin à Strasbourg. « Être juif, pour moi, ce n'est pas une religion, c'est une étude », explique Marin Karmitz, qui a fondé à Paris une yeshiva, une école talmudique. Les massacres perpétrés en Israël le 7 octobre, et le nombre record d'actes antisémites enregistrés en France depuis, le révoltent. « On est à un point de retour au nazisme ou au stalinisme. Il se passe des choses inacceptables, impensables. Il est impossible de ne pas prendre position » soupire-t-il.
MK2 une affaire de famille
Son fils Nathanaël Karmitz, 45 ans, devient président de MK2 en 2005. « Je m'étais préparé à prendre la direction quand mon père aurait 65 ans, précise-t-il. Mais c'est surtout depuis dix ans que mon frère et moi apportons notre pierre à l'édifice. » En 2012, ils décident, après plusieurs échecs, d'arrêter la production. La diversification, la création d'une filiale en Espagne et l'ouverture d'un hôtel : autres choix des frangins Karmitz, payants, le chiffre d'affaires n'ayant jamais été si haut. Nathanaël raconte une enfance heureuse et stimulante, les samedis après-midi passés à découvrir les nouveautés de la galerie VU', les repas avec les artistes Annette Messager et Christian Boltanski, les parents grimpés sur un escabeau dans le salon pour modifier l'éclairage d'une photo, un voyage à Bucarest sur les traces de leurs aïeuls, les cours particuliers d'anglais pour pouvoir, plus tard, viser l'Amérique... « Jamais Marin ne nous a dit "vous allez reprendre MK2". On savait que si on le voulait, il allait falloir s'en montrer dignes », relate celui qui après une année de fac de droit suit son ambition d'entrepreneur-né, légataire d'une tradition familiale remontant aux années 1920 en Roumanie. Avant même d'obtenir son bac, Nathanaël crée une société de communication, puis s'essaie à la production et prend en charge les restaurants du cinéma Quai de Seine. « Notre père nous laissait faire et on avait le droit de se planter, mais il fallait bosser, beaucoup », ajoute-t-il, voix douce, débit saccadé. Elisha Karmitz, 38 ans, cadet de la fratrie, passé par une Khâgne « philo », devenu directeur général de MK2, abonde : « On a vite compris que le but fondamental de cette entreprise, c'est de résister, que l'art est politique et qu'il y avait un combat permanent à mener pour certaines valeurs. C'est plus que jamais le cas aujourd'hui. » Même ligne que le paternel, même inquiétude devant la progression des extrêmes.
MK2 c'est avant tout une vision artistique
« Mon seul projet éducatif était d'en faire des hommes responsables et respectueux, résume le père. Je déteste l'idée d'héritage, je voulais être certains qu'ils soient capables de prendre en charge notre mission, faire du cinéma certes, mais aussi avoir la responsabilité de 400 salariés. » Le test crucial est de se faire accepter par ceux qui depuis des années font MK2, les collaborateurs du patriarche, intrigués par la montée en puissance des fistons. « Pour cela, il fallait des actions réussies et non des actes d'autorité, dit Elisha. On a laissé le pouvoir à la programmation, on tient à cette particularité. »
« Je déteste l'idée d'héritage, je voulais être certains que mes fils soient capables de faire du cinéma mais aussi avoir la responsabilité de 400 salariés. »
Chez MK2, la sélection et la singularité cinématographiques priment sur la vente de confiseries, selon les jeunes patrons. Un père visionnaire, deux fils ambitieux, une fortune importante, un impact culturel indéniable... La saga Karmitz serait-elle une émanation française de la brillante et diabolique série américaine Succession ? Sourires des frères. Impensable de comparer leur père au surpuissant et cynique patron dépeint dans ce show télé inspiré de l'empire de Rupert Murdoch. « Nous sommes le fruit d'une succession, certes, mais réussie, sans drame, glisse Nathanaël. Nous n'avons pas besoin de tuer notre père, nous. » ■
1967 Marin Karmitz fonde MK2 Productions et, en 1974, il y adjoint une structure de distribution et de salles de cinéma. 108 films produits et plus de 350 distribués en salles, avec plus de 150 prix et nominations. 2023 Le chiffre d'affaires atteint les 100 millions d'euros. 11 salles de cinéma MK2 à Paris, avec des places à 4,90 euros pour les moins de 26 ans 470 salariés répartis entre la France et la filiale espagnole. 800 films appartiennent au catalogue MK2, dont les œuvres de François Truffaut, Charlie Chaplin et Jacques Demy. 300 conférences par an organisées par MK2 Institut.La dynastie Karmitz en quelques chiffres