
Les tensions internationales qui forcissent entre les États-Unis et la Chine, entre l'Occident et la Russie, entre l'Iran et ses voisins, entre la Turquie et la Grèce laissent planer une odeur de poudre qui s'étend à l'échelle planétaire.
Sur le plan national, les images quasi-insurrectionnelles des « Gilets Jaunes » vandalisant l'Arc de Triomphe, des blindés de la Gendarmerie sur les Champs-Élysées ont suscité dans les esprits l'idée d'une guerre civile larvée. Après deux années de « Blitzkrieg pandémique », ponctuées d'enfermements épisodiques, même la « libération » de l'été dernier avait un goût de juillet 14, ou d'août 39.
Un sentiment confus se diffuse dans l'atmosphère, selon lequel le monde serait devenu trop complexe, la politique trop enlisée dans de multiples contradictions, la société trop divisée contre elle-même pour qu'une formidable conflagration rédemptrice soit encore évitable.
Ainsi, en 1792, la déclaration de guerre de Louis XVI à son beau-frère, « roi de Bohème et de Hongrie », est vue par la plupart des observateurs et des acteurs de cette époque révolutionnaire (excepté Robespierre) comme la solution bienvenue des problèmes de politique intérieure. En 1830, nul ne sait si l'armée rassemblée va conquérir Alger ou mater les insurgés des Trente Glorieuses. En 1870, il s'agit de conforter l'Empire libéral et en 1914, de prendre enfin une revanche.
Dans toutes les têtes, dans toutes les conversations, une idée simple et barbare s'impose : la guerre est la seule solution évidente à tous les problèmes ! Qu'en est-il aujourd'hui ?
La guerre économique
Le concept est multiforme, depuis l'accompagnement des opérations militaires par des bombardements stratégiques jusqu'à la concurrence exacerbée, en temps de paix, entre entreprises rivales appartenant à un même système d'alliances, Airbus et Boeing, par exemple. Pour circonscrire le champ de réflexion, convenons qu'il n'y a de guerre économique, à proprement parler, qu'entre États ; et même dans cette acception, les situations sont rarement univoques...
Quelques précédents permettent de fixer les idées. Ainsi, le « blocus continental » décrété par Napoléon, en réponse au « blocus maritime » de la Royal Navy coûtera cher, politiquement, à la France, tout en affectant gravement l'économie anglaise.
A l'encontre de l'Italie mussolinienne pourtant hostile et méprisante vis-à-vis du régime hitlérien, les sanctions franco-britanniques à l'occasion de l'expédition en Éthiopie (comme si le Négus respectait le droit des Érythréens à disposer d'eux-mêmes et comme si le droit de la guerre avait été observé en 1896, à l'issue de la bataille d'Adwa !) ont seulement provoqué un dramatique basculement des alliances en faveur du III° Reich.
Le blocus énergétique du Japon déclaré en juillet 1941, déclenche l'attaque de Pearl Harbour, conçue comme l'opération de la dernière chance : contrairement à une idée reçue, le Blitzkrieg est la tactique du plus faible qui pense que le temps joue en sa défaveur : Hitler, comme Tojo, savaient qu'ils n'avaient une chance de l'emporter qu'en démoralisant l'adversaire, ignorant que depuis Athènes, les démocraties ont le goût de la guerre !
Exemple plus récent : l'embargo ciblé interdisait l'exportation d'équipements ou de produits « stratégiques » vers l'URSS et les pays du Pacte de Varsovie, en application du « Control Act » américain de 1949 et sous le contrôle d'une instance informelle, le COCOM.
Non sans de multiples dissensions entre alliés occidentaux, s'agissant notamment des infrastructures énergétiques (le « gazoduc sibérien » par exemple, projet russo-allemand), le dispositif étendu aux technologies à « double-usage » civilo-militaire a globalement fonctionné, ralentissant et compliquant les transferts de technologies vers l'Est, sans les stopper totalement et donnant lieu à diverses polémiques (Thomson CSF) voire scandales (Toshiba, pour la fourniture de machines-outils améliorant les performances des sous-marins soviétiques, provoquant la démission des dirigeants de Toshiba en 1987). Pour autant, l'application de l'embargo s'avéra, pour le moins, « à géométrie variable » : non seulement les transferts interdits vers « le bloc communiste » furent tolérés au profit de la Chine pour des motifs géopolitiques évidents, mais l'URSS elle-même bénéficia de dérogations : notamment, le cabinet Mac Kee fut autorisé à superviser la construction du « mega complexe » sidérurgique de Magnitogorsk à partir des plans d'entreprises américaines : le chemin de crête entre guerre économique et guerre militaire était parfois étroit.
L'éclatement de l'URSS et la dissolution du Pacte de Varsovie modifièrent apparemment la donne, conduisant à la mise en sommeil du COCOM lors des accords de Wassenaar de 1994.
Les sanctions qui frappent aujourd'hui la Russie, mais aussi l'Iran ainsi que dans une moindre mesure la Chine, s'inscrivent dans le prolongement de ce dispositif, mais interviennent dans un contexte du commerce international beaucoup plus complexe, caractérisé par la « globalisation » encouragée par les États-Unis, à la suite de la transformation du GATT en OMC en 1994, alors que le monde était dominé par la seule « hyperpuissance » américaine.
Deux conséquences majeures en découlent : d'une part, la capacité de rétorsion de la Russie en tant qu'« émirat énergétique et minier » alimentant, non les États-Unis, mais l'Europe Occidentale est décuplée, de telle sorte que toute politique de sanction, de par ses conséquences, introduit un clivage stratégique entre l'Europe et l'Amérique : la première en pâtit, la seconde en profite. Jusqu'à quand ?
La seconde conséquence est plus subtile : en promouvant la « globalisation » dans les années 1990/2010, les États-Unis ont accentué, non pas l'interdépendance prônée par la doctrine du multilatéralisme, mais la dépendance pure et simple des « périphéries » vis-à-vis du « centre » géopolitique, c'est-à-dire militaire.
La preuve en est apportée par les amendes acquittées par diverses entreprises européennes, parmi les plus performantes, pour des montants colossaux de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards de dollars ; le motif de l'infraction à la législation américaine : une transaction en dollars imputée à une filiale, ou la simple utilisation d'un serveur implanté aux États-Unis, pendant quelques secondes, à l'occasion d'une transaction interbancaire mobilisant le réseau SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
Ainsi, les alliés « périphériques » des États-Unis, piégés par le mirage de la « globalisation », ont à souffrir doublement des rétorsions exercées par les « cibles » géopolitiques : le gaz russe, le pétrole iranien, les « terres rares » chinoises qui n'affectent que marginalement la « puissance impériale » ; et complémentairement, les sanctions que celle-ci peut prononcer à l'encontre d'alliés récalcitrants, ou d'entreprises concurrentes de leurs propres intérêts économiques.
Non seulement la guerre économique est devenue une réalité, mais elle oppose, pour reprendre une expression hobbesienne, « tous contre tous ».
Qu'en est-il, dès lors, de l'« économie de guerre » ?
L'économie de guerre
L'effet essentiel et constant de l'économie de guerre est illustré par les « guerres d'Amérique » : le surendettement et la surfiscalisation, à l'origine de troubles sociaux ou, au minimum, d'hyperinflation et d'« euthanasie des rentiers ».
Au départ, la guerre de Sept Ans, remportée par l'Angleterre et la Prusse et perdue par la France de Louis XV qui enchaîne les désillusions après le traité d'Aix-la-Chapelle (« bête comme la paix ») à l'issue de la guerre de Succession d'Autriche dominée par la France (« qui s'est battue pour le roi de Prusse »), laisse les deux belligérants principaux, France et Angleterre, financièrement ruinés.
Tandis que Choiseul prépare la revanche, de concert avec Sartine, et que Turgot, Fleury, Calonne et Necker s'efforcent de maintenir les finances de l'État à flot, sans grand succès, le roi George, pour « éponger » les dettes de l'Angleterre, décide de taxer par le « Stamp Act » les treize colonies désormais exonérées de la menace française qu'elles ont longtemps combattue lors des « French-Indian Wars », George Washington lui-même, alors lieutenant-colonel, ayant enfreint les lois de la guerre en faisant mettre à mort ses prisonniers français par ses supplétifs indiens.
Cette décision du Parlement de Londres est vécue, outre-Atlantique, comme attentatoire aux « libertés anglaises » (« No taxation without representation ») et provoque l'insurrection des treize colonies qui finissent par obtenir l'appui de la France. Alors que celle-ci a réduit sa dette publique à 500 millions de livres, elle engage dans cette aventure plus de 1,3 million de livres et diverses dépenses induites qui portent, au total, la dette à 4 millions en 1789. Pour faire face à la banqueroute qui se profile, il faut réunir les États généraux du Royaume. La suite est connue. Les dettes de la guerre de Sept Ans auront provoqué deux révolutions, l'une engendrant l'indépendance américaine, l'autre la chute de la monarchie française, suivie par les guerres de Vendée, celles de la Révolution et de l'Empire.
Alors qu'en 1789, la dette publique de la France atteint 80% de son PIB et que 40% du budget de l'État royal sont consacrés à son service, les guerres napoléoniennes ne coûtent guère au pays puisqu'elles sont financées par les conquêtes. A contrario, la dette publique de l'Angleterre grimpe jusqu'à 275% du PIB ; la Banque d'Angleterre finance la Couronne grâce à la Royal Navy qui inspire confiance dans le commerce britannique. Mais après Waterloo, la France doit acquitter des indemnités de guerre pour un montant inédit de 700 millions de Francs-or, à comparer aux 100 millions imputés à la Prusse après Iéna et Auerstaedt. La France a pu remporter des batailles, mais n'a jamais su négocier la paix !
En 1870, Bismarck impose une indemnité de 5 milliards de Francs-or, qui serviront à financer le premier système de sécurité sociale, destiné à combattre l'idéologie socialiste. La France s'en acquitte assez aisément, non sans qu'une « longue dépression » ne s'ensuive, entre 1873 et 1896.
Vient la « der des ders » ! Le coût de la Grande Guerre est abyssal et pour la première fois de son histoire, la France découvre véritablement l'« économie de guerre », les restrictions, le rationnement alimentaire, la priorité donnée aux fabrications d'armement qui n'empêchent pas les grèves, en 1917, dans les arsenaux. La dette publique atteint alors 150% du PIB.
L'impôt sur le revenu, lointain avatar de la « Dîme royale » de Vauban, voit le jour en 1917, pour un taux marginal fort modeste de 2% qui atteindra 90% en 1924, sous le Cartel des Gauches, la fiscalité indirecte enregistre un progrès sensible avec l'institution d'une « taxe sur le chiffre d'affaires », ancêtre de la TVA, appelée à un grand avenir.
Au total, l'Angleterre est la seule puissance belligérante qui assure un effort fiscal immédiat en doublant le niveau de ses prélèvements obligatoires, portés de 15% à près de 30% du PIB. En revanche, la France privilégie l'émission monétaire, la « planche à billets » dont témoigne la composition de la masse monétaire dans laquelle les monnaies métalliques, du tiers à la veille du conflit, ne représentent plus que moins de 1% au jour de l'Armistice.
Ajoutons qu'à l'issue du conflit, l'Allemagne vaincue se verra imposer 132 milliards de marks de réparations, montant fortement abattu sur les instances anglo-saxonnes et dont elle n'acquittera finalement que 20 milliards dont moins de la moitié au profit de la France sinistrée ; a contrario, celle-ci devra acquitter « rubis sur l'ongle » les dettes qu'elle a contractées à l'égard de l'allié américain, effort qu'elle ne parviendra à assurer qu'au prix d'une inflation qui contraindra Poincaré à dévaluer de 80% le Franc germinal, réduisant d'autant l'influence internationale de la France à travers le poids de sa signature.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est en Allemagne, avec l'appui initial des banques américaines, en URSS avec le soutien du gouvernement américain et aux États-Unis eux-mêmes que l'effort de guerre fut le plus spectaculaire. En Allemagne, s'agissant d'« enterrer » les usines ; en URSS, en les transportant à l'Est ; aux États-Unis, en multipliant par dix, par vingt, par trente les fabrications du temps de paix : 100 000 avions, 50 000 chars, 1 000 destroyers, 250 navires de première ligne, dont 100 porte-avions mis en production en 1944 !
L'effort budgétaire atteint alors 35% du PIB et les dépenses militaires représentent 90% du budget fédéral. Le plan Marshall, à l'issue du conflit, offrira une opportunité exceptionnelle et vitale de transformation de l'« économie de guerre » dans des secteurs mieux adaptés à la société de consommation renaissante, mais il faudra attendre l'administration Kennedy pour connaître des baisses d'impôts proportionnellement plus importantes que celles survenues sous l'ère Reagan dans les années 80.
À cette aune-là, sommes-nous entrés dans une « économie de guerre » ? Évidemment non. Pour deux raisons.
La première tient au fait que les fabrications de guerre sont devenues extrêmement complexes : il ne s'agit plus d'industries lourdes, mais de chaînes d'assemblage de multiples composants importés, en dehors du périmètre de souveraineté de la nation ; la montée en puissance de l'outil industriel ne peut qu'être longue et, dans certains cas, inenvisageable.
La seconde résulte du niveau d'endettement souverain et de fiscalisation déjà atteint : l'« économie de guerre » est devenue la réalité d'une « économie de paix », de telle sorte qu'il n'existe plus guère de marge pour un effort supplémentaire, hors menace vitale justifiant un sursaut national actuellement hors d'atteinte d'un point de vue politique.
Ainsi, l'« économie de guerre » n'est pas un concept opérationnel, dans un contexte d'imbrication et de socialisation des économies à des niveaux historiquement inédits. Son effectivité ne pourrait résulter que d'une menace vitale, à l'issue d'une phase d'adaptation progressive.
En guise de conclusion...
Drôle de paix ? Mais aussi drôle de capitalisme de plus en plus imprégné d'État, et de moins en moins d'initiative entrepreneuriale, conformément au pronostic de Joseph Schumpeter.
La guerre économique est une réalité, entre pôles de puissance géopolitiques, mais aussi au sein de ces sous-ensembles, dans lesquels persistent à subsister des intérêts nationaux.
L'« économie de crise » en termes financiers et fiscaux produit déjà des effets économiques tangibles, qui pèsent sur l'avenir des sociétés ; au-delà, c'est la civilisation occidentale elle-même, à travers la confiance qu'elle inspire, qui se trouverait mise en cause : elle ne trouverait de réelle justification que si la défense du pays imposait une discipline martiale.
Qu'aurait pu dire Raymond Aron de notre époque ? Guerre de moins en moins improbable, paix de plus en plus impossible...

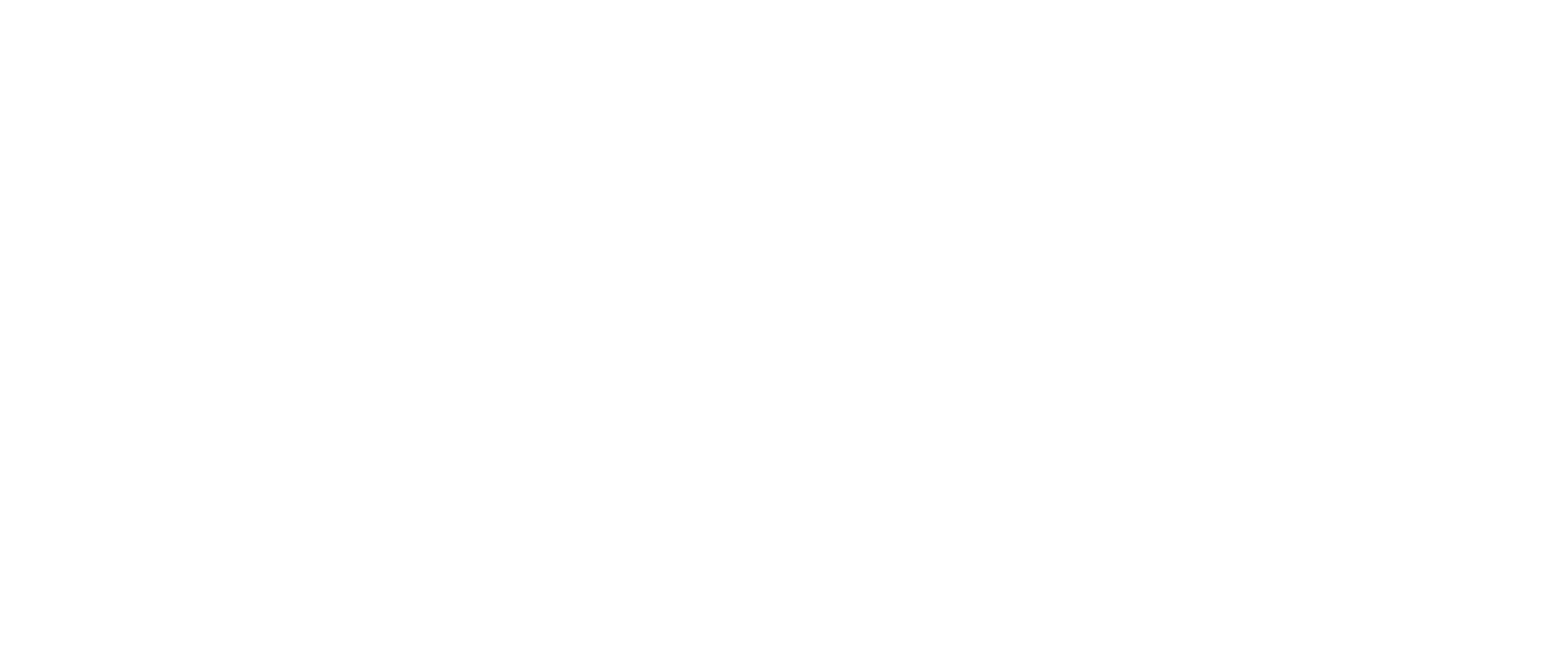
 Plan d'urbanisme à Paris : les professionnels dénoncent « une aberration », le premier adjoint d'Hidalgo leur répond
Plan d'urbanisme à Paris : les professionnels dénoncent « une aberration », le premier adjoint d'Hidalgo leur répond


Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !