Dérogeant à la règle habituelle qui veut que les films d'ouverture du festival sont des zakouskis plus ou moins légers, sans conséquence sur la compétition, Thierry Frémaux a tenu à faire concourir "Blindness", annoncé fin avril, une semaine après les autres élus (comme d'ailleurs celui de clôture). Après vision du film, on se demande ce qui a valu au film sa qualification car, s'il n'est pas léger (il est même parfois lourdingue), il n'a pas l'acuité des oeuvres habituellement en lice dans l'arène cannoise.
Venu de la pub et de la télévision, le réalisateur, le Brésilien Fernando Meirelles, n'est pas un inconnu au Festival. En 2002, il présentait à la section Un certain regard "La cité de Dieu", sur les favelas de Rio. Cinéaste à la fibre politique, il sait mobiliser l' "usine à rêves" hollywoodienne en faveur d'une cause humanitaire. Plus convainquant que "Blindness", "The Constant Gardener", son précédent, était dirigé contre les firmes pharmaceutiques, adaptation du roman éponyme de John Le Carré.
Cette fois, Meirelles porte à l'écran le roman éponyme publié en 1995 par le Portugais José Saramago, prix Nobel de littérature 1998. Mais l'écrivain a exigé que cette coproduction nippo-canado-brésilienne, dotée de moyens et du casting d'une superproduction internationale (en langue anglaise, cela va de soi), se déroule dans une ville et un pays impossibles à identifier, sans doute dans le but de donner plus de force au symbole.
Le problème, c'est que dans un film, l'image, par définition, doit parler d'elle-même. Le film se ressent de ce symbolisme abstrait et devient une fade digression sur la perte de sens moral dans une population frappée par une catastrophe. Le tout manque de percutant et baigne dans les bons sentiments, produit typique de world cinema passe-partout esthétisant, qui ne fait de mal à personne.
Cela débute plutôt bien, comme un film d'actions assez prenant. Dans une ville moderne qui peut être tout aussi bien Sao Paulo que Los Angeles, un homme au volant de sa voiture perd soudain la vue. Très vite, il apparaît que l'ophtalmo qui le soigne (Marc Ruffalo) ainsi que le "bon Samaritain" qui le raccompagne chez lui (et en profite pour lui voler sa voiture) sont frappés du même mal. Tous trois sont mis en quarantaine dans un hôpital désaffecté particulièrement sinistre, accompagnés de la femme du médecin (Julianne Moore) qui a gardé la vue mais tient à rester auprès de son mari.
De jour en jour, le nombre de contaminés grandit et les conditions d'hygiène deviennent critiques tandis que du haut des miradors des gardes armés veillent à ce qu'aucun malade ne s'échappe. A l'intérieur, la violence, l'appât du gain, les pulsions sexuelles, bref tous les mauvais penchants de l'humanité livrée à elle-même, prennent le dessus.
Qu'on se rassure, le cauchemar et l'anarchie ont une issue, sous la conduite de la femme du médecin qui mène la révolte et fait office de témoin. Le spectateur, lui, est mis dans la position - gênante - de voyeur devant des scènes qui comportent juste ce qu'il faut de suggestif pour attirer l'oeil sans être frappé de censure. Cela ne l'aide pas à y voir plus clair sur le sens de cette fable morale.
Vision trouble en ouverture du festival de Cannes
-
Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.

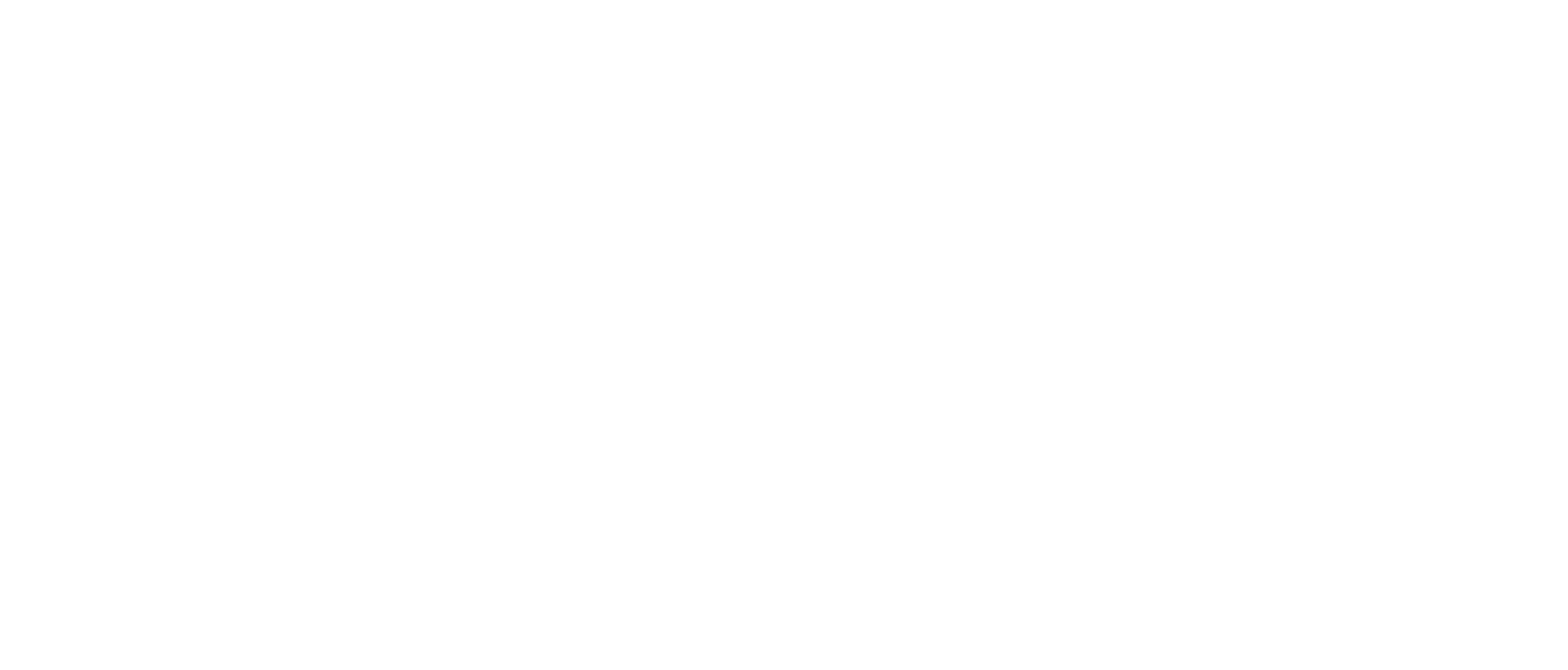

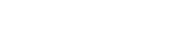
Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !