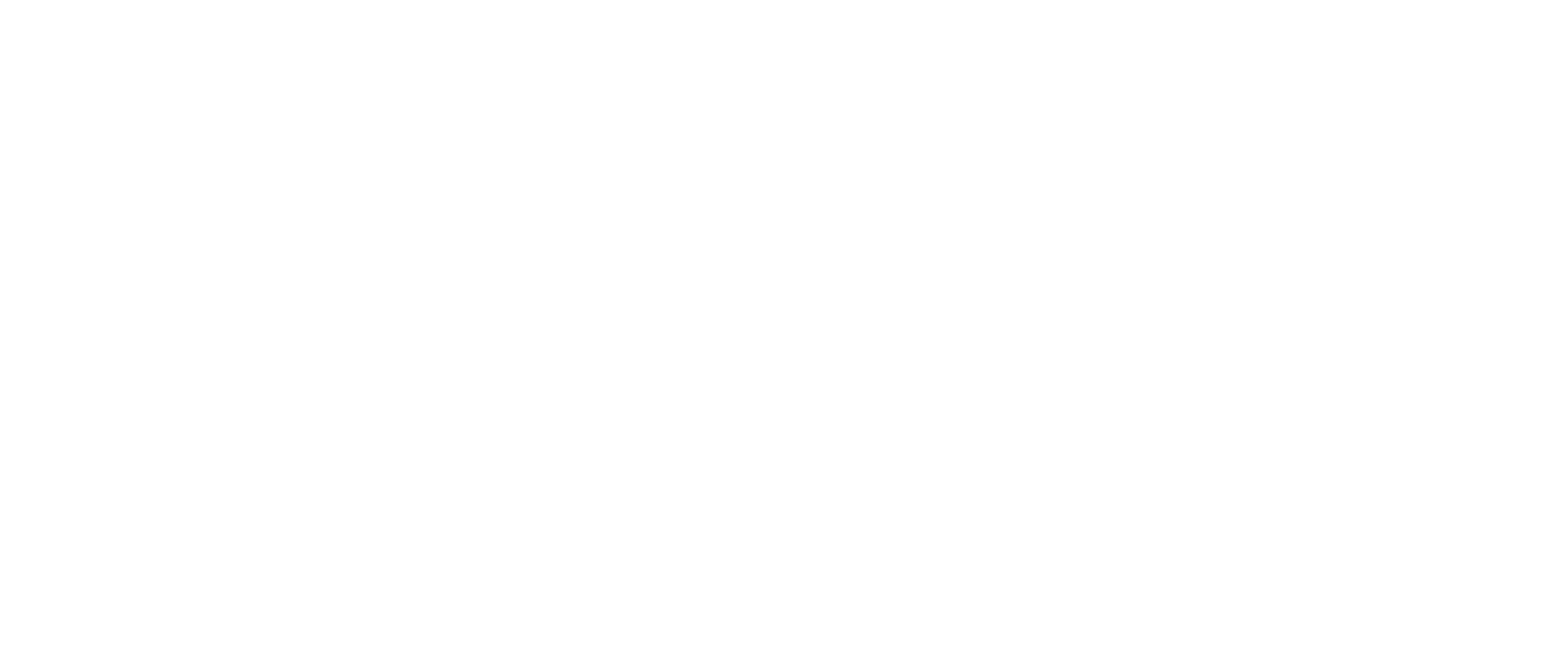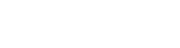LA TRIBUNE DIMANCHE - Vous partez en mission depuis vingt ans, comment êtes-vous revenu de celle que vous avez menée pendant un mois à l'hôpital Al Nasser de Khan Younès ?
FRANÇOIS JOURDEL - D'habitude, je ne témoigne pas après mes missions, je suis plutôt quelqu'un de discret. Mais là... Vous m'auriez posé cette question juste à mon retour, mi-décembre, je n'aurais pas trouvé les mots. Il m'a fallu le soutien de la psychologue de MSF pour verbaliser. J'ai soigné beaucoup d'adultes dans mes précédentes missions. Cette fois-ci, je suis secoué par le nombre d'enfants blessés, brûlés, amputés par arrachement des membres. C'est extrêmement choquant.
Pourquoi autant d'enfants sont-ils touchés ?
Il faut imaginer ces explosions permanentes. Parfois, il y en a 400, 500, en vingt-quatre heures. Quelquefois à moins d'un kilomètre de l'hôpital. On entend le sifflement, la déflagration, puis les blessés arrivent un quart d'heure plus tard. Ce ne sont pas des hommes en treillis avec une arme en bandoulière, mais des enfants qui étaient en train de jouer. Des femmes, des personnes déplacées, en train de cuisiner dans une maison, et d'un seul coup, elle s'effondre sur tout le monde. Les membres de la famille sont amenés les uns après les autres, les yeux grands ouverts et remplis de poussière parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les fermer. Ce sont des familles entières pulvérisées. Nos statistiques de blessés sont d'ailleurs comme un échantillon de la population. Je peux en témoigner, je l'ai vécu : 50 % des blessés ont moins de 18 ans, 25 % ont moins de 10 ans. Leurs fractures sont épouvantables.
En quoi ces blessures sont-elles épouvantables ?
En chirurgie de guerre, les patients souffrent de plaies par balle ou par explosif. Ce sont des fractures ouvertes avec des pertes de substances, il y a un trou au niveau de la fracture. Ce qui est dramatique dans ce conflit, c'est le nombre de ces blessés qu'il faut soigner en même temps. En France, chacun de ces patients nécessiterait à lui seul un mois de traitement dans un service d'orthopédie, pour le passer au bloc tous les deux jours, surveiller l'infection, faire des prélèvements pour déterminer quels germes se développent dans le foyer de fracture, changer régulièrement les pansements en utilisant des pansements VAC, aspiratifs, qui permettent de soigner des plaies difficiles à cicatriser. Évidemment, on n'en avait pas à Gaza.

Le docteur François Jourdel opérant pendant une coupure d'électricité, à la lueur de lampes torches.
Comment pouvez-vous alors les soigner ?
On arrive encore à faire les premiers soins, ce qu'on appelle le damage control en anglais. On met un fixateur externe, des broches en dessous et au-dessus du foyer de fracture. Ensuite, il faut trouver une solution pour couvrir l'os, les articulations ouvertes et les tendons exposés - c'est mon travail en tant que chirurgien orthopédiste plastique. Mais le problème est qu'une fois que vous avez mis ce fixateur externe, vous avez très vite d'autres patients qui arrivent, puis d'autres, et d'autres encore. Quand on sait qu'on ne va pas pouvoir les suivre avec ces traitements très longs, il vaut mieux préférer la solution plus radicale d'une amputation.
Vous avez donc dû amputer parce que vous saviez que vous n'auriez pas les moyens de suivre correctement les patients ?
Oui, parce qu'avec une amputation les soins sont plus courts et les risques d'infection moins nombreux. Parfois, des chirurgiens palestiniens voulaient tenter de sauver des membres. Mais j'essayais de leur faire comprendre : « Est-ce qu'on va vraiment pouvoir suivre ce blessé ensuite ? Ça va être effroyable si on ne l'ampute pas maintenant, si on ne peut pas assumer de changer ses pansements tous les deux jours pendant des mois... » Un soir, une fillette de 8-10 ans avait été opérée par un des chirurgiens orthopédistes pour deux terribles fractures ouvertes. Ses deux jambes avaient probablement été écrasées par une dalle lors d'un bombardement. Un des chirurgiens m'a demandé si cela ne me dérangerait pas d'aller voir les pansements en réanimation. Je me suis aperçu que les deux jambes étaient en fait en ischémie, c'est‑à-dire complètement dévascularisées. Il fallait l'amputer. J'ai demandé au bloc à ce qu'elle soit opérée le soir même. « On en a déjà quinze, on n'arrivera pas à la passer aujourd'hui », m'a répondu mon collègue. Le lendemain, elle a été victime d'une défaillance polyviscérale. Son état s'est dégradé très rapidement, elle a chuté. Elle n'a pas survécu.
La fillette est décédée à cause du crush syndrome, le syndrome des membres écrasés ?
Le crush syndrome survient au moment de l'accident, du bombardement, du tremblement de terre. Quand vous dégagez un corps enseveli sous des décombres, les jambes peuvent se revasculariser mais ce n'est pas forcément très bon. C'est ce qu'on appelait « la mort souriante » à Haïti [lors du tremblement de terre de 2010, qui a fait plus de 220 000 morts]. Les personnes sont contentes d'être sorties des gravats. Mais à ce moment-là, en fait, les jambes dégagées peuvent commencer à se revasculariser. Elles envoient alors dans le sang les toxines du muscle écrasé et en partie détruit, comme du potassium. Cela provoque des défaillances hépatiques et entraîne un arrêt cardiaque. La fillette palestinienne aurait dû être amputée tout de suite. Mais on ne peut pas imaginer le contexte. On ne connaît pas ça en Europe.
C'est‑à-dire ?
D'un seul coup, vous voyez arriver 50, 60, 70 personnes grièvement blessées ou mortes dans un même hôpital. En métropole, on a vécu ça pour le Bataclan [les attentats de novembre 2015]. Tous les hôpitaux parisiens se sont mobilisés pour gérer les nombreux blessés, et pourtant ça a été très dur. À Gaza, il faut imaginer que vous viviez cela, mais dans un seul hôpital, qui manque en plus de moyens. Le nombre de blessés qui arrivent en même temps est ahurissant. Un soir, d'ailleurs, j'ai perdu pied.
Vous avez perdu pied ? Que voulez-vous dire par là ?
Ce soir-là, je venais de finir ma journée de dix opérations. Je sors du bloc et je traverse la petite rue pour aller voir mes collègues réanimateurs et anesthésistes. Et là, j'entends un sifflement et une déflagration à côté de l'hôpital. Des alarmes rugissent. Ce n'est pas comme en Europe où tous les blessés sont emmenés en ambulance ; là, ils arrivent dans des voitures, des charrettes avec des ânes au galop, des Palestiniens terrifiés en transportent aussi eux-mêmes dans leur bras. Je vais aux urgences pour essayer de me rendre utile, et là où j'ai presque un étourdissement. Je suis chirurgien, pas réanimateur ; voir autant de blessés en même temps, certains jetés par terre parce qu'il n'y a pas assez de lits... J'ai vu un enfant, les yeux grands ouverts en mydriase, c'est‑à-dire avec les pupilles dilatées, la poussière sur les yeux. J'ai pris son pouls mais je savais qu'il était mort. Et un deuxième enfant a été amené à côté, une fille, sa sœur, morte aussi. J'ai alors aperçu le père qui me regardait, désemparé. Il portait un autre de ses enfants dans les bras, mort. Et juste après, c'était sa femme, décédée aussi.
Ça ne vous est jamais arrivé d'être dans cet état en mission ?
Quand je pars en mission, je m'occupe de la chirurgie orthopédiste plastique. Je sais soigner des patients avec des plaies et des fractures ouvertes. Devant le nombre de Palestiniens blessés dont personne ne s'occupait parce que mes collègues se débattaient déjà pour tenter de réanimer des personnes, ce n'est pas évident... Je me suis retrouvé comme le père devant ses enfants morts sans pouvoir trouver les mots pour adoucir un peu sa souffrance. On a envie de lui dire « reste solide, il y a le reste de ta famille qu'il faut soutenir ». Mais en fait, toute sa famille est décimée, et puis il y a la barrière de la langue. Le père vous regarde, il essaie de lire dans vos yeux. Je ne sais pas comment vous dire... Il y a des cris, des hurlements. Le terme de mass casualties en anglais veut bien dire ce que cela veut dire, « victimes en masse ».
Comment vont vos collègues palestiniens ?
Ils sont exténués, on les sent désespérés. Mais quand on leur demande le matin comment ils vont, ils vous répondent : « Je suis content d'être vivant. » C'est vrai qu'à Gaza aujourd'hui on est content de se réveiller en vie. Des personnels perdaient des membres de leur famille régulièrement mais ils venaient travailler. Un jour, un infirmier anesthésiste est arrivé criblé d'éclats de pierre. En explosant, les bombes projettent des éclats de ciment qui traversent la peau et sont difficiles à retirer. Mais l'infirmier est tout de même venu à l'hôpital. J'ai été impressionné par eux. Ils sont d'un courage infini, d'une résilience qui force l'admiration.
Propos recueillis par Garance Le Caisne