« La Tribune ». - Peut-on raisonnablement tabler sur une reprise économique en Europe au second semestre ? Daniel Janssen. - L'économie européenne, qui avait bien redémarré fin 1994 et début 1995, a surstocké. Il s'est ensuivi une période de réduction des stocks et de ralentissement très marqué de la conjoncture jusqu'au début de 1996. Après avoir touché un point bas en décembre, l'économie semble à présent engagée dans un très lent processus de redémarrage. Cette tendance est plus nette en Italie, modérée en France et plus faible en Allemagne. Je ne suis pas du tout pessimiste, mais plein d'incertitude quant à l'évolution à attendre au second semestre en Europe. Par contraste, la conjoncture nord-américaine et asiatique, y compris au Japon, est très soutenue. Quelle est la marche de votre groupe dans ce contexte ? Solvay a cinq secteurs, dont un vraiment dépendant des cycles de la conjoncture, les plastiques. Si les quatre premiers, les alcalis, les peroxydés, la transformation des matières plastiques et la santé, se comportent raisonnablement bien, même mieux qu'en 1995, les plastiques, qui reflètent l'état du cycle de l'économie européenne, ont souffert en décembre, mais leur situation s'améliore progressivement. Comme nous l'avons indiqué lors de l'assemblée générale du 6 juin, nous espérons enregistrer des résultats 1996 voisins de ceux de 1995 (Ndlr : 12,5 milliards de francs belges de résultat net, soit 2 milliards de francs), voire légèrement supérieurs si la conjoncture européenne s'améliore dans la seconde moitié de l'année. Après un mois de décembre très mauvais, nous constatons de mois en mois un progrès régulier. Les chimistes multiplient les projets d'investissements en Asie. Quelle est votre politique dans cette zone ? Nous travaillons beaucoup sur le rééquilibrage géographique de notre portefeuille. Il y a dix ans, le groupe réalisait 80 % de son chiffre d'affaires en Europe. Nous avons alors décidé d'accélérer son internationalisation, en nous développant de façon continue en Amérique et encore plus rapidement en Asie. L'Europe ne pèse plus que 67 % du chiffre d'affaires, alors que l'Amérique du Nord représente 20 %, l'Amérique du Sud, essentiellement le Mercosur, 5 %, et l'Asie-Pacifique 5 %. La logique voudrait que cette répartition reflète le PNB de chacun des trois continents, soit 50 % en Europe, un quart en Asie et le solde dans les Amériques. La Chine figure depuis un an sur la liste de nos priorités d'implantations. Nous y détenons déjà deux sociétés en joint-venture. Trois autres projets sont en cours de négociation. Vous défendez depuis de nombreuses années le concept de mondialisation à travers vos participations aux travaux de l'ERT (European Round Table) ou de la Commission trilatérale. Ce concept, qui a fait l'objet du dernier sommet du G7, est actuellement remis en question. Comment analysez-vous ces réactions ? La mondialisation est un processus irréversible. Ce mouvement a commencé il y a une trentaine d'années, mais la plupart des gens ne s'en était pas rendu compte. J'ai été l'un des cent fondateurs du Club de Rome, en 1968, et, à l'époque, nous parlions d'une seule terre, d'une seule planète, d'une seule économie mondiale. Mais ce n'est vraiment que depuis la conclusion des dernières négociations du Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade), avec la création de l'OMC (Organisation mondiale du commerce), que les populations ont commencé à comprendre que le temps du protectionnisme était dépassé et que l'économie de marché se répandait partout, y compris dans les anciens pays communistes comme la Russie ou la Chine. Ce changement est évidemment majeur sur le plan économique, mais au moins autant, sinon plus, sur le plan social. Cela signifie, par exemple, que les pays en voie de développement, que l'on appelle maintenant les marchés émergents, ont toutes leurs chances pour ne plus être pauvres et avoir accès aux marchés riches. Cette évolution me semble juste, mais entraîne des conséquences sociopolitiques sérieuses pour l'Europe notamment. Nous devons être capables d'affronter la concurrence internationale, et donc être mondialement compétitifs. Pour le moment, ce changement fondamental est ressenti avec incertitude et inquiétude en Europe. N'avez-vous pas l'impression d'avoir joué aux apprentis sorciers, d'avoir été dépassés par ce mouvement ? Ce ne sont pas les hommes d'affaires qui ont décidé d'abattre les barrières protectionnistes. Cette décision appartient aux politiques, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe. Ils l'ont décidé parce qu'ils ont vu que le protectionnisme, dans les années 30, avait finalement conduit à la dépression, alors que l'ouverture des marchés génère la croissance. Mais sur une période longue et non sans heurts à court terme. En ce moment, nous vivons en Europe les heurts de la période courte. Il faut maintenant que nous devenions plus compétitifs de ce côté-ci de l'Atlantique, tout en conservant un modèle social européen, auquel nous tenons, qui consiste à protéger les faibles. Peut-on espérer devenir plus compétitifs tout en maintenant un modèle social ? Je n'ai pas dit qu'il s'agissait de maintenir l'ancien modèle social européen. Il est voué à l'évolution parce que, encore récemment, ce système consistait à protéger tout le monde à l'excès, et non pas simplement les faibles. Evidemment c'est trop coûteux et cela donne parfois naissance à des mentalités d'assistés et non pas à des mentalités d'entrepreneurs et d'innovateurs, dont l'Europe a besoin. Nous sommes en plein changement, d'où l'accumulation de difficultés politiques, économiques et sociales. Il faudrait donc, selon vous, instituer un système social à deux vitesses ? Les systèmes de protection sociale dans la plupart des pays européens ont été créés juste après la guerre, beaucoup plus tard, d'ailleurs, que chez Solvay, puisque mon ancêtre Ernest Solvay avait institué une sécurité sociale complète au sein du groupe dès 1903 ! Dans les années 1946-1947, la population européenne était très pauvre, on a mis sur pied un système juste et généreux pour assurer une couverture sociale à tout un chacun. Peu à peu, au fil du fabuleux enrichissement de ces cinquante dernières années, on a, selon le même modèle, distribué de plus en plus. Nous avons maintenant des populations qui jouissent de niveaux de vie parmi les plus élevés du monde, sans que leur système de protection ne change. C'est absurde. Il est certain qu'il faut beaucoup moins protéger les risques mineurs de gens opulents et beaucoup mieux protéger, plus qu'on ne le fait maintenant, les grands risques pour tout le monde. Et encore plus pour les personnes démunies. Sous peine de faire éclater le système, une évolution des principes de base est nécessaire, rapide, mais à négocier. Comment l'Europe peut-elle devenir plus compétitive ? Il est essentiel de comprendre que, dans la situation actuelle de l'Europe, la compétitivité est la clé de la croissance et de l'emploi. D'où l'importance de placer cette notion de compétitivité au coeur de tutes les réflexions sociopolitiques et économiques européennes. Sinon, nous ne redresserons pas l'emploi et l'Europe entrera en régression. Or je suis persuadé que le Vieux Continent a tout ce qu'il faut pour constituer une zone d'opulence encore plus forte. Pour cela, il faut résolument augmenter une compétitivité très inférieure à celle des Etats-Unis. En 1994, nous étions dans la situation des Etats-Unis en 1981. Nous nous demandons aujourd'hui si notre industrie a encore un avenir. Il y a quinze ans, les Américains s'interrogeaient sur la survie de leurs constructeurs d'automobiles ; depuis, ils sont redevenus compétitifs, et en qualité et en prix. L'Europe peut fournir cet effort, elle a commencé à le faire, mais il faut aller plus vite et plus fort. Que préconisez-vous pour atteindre ce résultat ? Il faut d'abord beaucoup innover, en termes de services comme de produits. Les 400 millions de consommateurs européens les réclament. Il faut ensuite harmoniser les coûts salariaux et surtout ne pas les surtaxer, que ce soit au niveau fiscal ou parafiscal. Nous souffrons également d'un surcoût des prix de l'énergie, de l'ordre de 30 % par rapport à ceux des Etats-Unis. Pour parvenir à une baisse des prix, il faut accélérer le mouvement de libéralisation de l'énergie en Europe. Un autre point fondamental porte sur la formation des hommes. Nous devons construire une société de la connaissance au sein de laquelle les établissements d'enseignement, de l'école au lycée, de l'enseignement technique à l'université, soient beaucoup plus axés sur l'innovation et le progrès et sur la capacité à travailler en équipe. Le débat sur l'union monétaire et les critères de Maastricht est vif. Quelle est votre position sur la mise en oeuvre de l'euro ? Pour moi il n'y a pas de doute. L'euro doit entrer en service au 1er janvier 1999. Dans un groupe comme le nôtre, nous tablons déjà sur ce fait comme étant une certitude, et tous nos services s'y préparent. Mais on a raison de vouloir que l'euro soit une monnaie qui donne confiance, au même titre que le deutsche mark a donné confiance en l'Allemagne depuis une trentaine d'années. Cela implique le respect du calendrier de l'euro, avec la participation au système des quelques pays qui sont capables de le faire, et l'opportunité pour les pays de la périphérie européenne de rejoindre ce club le plus vite possible, dès qu'ils auront remis leur maison en ordre. Ensuite, une politique monétaire rigoureuse doit être menée pour que cette monnaie européenne puisse rivaliser avec le dollar par exemple. Et cela même si une politique de monnaie forte a un coût social ou un effet néfaste sur la croissance ? Je ne suis pas de cet avis. Depuis des années en Europe, les pays qui se sont bien développés sont ceux qui ont suivi une politique de monnaie forte. L'Allemagne, la France et le Benelux sont de loin les plus riches d'Europe, et il ne faut pas oublier que, depuis dix ans, leurs monnaies se tiennent à parité, y compris à travers des crises incroyables. La Belgique connaît depuis plusieurs mois une succession de conflits dans les services publics. Estimez-vous qu'une réforme s'impose ? Cette réforme est indispensable à l'amélioration de la compétitivité européenne. Nous devons tous, partout, supprimer les bureaucraties, qu'elles soient dans le secteur public ou privé, et améliorer les services au consommateur, une fois encore qu'ils soient publics ou privés. Mais l'adaptation sera plus difficile pour les personnes qui travaillent dans le secteur public, car ceux qui relèvent du secteur privé ont l'habitude de la concurrence et des restructurations. Prenons le cas, dans toute l'Europe, des chemins de fer. Il y a cinquante ans, le groupe Solvay faisait transiter environ 60 % de son fret européen par le rail ; aujourd'hui, ce chiffre est de 5 %, presque tout le reste voyage par camion. Aux Etats-Unis, nous utilisons à 15 % le réseau ferré. Le train y est prodigieusement efficace, beaucoup plus rapide. Cela nous permet de fabriquer des produits pondéreux à Houston et de les vendre à 5.000 km de là. En Europe, c'est inconcevable. Propos recueillis par Florence Bauchard et Christian David RELANCES : « Il faut placer la notion de compétitivité au coeur de toutes les réflexions sociopolitiques et économiques européennes. Sinon, nous ne redresserons pas l'emploi et l'Europe entrera en régression. » « Nous devons tous, partout, supprimer les bureaucraties, qu'elles soient dans le secteur public ou privé, et améliorer les services au consommateur, une fois encore qu'ils soient publics ou privés. »
Daniel Janssen, président de Solvay, « L'Europe est engagée dans un lent processus de redémarrage »
-
Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.

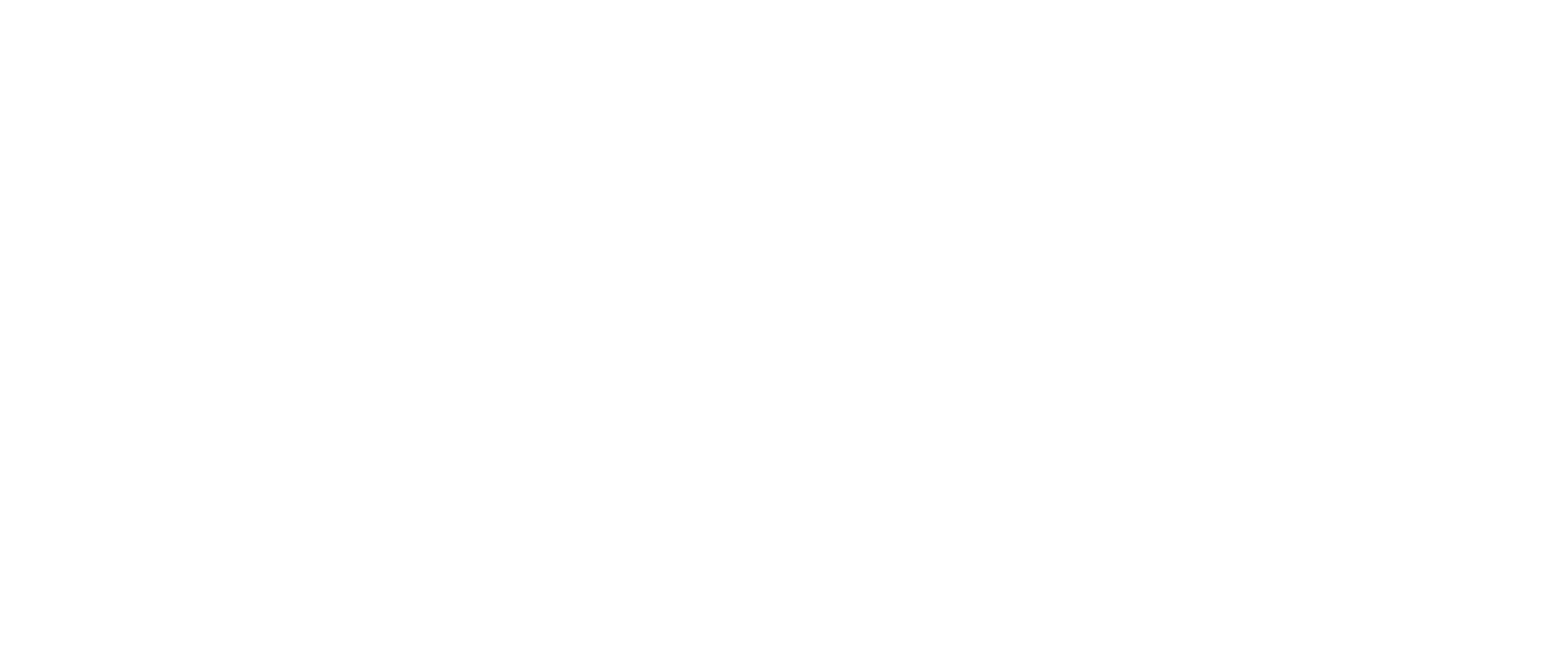


Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !