
LA TRIBUNE - N'est-il pas paradoxal pour un youtubeur qui s'attache à vulgariser avec succès l'économie de publier un livre d'initiation à l'économie ?
GILLES MITTEAU - Je dois dire qu'il s'agit d'abord d'une commande de l'éditeur. Je ne l'aurais pas fait spontanément, étant plus à l'aise à l'oral. Mais j'avais tellement de vidéos que je pouvais extraire de quoi fournir les connaissances de base pour comprendre comment fonctionne l'économie. Ayant passé énormément de temps à lire des manuels dont les formulations sont souvent alambiquées, je voulais que le propos soit clair.
Vous prenez soin d'expliquer comment fonctionne la finance, notamment la création de la monnaie. L'une des critiques courantes à l'égard des marchés financiers est la déconnexion d'avec l'économie réelle. Qu'en pensez-vous ?
Évidemment, lorsque des États émettent des obligations et des entreprises des obligations ou des actions, c'est pour se financer et investir. Mais sur les marchés financiers, notamment sur le marché secondaire, les acteurs cherchent en priorité à acheter le produit financier qui va prendre de la valeur. Ils ne s'intéressent donc pas au projet qui va développer l'économie réelle mais plutôt au projet qui sera choisi par le plus grand nombre, et dont le prix sera orienté à la hausse. Cette recherche exclusive de la valeur devient une démarche auto-référentielle, qui d'ailleurs explique en partie la formation de bulles spéculatives. Car même si le produit n'a pas été vendu et une plus-value réalisée, la performance donne droit à une réelle rémunération pour le financier à qui vous avez confié votre épargne. C'est ce que l'on appelle le bonus dans les salles de marché.
Quelle pourrait être la solution à ce problème ?
Elle pourrait consister à fixer le prix d'un actif une seule fois par jour en fonction de l'offre et de la demande, ce qui réduirait considérablement le nombre de transactions et la construction d'une valeur fictive. C'est d'ailleurs un problème qui se pose aussi pour les banques, qui comptent sur ces gains potentiels pour afficher de meilleurs bilans. Si corréler leur rémunération avec une performance réelle est intéressant, la corréler avec une performance spéculative est très problématique.
Le marché ne joue donc plus son rôle de fixation des prix ?
La fonction du marché c'est d'agréger une diversité d'analyses sur la valeur future d'une entreprise, car c'est tellement compliqué de le faire qu'on ne demande pas à une seule personne mais à une foule de cerveaux interconnectés. C'est d'autant plus pertinent que des experts passent énormément de temps à produire ces analyses. Mais quand certains d'entre eux passent leur temps à tenter de deviner ce que va faire l'autre, la « vraie valeur », si tant est que ce concept ait un sens, ne peut pas émerger.
Votre analyse macro-économique de la croissance met davantage l'accent sur l'utilisation de l'énergie que sur l'innovation, pourquoi ?
Vous faites référence au modèle de Sollow, qui fonde la croissance sur un facteur d'innovation qu'il met au sommet. Je préfère prendre la base, où se trouve l'énergie. En effet, l'innovation technologique ne fonctionne que si on a une source d'énergie. Par ailleurs, ce n'est pas tant elle que sa quantité qui est le facteur important. Ce qui motive d'abord les constructeurs de smartphones qui innovent pour produire l'appareil le plus fin et le plus léger, c'est de le vendre à l'échelle mondiale, ce qui nécessite une quantité titanesque d'énergie pour produire un tel volume. Le facteur bloquant et le plus important se trouve là.
Et aujourd'hui la nécessité de réduire les émissions de CO2 émises en large part par la combustion des énergies fossiles met une contrainte ?
Absolument. Dans mon livre, j'établis un constat sur la situation actuelle. Tout le discours sur l'innovation porte sur le futur, donc sur l'inconnu, l'incertain, et souvent le vœu pieux. En revanche, si on place le PIB sur un axe et la quantité d'énergie consommée sur l'autre axe, on voit apparaître une droite. Autrement dit, la croissance est étroitement dépendante de la capacité à utiliser une énergie bon marché, disponible, stockable... ce que les énergies fossiles fournissent !
De plus, si l'on prend par exemple le cas des automobiles, la consommation de carburant depuis leur apparition n'a fait qu'augmenter malgré les efforts d'innovation des constructeurs pour la réduire. À chaque fois qu'un progrès technologique réduit la consommation d'un moteur de 10%, cela incite les constructeurs à produire des modèles plus lourds et les gens à acheter plus de voitures. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Le métro parisien a été construit pour désengorger la circulation dans Paris qui était surchargée en raison du nombre de carrioles et de chevaux. Faire circuler les gens sous terre était une idée. Innovante à l'époque. Le métro comptait 2 lignes lors de son inauguration pour l'exposition universelle de 1900. Or, que constate-t-on quelques années plus tard ? Les rues sont toujours aussi bondées. En fait, le métro a créé un nouvel usage du transport là où auparavant les gens restaient chez eux ou aux alentours.
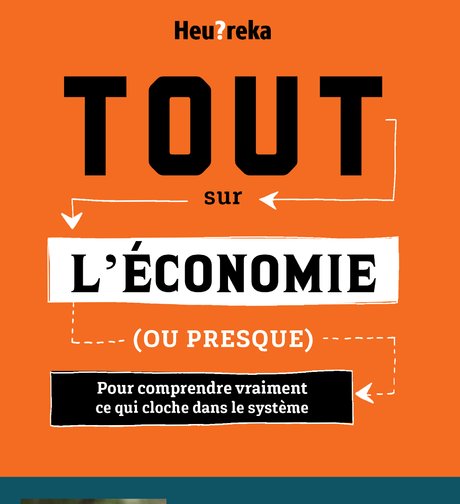
L'innovation crée de nouveaux désirs, de nouveaux marchés mais aussi de nouvelles externalités ?
Oui, et ces nouveaux modes de consommation génèrent des nuisances. Chaque fois, on dit que l'innovation génère moins de pollution « toutes choses égales par ailleurs ». Le problème c'est que ce n'est jamais « toutes choses égales par ailleurs ».
Votre point de vue perce-t-il au sein du courant économique mainstream ?
Si on considère l'attribution du dernier prix « Nobel » d'économie à des chercheurs pour leurs travaux théoriques sur les enchères, cela ne me semble pas aller dans le bon sens puisque ce prix est censé récompenser ceux qui, au sein de la science économique, apportent « le plus grand bénéfice à l'humanité ». J'aurais préféré que soient distingués des économistes qui travaillent sur l'environnement, le climat, les inégalités, etc. Néanmoins, depuis la crise financière de 2008, certaines idées sont remises en cause. Des économistes bifurquent comme Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, longtemps défenseur du « consensus de Washington ». Mais cela reste insuffisant pour peser.
Dans votre postface, vous considérez que la pandémie va rebattre les cartes ? Pensez-vous qu'elle va accélérer la transition énergétique et écologique ? Cette prise de conscience vous rend-elle optimiste ?
J'ai un sentiment mitigé. Certes, la pandémie remet sur le devant de la scène des sujets importants : la dette publique, la monnaie, le financement de la politique de relance, etc. Cela déconstruit les discours du type : « Il n'y pas d'alternative », « il n'y a pas d'argent magique », qui selon moi contraignent les décisions politiques. Car on s'aperçoit qu'il n'y a pas autre chose que de l'argent magique, contrairement à ce qui avait été martelé jusqu'alors. Cela change la vision politique des citoyens, et en conséquence le discours des politiciens qui doivent s'adapter s'ils veulent être élus. Cela va dans le bon sens. Car pour le moment, leur réponse à la lutte contre le réchauffement climatique a été : oui, mais ça coûte cher. Pourtant, quand on analyse en détail le plan de relance européen, on ne voit pas de véritables avancées innovantes, ce sont malgré tout toujours les mêmes outils du passé.
Vous critiquez l'approche néoclassique et néolibérale, comment définiriez-vous votre position ?
Je me définirais comme post-keynésien. En effet, ce qui me gêne dans la théorie néoclassique, c'est qu'elle prend comme point de départ un constat alternatif de la situation présente. Elle établit une courbe de l'offre, une courbe de la demande, et détermine un point d'équilibre. On n'a pourtant jamais vu empiriquement une courbe de la demande et on sait que la courbe de l'offre n'a pas la forme présentée par la théorie.
Celle-ci affirme également que l'objectif de nos sociétés doit être la croissance du PIB. On n'a pourtant jamais demandé à la population si la croissance de la production était son idéal de société. La théorie néoclassique est une construction philosophico-mathématique normative qui, non-contente de ne pas décrire la réalité des mécanismes économiques, porte en elle une idéologie politique : celle de la croissance.
Je comprends que l'on puisse construire des modèles mathématiques sur cette vision alternative qui, à défaut d'être descriptive, peut être utile dans certains cas pour faire des prédictions. Cela dit, quand on parle à la population de la réalité de leur situation et des choix qui s'offrent à eux, les modèles néoclassiques n'ont plus aucun sens.
En revanche, en partant de descriptions réalistes du fonctionnement de nos institutions, de la création de la monnaie, de l'organisation des marchés financiers, du financement des États, ce que font les post-keynésiens, il est à mon avis possible d'organiser un véritable débat démocratique sur ce que nous souhaitons voir changer dans notre organisation économique. Poser les bases de ce débat, c'est ce que j'ai voulu faire dans mon livre.
Ce qui nécessite des changements ?
C'est la question dans laquelle on se perd. Comment faire l'ajustement ? Qu'est-ce que cela va provoquer ? Car, pour atteindre un objectif, on doit modifier certaines variables mais si on ignore comment la société va réagir, on peut tout à fait le rater. Évidemment, certains changements sont plus faciles à prévoir. Si la Banque centrale est autorisée à financer directement des projets visant à réaliser une transition écologique et énergétique, cela a de grandes chances de simplement accélérer cette transition. En revanche, si on fixe un salaire maximal à X euros, en taxant à 100% tout ce qui le dépasse, il est plus difficile de prédire les conséquences. Cependant, je crois qu'il ne faut pas s'interdire de penser des changements du simple fait que leurs conséquences sont inconnues. L'abolition de l'esclavage a été justifiée au nom de l'éthique et de l'égalité sans se préoccuper des conséquences sur l'économie. Aujourd'hui, c'est un acquis sur lequel il est impensable de revenir.
Face aux incertitudes inhérentes à tout choix, deux approches s'opposent. La première a tendance à se noyer dans la complexité en essayant de mesurer toutes les conséquences, ce qui conduit à freiner l'action. La deuxième justifie un objectif d'un point de vue moral et politique, et adapte les variables pour l'atteindre. Dans tous les cas, je pense qu'il faut toujours garder en tête l'objectif final. L'énergie nucléaire est aujourd'hui un bon exemple. Ceux qui en défendent son développement avancent que si l'objectif est de réduire les émissions de CO2, tout en ayant suffisamment d'énergie pour conserver notre niveau de vie, le nucléaire est une bonne option. L'autre camp explique que, l'Homme faisant toujours des erreurs, le développement d'une industrie qui rend toute une zone inhabitable pendant des décennies en cas d'accident est une mauvaise idée. À chacun de juger. Mais il faut poser la question de l'objectif : voulons-nous combattre le réchauffement climatique en minimisant l'impact sur notre niveau de vie ? Ou voulons-nous un monde sans aucun risque d'accidents nucléaires ?
Dans votre livre, vous mettez l'accent sur la fiscalité comme levier pour agir sur l'organisation économique...
Certes, l'impôt n'est pas l'unique réponse à nos problèmes. La régulation et la norme sont également de puissants leviers d'action. Cependant, l'impôt permet de limiter sans complètement interdire. L'impôt doit être transparent et juste mais, dans une société qui se donne un objectif clair, la contrainte qu'il impose est normale. On ne peut pas et fixer un objectif et ne pas contraindre certaines libertés d'action qui sont en contradiction avec l'atteinte de ce dernier.
Ce qui n'est pas très populaire...
Certes, mais prenons l'exemple des services publics. Les gens se plaignent de leur dégradation et de leur disparition. L'une des causes de cette situation est la faiblesse des salaires - peu attractifs - et la faible capacité d'investissement. Or, comment est financé le service public ? Par l'impôt. Si on veut moins de fiscalité, il faut comprendre que cela signifie aussi une moins bonne rémunération des infirmières. Les dépenses des uns, sont les revenus des autres. Tout est connecté. L'autre solution serait de reconnaître qu'il est normal que l'État soit en déficit structurel pour qu'il puisse constamment investir, améliorer et valoriser son service public. Mais, affirmer que l'on veut et moins d'impôts et plus de services publics et moins de déficit public, c'est impossible.
Propos recueillis par Robert Jules
___




