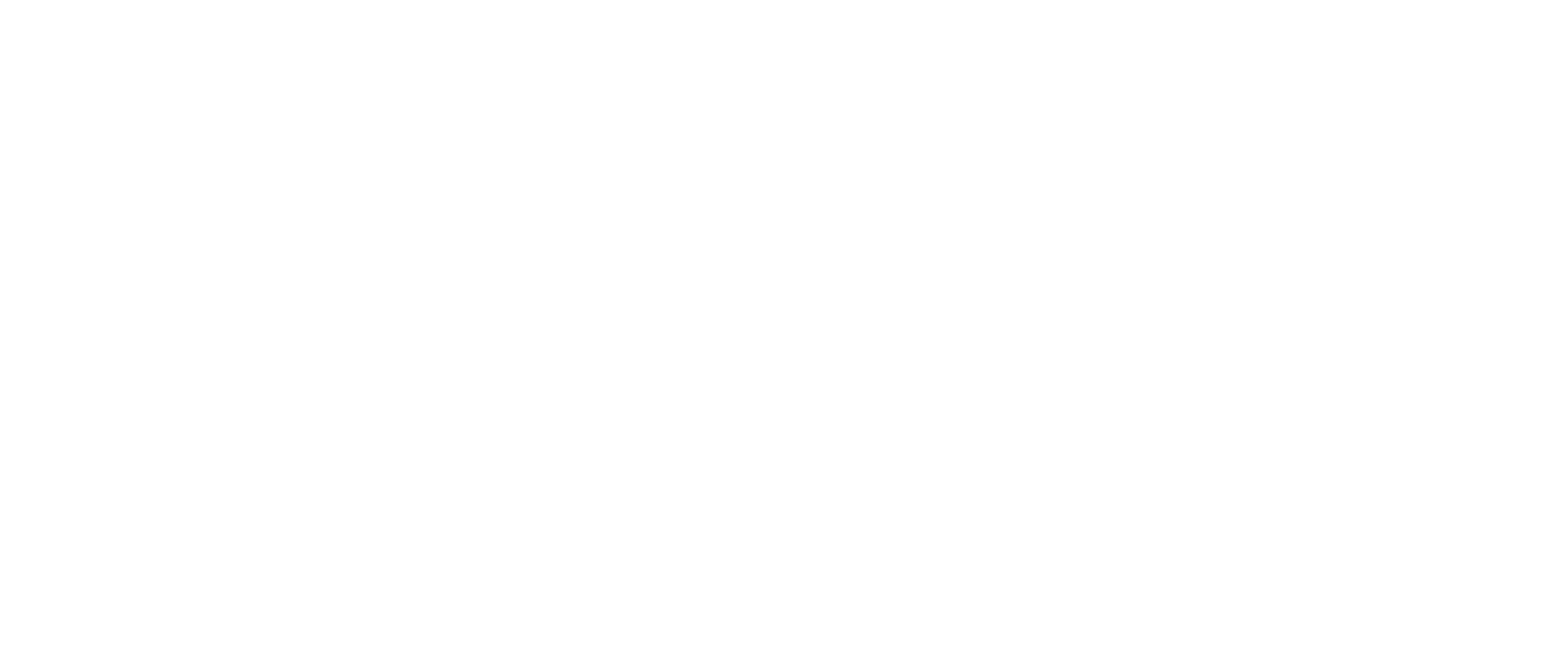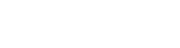La langue, c'est bien connu, est chose vivante. Les mots ont des vies : certains meurent, d'autres naissent, d'autres encore changent de sens comme les êtres humains peuvent parfois changer de sens, d'autres encore sont à certaines époques dans toutes les bouches, puis passent de mode jusqu'à être oublié. Le mot du moment, celui qui domine notre belle époque, est indubitablement « réformes », au pluriel. Tout le monde en parle, surtout les économistes, les journalistes et les dirigeants politiques, mais il est devenu si populaire qu'il s'est rapidement diffusé dans le reste de la population.
Pourtant, comme souvent avec les mots à la mode, on peine à trouver un sens précis à ce mot. Que sont-ce donc que « ces réformes » ? On les sait éminemment « nécessaires », on peut préciser ce qu'elles concernent, souvent le « marché du travail » ou « les retraites » ou « la fiscalité », mais on est souvent bien en peine de donner un contenu précis et constant. Les « réformes » semblent désigner une entité étrange, incertaine, fuyante et mouvante.
Les deux « réformes »
Aussi pourrait-on presque considérer que la crise grecque qui s'est ouverte avec la victoire de Syriza entre Athènes et les gouvernements de la zone euro n'a tenu qu'à cette question a priori de vocabulaire. Tout le monde, le nouveau gouvernement grec comme les membres de l'Eurogroupe, voulaient faire des « réformes. » L'ennui, c'est que nul n'était d'accord sur ce dont il s'agissait, au fond. En Grèce, les réformes visées étaient le rééquilibrage de l'effort fiscal, la reconstitution du tissu de PME détruit par la crise, la remise sur pied, dans un cadre budgétaire maîtrisé, d'un Etat providence comprimé sévèrement par l'austérité et, pour finir, la fin du clientélisme politique et économique. Ces réformes pouvaient très bien être jugées « structurelles. » Du côté européen, on avait une vision des « réformes » qui consistaient à assainir davantage les comptes publics et sociaux et à améliorer la compétitivité, principalement par une poursuite de l'abaissement du coût du travail.
L'incertitude de l'accord du 20 février
Dès lors, donc, que l'on se contentait d'en demeurer à la volonté de réformes, chacun était d'accord et pouvait se féliciter de cet accord. Mais dès lors qu'il fallait en venir aux détails, autrement dit à donner une définition précise aux « réformes », tout était beaucoup plus difficile, voire impossible car on en revenait à la divergence précitée. C'est tout le drame du fameux accord du 20 février sur lequel Grecs et Européens patinent depuis un mois. Cet accord ne réglait rien quant à cette divergence sémantique. Il se contentait de souligner que « les autorités grecques exprimaient leur engagement à une large et profonde réforme structurelle visant à améliorer durablement les perspectives de croissance et d'emploi. » Tout le monde ne pouvait qu'être d'accord avec une telle affirmation, mais chacun pouvait mettre dans ces réformes ce qu'il voulait. D'autant que l'accord ne ménageait pas les ambiguïtés, donnant raison parfois à la Grèce pour « mettre en place les réformes qui ont longtemps été en suspens pour combattre la corruption et l'évasion fiscale et l'efficacité du secteur public », tout en affirmant ailleurs que la Grèce devait réaliser des réformes « sur la base des accords actuels. »
L'enjeu de la définition
Depuis un mois, donc, chacun va dans le sens de sa propre définition des réformes. Et voilà pourquoi la situation est bloquée. L'enjeu des discussions n'est donc autre que de donner un contenu précis à ce terme de « réformes. » Cet enjeu ne se limite cependant pas à une simple question lexicographique. C'est aussi une importante question politique. Si le contenu du mot « réformes » peut être récupéré par un gouvernement voulant rompre avec l'austérité, alors son sens change et ne peut plus être utilisés pour justifier la politique de compétitivité coût qui reste centrale dans la zone euro. A cela s'ajoute le fait que, et c'est le nœud du drame, les deux parties estiment que les deux définitions des « réformes » s'excluent l'un l'autre. Les Grecs considèrent que les réformes demandées par les Européens replongent le pays dans l'austérité, ce qui rend leurs réformes inutiles. Les Européens jugent que les réformes des Grecs sont coûteuses et inutiles et réduisent l'impact de « leurs » réformes. D'où le refus sec des Européens d'accepter la loi sur l'urgence humanitaire cette semaine, un refus non motivé sur le plan budgétaire, mais qui l'est sur le plan politique.
Les Européens jouent la montre
Dans ce contexte, les Européens, persuadés que les Grecs n'iront pas jusqu'à sortir de l'euro, ont décidé clairement de jouer la montre. Les Grecs ont remis le 23 février, puis le 6 mars, des listes de réformes assez étoffées (comme elles peuvent l'être après quelques semaines de pratique du pouvoir) et conformes dans l'esprit des dirigeants athéniens aux textes du 20 février, puisque visant à améliorer la croissance à long terme et à lutter contre l'évasion fiscale et le clientélisme. Mais l'Eurogroupe a fait mine de rien voir, puisque « ses » réformes n'étaient pas incluses et que les priorités grecques s'opposent dans leur esprit aux leurs. La stratégie européenne a donc consisté à contraindre, par une puissance extérieure - celle de la menace de la faillite et de la crise bancaire - les Grecs a adopté leur propre définition des « réformes. » Le mouvement le plus subtil consistant à reporter sur les Grecs toute la responsabilité de l'échec, précisément grâce au flou du terme « réformes. » D'où les déclarations de Jeroen Dijsselbloem, le président de l'Eurogroupe, voici deux semaines et de François Hollande, à l'issue du « mini-sommet » du 19 mars, que l'on avait « perdu du temps. » Autrement dit, tant qu'Athènes continuent à présenter de « fausses réformes », on fait comme si la Grèce n'avait rien fait. Et tout le monde veut bien le croire.
Faire accepter par ses adversaires sa définition des réformes
Dans ce contexte, ce « mini-sommet » n'a rien réglé. Alexis Tsipras s'est engagé, selon le communiqué, à « présenter une liste de réformes spécifiques. » Dès lors deux possibilités se présentent à lui : soit il propose des « réformes » conformes à ce qu'entendent les Européens, donc il revient à une forme d'austérité, et il obtient l'argent qui lui évitera la faillite ; soit il revient avec une liste de réformes proches du programme de Syriza et les Européens jugeront encore que la Grèce fait preuve de mauvaise volonté. Toute la stratégie européenne réside dans cette subtilité : il faut contraindre la Grèce à accepter « volontairement » des réformes dont elle ne veut pas. Autrement dit, il faut que le nouveau gouvernement se plie aux volontés européennes, mais en présentant ces mesures comme le fruit de sa propre volonté. Tant que cela n'aura pas eu lieu, la situation de la Grèce restera bloquée.
Ambiguïté maintenue
De fait, ce mini-sommet a maintenu l'ambiguïté. Alexis Tsipras a affirmé que ses partenaires ne veulent pas la réalisation des objectifs de la troïka sous l'ancien gouvernement. Mais ces mêmes partenaires affirment vouloir la réalisation de l'accord du 20 février et, sans doute entendent-ils par-là, la mise en place de réformes « dans le cadre des accords actuels », donc de ceux qu'on appliqué le précédent gouvernement... La confusion est à son comble. Pour le moment, les Grecs peuvent considérer qu'ils gardent la main en maintenant la possibilité de définir leurs propres réformes, donc leur refus de l'austérité réaffirmée par Alexis Tsipras. Mais cette réalité est de plus en plus fictive. Et le temps, on l'a vu, jouent contre eux. Et, l'argent manquant, la stratégie européenne d'imposer leur définition des « réformes » avec la sanction du gouvernement grec, pourrait bien s'imposer. Cette définition n'est finalement rien d'autre que celle que donnait le premier dictionnaire de l'Académie en 1694 : « le rétablissement dans l'ancienne forme. »