oint de vue NICOLAS VERON Économiste au sein de Bruegel, centre de réflexion sur les politiques économiques en EuropeLe « retour de l'État » est l'un des impacts les plus visibles de la crise depuis 2007, en France comme dans de nombreux autres pays. L'extension du domaine de l'action publique est une réponse logique et largement inévitable aux situations d'urgence économique. Elle ne fait d'ailleurs peut-être que commencer : en dépit de leur rebond depuis le printemps, la situation des marchés demeure fragile, de nouveaux dérapages ne sont pas à exclure, comme en témoignent les tensions suscitées par Dubaï ou la Grèce, et certaines interventions publiques pourraient s'accentuer encore en conséquence.L'attention des experts s'est concentrée ces derniers mois, notamment au niveau européen, sur les « stratégies de sortie » (exit stratégies). L'expression est d'origine militaire, comme si souvent dans la crise. Elle renvoie à la doctrine américaine post-Vietnam, selon laquelle un engagement de forces doit toujours inclure une stratégie claire pour quitter le théâtre des opérations, et qui a par exemple joué un rôle dans la décision de ne pas envahir l'Irak après la défaite de Saddam Hussein au Koweït, en 1991.Les discussions correspondantes se sont focalisées sur les « sorties » budgétaires et monétaires, y compris la réduction des déficits générés par les programmes de relance et la prévention du risque d'inflation. Mais l'intervention publique liée à la crise n'est pas que macroéconomique. À travers elle, les états ont acquis un pouvoir économique considérable qui, comme tout pouvoir, tend spontanément à s'enraciner.Dans l'ancienne Rome, les dictateurs étaient des magistrats au pouvoir presque illimité, mais pour six mois au maximum ; le relâchement de cette règle a coïncidé avec la fin de la République. Par contraste, la plupart des dispositifs d'intervention actuels n'ont pas de limite rigide dans le temps. Les options de sortie seront modelées par la culture et l'histoire, et seront certainement différentes, par exemple, entre les États-Unis, où le citoyen voit d'un ?il méfiant toute nouvelle initiative du niveau fédéral, la Russie, où pour beaucoup l'entreprise privée est avant tout une captation de rente, la Chine, où l'État est omniprésent mais où la valeur économique de l'initiative privée est reconnue, ou la Grande-Bretagne, avec sa tradition libérale mais affectée par l'image désormais très négative de la finance dans l'opinion publique.En France, où selon certains sondages le capitalisme est moins bien accepté que dans n'importe quel autre pays développé, l'intervention publique est comparativement bien vue, et le risque que le « retour de l'État » s'y révèle plus massif ou plus prolongé que nécessaire est plus élevé qu'ailleurs. L'État donne parfois l'impression de chercher à restaurer l'influence qui était la sienne sur l'économie il y a vingt ou trente ans. Parmi les exemples récents, le Fonds stratégique d'investissement, qui met partiellement sous tutelle les PME de croissance, ou la vente d'Areva T&D, dans laquelle le traitement apparemment privilégié réservé à la « solution française » ressemble à une politique industrielle de filière comme au temps de Georges Pompidou, comme l'ont d'ailleurs revendiqué les dirigeants d'Alstom et de Schneider. Les excès potentiels ne sont du reste pas une singularité française. Au Royaume-Uni, en déclarant récemment que l'offre hostile de l'américain Kraft sur le chocolatier Cadbury se heurterait à « une opposition massive du gouvernement », Peter Mandelson a rompu une longue tradition de non-intervention dans les acquisitions transfrontalières. Au niveau supranational, l'acharnement du Parlement européen à légiférer sur les hedge funds, malgré leur peu de responsabilité dans la crise, relève d'une dynamique comparable.Les excès de pouvoir économique d'État sont dangereux pour la compétitivité des pays concernés car, en dehors des situations d'urgence, rien ne permet de penser que la crise a modifié les règles du jeu, à savoir que la croissance est plus forte dans un système régi par la concurrence, la contestation possible des positions acquises par de nouveaux entrants, et la destruction créatrice à la Schumpeter plutôt que l'allocation des positions économiques par décret. Le « capitalisme autoritaire » à la manière russe est une mauvaise stratégie de croissance, après la crise comme avant.Naturellement, les marchés obligataires et, dans l'Union européenne, la politique de concurrence constituent des garde-fous, mais les choix essentiels en la matière restent du ressort des gouvernements nationaux. Aux États-Unis, l'engagement d'une « guerre sans fin » contre le terrorisme et l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan ont souligné rétrospectivement l'importance des stratégies de sortie. De même et au-delà des débats de politique macroéconomiques, la question clé pour beaucoup de pays, dont la France, est de savoir si le « retour de l'État » sera géré avec retenue, ou s'il représente à son tour un risque pour la prospérité future.
Les dangers potentiels du « retour de l'État »
-
Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.

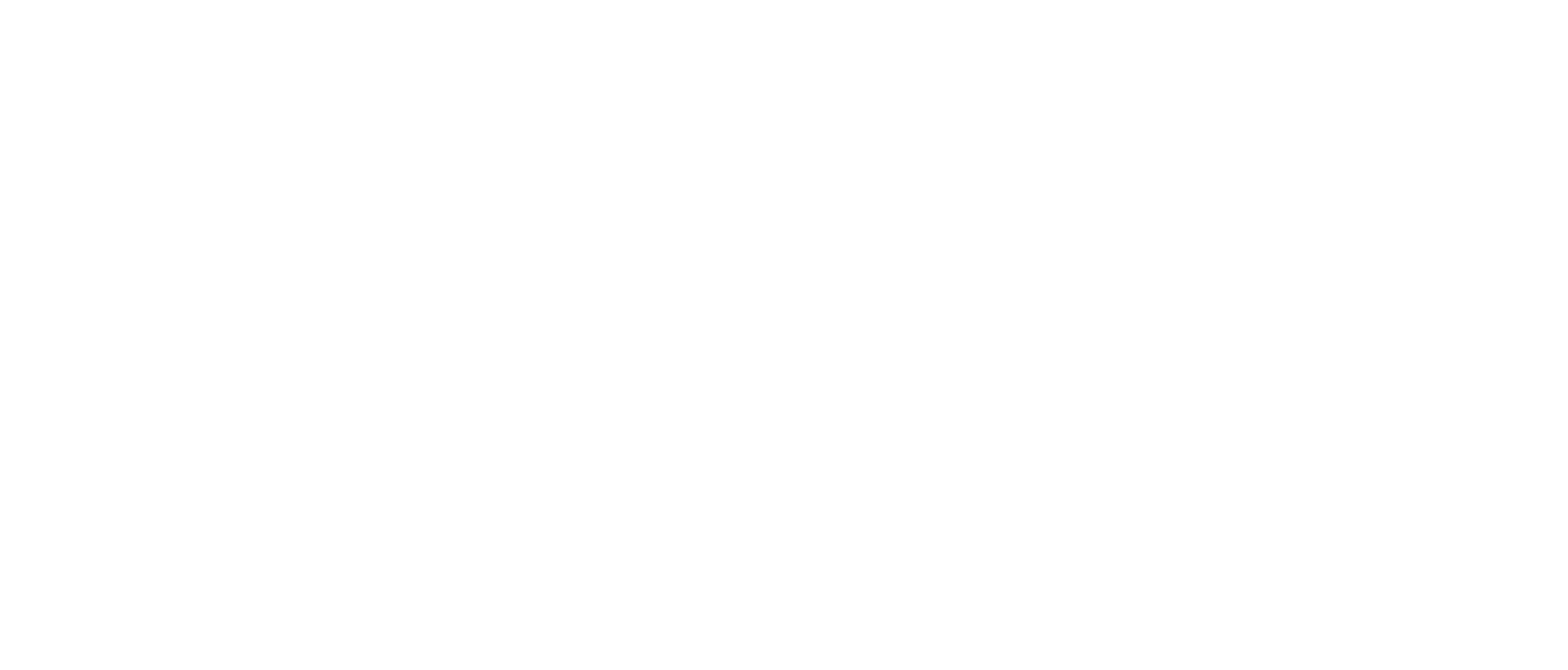

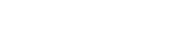
Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !