Le plan antistress ne fait pas affaire. Sur 1.500 entreprises, 708 sont classées sur la liste rouge par le ministre du Travail. Le lendemain de la publication de la liste, le ministère décide de la retirer de son site. Début de polémique ou inexactitude du recensement ? Toujours est-il que le ministre envisage de remettre en ligne une liste mise à jour.
A la base de cette méthode inspirée du "name and shame" américain, il n'existe ni loi ni décret, seulement la publication des sociétés classées selon les trois couleurs d'un feu tricolore, la plupart ayant reçu une lettre de la Direction générale du travail (DGT) pour les informer de leur sélection. Certaines ont découvert qu'elles figuraient sur cette liste, le 18 février 2010.
Passé le temps de l'étonnement, arrive celui des incertitudes. Un syndicat peut-il dénoncer une société qui ne figure pas sur la liste alors qu'elle compte plus de 1.000 personnes ? Une entreprise classée rouge peut-elle encore accéder aux marchés publics ? Le déclassement de vert à rouge peut-il être négocié ? Et la contestation du classement est-elle possible ?
Après la publication de la liste rouge, les dirigeants vont tout tenter pour en sortir. Déjà, certains patrons influents ont obtenu le retrait temporaire de leur entreprise de la liste rouge du site ministériel. Mais une fois paru sur le Net, comment s'en extraire lorsque les syndicats de l'entreprise refusent toute réunion sur ce sujet et font blocage ? Si la concertation s'avérait impossible, la contestation devant le tribunal est-elle la solution pour être retiré de la liste rouge, sachant que la saisine du juge devient délicate quand il n'existe ni droit ni loi ? De fait, la liste rouge procède d'une décision administrative. Or, dans ce monde numérisé, comment identifier le responsable de cette décision ? S'agit-il du directeur général du travail, d'un directeur régional ou du ministre lui-même ?
Si la direction de l'entreprise estime devoir faire partie des "bons élèves" parce qu'elle a signé un accord collectif, elle peut solliciter de la Direccte ou de la DGT un changement de classement. Si le ministère ne répond pas, elle peut alors tenter de saisir le juge.
Un recours contentieux contre la décision ministérielle semble tout à fait envisageable, si on lui reconnaît la qualification de décision faisant grief. Toute la difficulté est de constater que la publication de l'identité d'une société sur un site Internet ministériel est de nature à avoir des conséquences dramatiques pour l'entreprise. Du point de vue du droit administratif, il apparaît qu'un acte superflu, s'il est dénué de tout impact juridique, ne peut être considéré comme faisant grief et n'est donc pas contestable devant les tribunaux.
Or, ce n'est pas parce que la décision ministérielle est dépourvue de toute conséquence directe qu'elle est sans incidence à plus ou moins long terme pour l'entreprise. Si cette publication est destinée à faire pression sur les dirigeants, c'est donc bien qu'on lui reconnaît une incidence sous-jacente. Elle peut donc, à ce titre, faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs.
Alors, quelle stratégie adopter ? En pratique, les dirigeants ont tout intérêt à signer un accord de méthode pour être classés dans le vert car il vaut mieux négocier avec le plus mauvais des syndicalistes qu'avec le meilleur des juges. Voici un nouveau moyen de pression, sans droit ni loi.

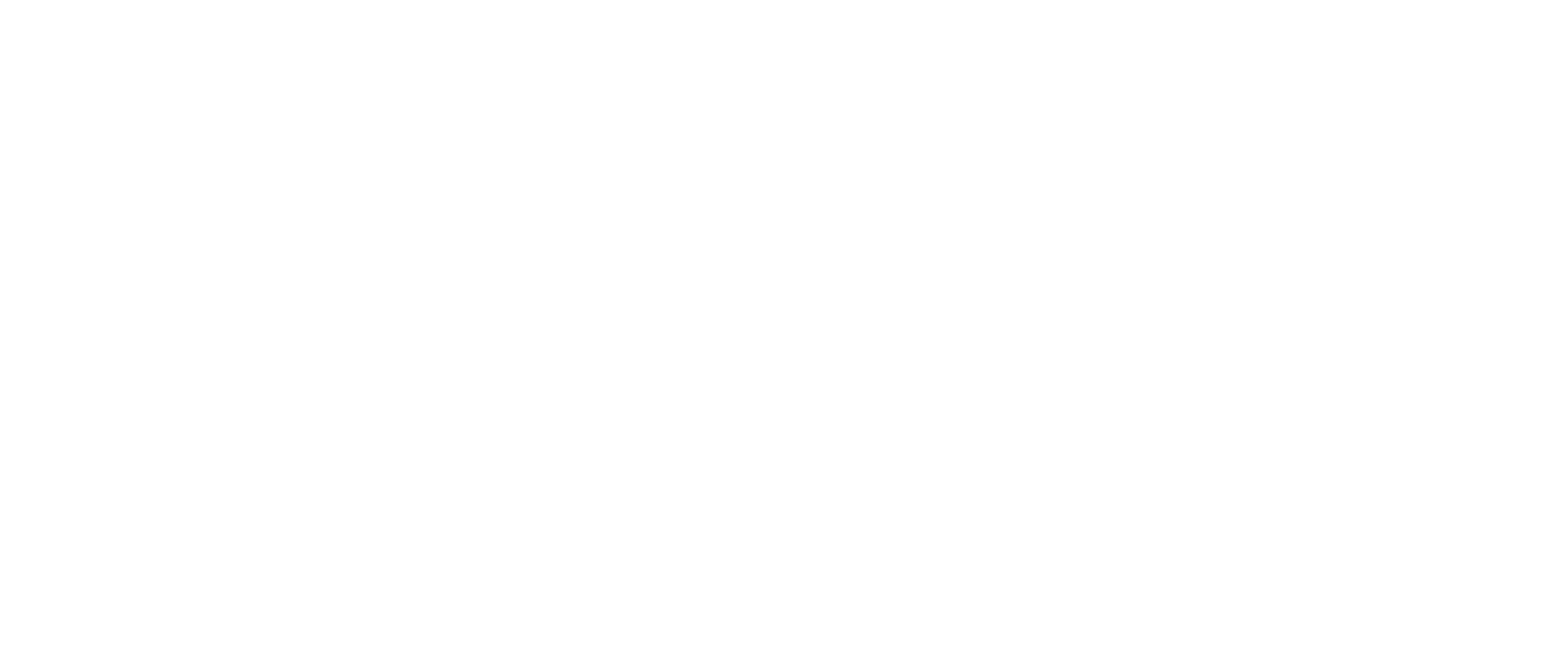
 Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français
Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français

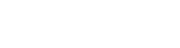
Sujets les + commentés