L'enjeu pour les gouverneurs des banques centrales qui composent le Comité de Bâle est de garantir la stabilité financière à long terme des banques tout en évitant d'obérer leur capacité à financer l'économie. L'exercice est d'autant plus délicat qu'il est toujours périlleux de vouloir réglementer en période de crise. Chacun se souvient du coût exorbitant de la réforme Sarbanes-Oxley, adoptée à la suite du scandale Enron, alors que la plupart des mesures mises en place se sont révélées inefficaces.
Évitant les erreurs du passé, l'accord « Bâle III », conclu en septembre dernier et avalisé par le G20 de Séoul le 12 novembre, vise, d'une part, à renforcer globalement en quantité et en qualité le capital prudentiel mobilisé par les banques pour faire face à des situations adverses et, d'autre part, à garantir leur liquidité en cas de tensions monétaires. Si ces évolutions vont à l'évidence dans le sens d'une meilleure prévention du risque systémique, certains aspects touchent néanmoins des points très sensibles. C'est le cas, en particulier, de la limitation des participations financières significatives à 10 % du Core Tier 1, une mesure qui constituera un handicap pour le modèle français de bancassurance.
Nombre de banques françaises détiennent, en effet, des activités d'assurance en lien, notamment, avec le succès de l'assurance-vie. Le phénomène est moins développé dans les autres pays européens. Ces activités peuvent être consolidées globalement d'un point de vue comptable, mais sont toujours considérées dans la vision prudentielle comme des participations financières. Jusqu'à présent, elles pouvaient être couvertes au passif par du capital Tier 2. Avec Bâle III, elles devront être couvertes par du capital « dur » en actions (Tier 1) pour la part de leur valeur représentant plus de 10 % des fonds propres. Or, ces filiales se chiffrent pour les grands établissements en milliards d'euros. Les banques auront donc à faire des arbitrages, alors même que ces participations constituent des actifs d'immense valeur (du reste souvent sous-estimée par les marchés). Ou elles devront encore accroître leurs fonds propres.
Le deuxième volet du projet vise à instaurer des normes strictes en matière de liquidité des institutions financières, notamment par la mise en place d'un « ratio net de financement stable ». La situation est ici plus complexe dans la mesure où l'accord pose une contrainte nouvelle et majeure sur le fondement même de l'activité bancaire, à savoir la transformation de ressources courtes en emplois plus longs.
Il est incontestable que les enseignements doivent être tirés de la crise de liquidité observée en 2008. Il apparaît légitime d'imposer aux banques un niveau minimum d'adossement de leurs activités de crédit à des ressources pérennes, notamment les dépôts de la clientèle. Cependant, les pondérations actuellement envisagées conduisent à pénaliser trop fortement certaines ressources « naturelles » comme le marché interbancaire qui est pondéré à zéro dans la proposition ! Or, les alternatives sont sensiblement plus chères pour les banques, en particulier le recours au marché obligataire (qui, au demeurant, se ferme également en cas de tensions...). Résultat, la réforme risque d'écraser les marges bancaires sur leur activité de crédit, ce qui conduirait à une réduction de la capacité à prêter ou à une hausse des taux d'emprunt.
Un troisième aspect du projet est susceptible de désavantager les banques européennes. L'accord de septembre prévoit, en effet, l'instauration d'un ratio de levier non pondéré par les risques, à l'instar de celui déjà pratiqué aux États-Unis. Pour résumer, chaque emploi du bilan (et du hors-bilan après conversion) devra être financé par un montant minimum constant de 3 % de fonds propres prudentiels, quel que soit son niveau de risque. In fine, l'exigence la plus sévère (pondérée suivant le modèle Bâle II ou non pondérée par les risques) serait imposée à chaque établissement. Le Comité de Bâle voit dans cette disposition un facteur de simplicité et de transparence, dans la mesure où le calcul actuel des risques pondérés (les fameux « risk weighted assets » ou RWA) peut s'apparenter à une « boîte noire » pour les non-initiés. Cependant, les normes comptables américaines relatives aux instruments financiers dérivés autorisent nettement plus de compensations entre actifs et passifs que les normes comptables internationales appliquées par les banques européennes. Dès lors, ces dernières subiraient non seulement une contrainte supplémentaire susceptible de limiter la distribution de crédits mais elles seraient également désavantagées par rapport à leurs concurrents américains, à moins que les normalisateurs comptables trouvent un terrain d'entente sur le sujet. C'est d'ailleurs le sens du projet « compensation des actifs et passifs » qu'ils ont récemment lancé.
Au total, Bâle III comporte des avancées significatives dans la recherche de la stabilité financière et notamment dans la prévention du risque systémique. Toutefois, sa mise en oeuvre ne doit pas entraver les banques dans leur mission essentielle, à savoir le financement de l'économie à un coût raisonnable, moyennant une prise de risque mesurée. La mise en place d'une période d'observation de six ans débutant en 2012 est donc bienvenue.

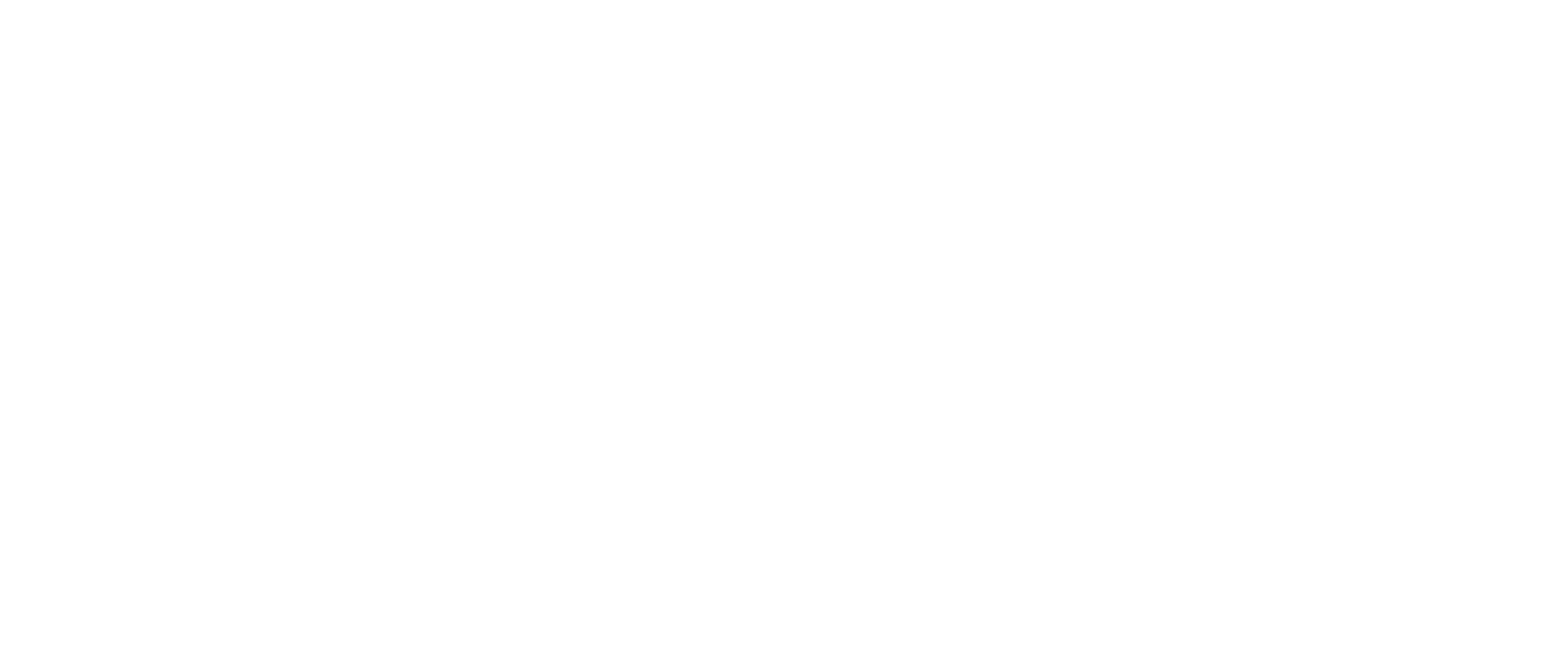
 Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français
Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français

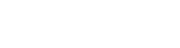
Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !