« S'agit-il d'un accord historique ? », a-t-on demandé à Donald Tusk le 19 mars après l'accord entre l'Europe et la Turquie, censé stopper net le flux des migrants vers la Grèce. Et le président du Conseil européen, qui ne manque pas une occasion de rappeler qu'il est historien de formation, de répondre :
« Je ne suis pas prophète, mais, pour aujourd'hui, c'est un des accomplissements les plus importants dont l'Union européenne puisse s'enorgueillir. »
Sur cet échange où se mêlaient le soulagement et le doute, se concluait la sixième rencontre des chefs d'État et de gouvernement depuis que la crise des migrants est devenue une crise européenne.
Le "mode urgence" pour l'Europe
Comme aux heures les plus chaudes de la crise financière, Bruxelles opère à nouveau sur le mode de l'urgence. Et, plus que jamais, les institutions bruxelloises agissent sous l'impulsion des dirigeants nationaux. Au moment où Angela Merkel créait un appel d'air sans précédent, l'été dernier, en annonçant que l'Allemagne traiterait elle-même les demandes d'asile, l'Italie et la Grèce étant incapables de le faire, la Commission européenne se penchait encore sur les « indicateurs » en fonction desquels on devait répartir entre États membres des réfugiés qui affluaient par centaines de milliers sans contrôle.
Le « renforcement des frontières extérieures » n'était guère plus qu'un peu d'encre dans les conclusions des ministres européens. Il a fallu que les frontières intérieures se redressent une à une au Danemark, en Suède, en Hongrie, en Autriche, que des policiers tchèques ou croates aident la Macédoine à isoler la Grèce, pour passer de la fiction des « quotas » à la réalité de frontières fermées à l'intérieur et béantes vers l'extérieur.
Tout le jeu diplomatique qui se déroule depuis l'été dernier consiste à renverser cette tendance. Plutôt que d'agir en anticipation, Donald Tusk et le président de la Commission Jean-Claude Juncker se sont efforcés de réduire les différends entre Européens eux-mêmes. Dans les jours qui ont précédé l'accord, les deux présidents ont ainsi rencontré tour à tour le Chypriote Nikos Anastasiadis pour le dissuader d'exercer un veto à un accord avec Ankara qui allait prévoir une relance - de façade - des négociations d'adhésion et une libéralisation - elle, beaucoup plus probable, des visas.
Et la Commission s'emploie depuis des mois à faire entrer dans un cadre légal les fermetures de frontières.
« Les discussions actuelles reviennent à remettre en cause la réalité de l'espace Schengen », relevait récemment Jean Pisani-Ferry, le commissaire général de France Stratégie.
Une mise en oeuvre difficile de l'accord du 19 mars
Avec l'accord du 19 mars, on tient une solution certes ad hoc, mais qui contient en puissance toutes les pièces d'une sortie par le haut du chaos actuel : frontière externe contrôlée, accord de réadmission avec la Turquie, application de la règle de répartition des migrants entre États membres. Mais il sera difficile à mettre en oeuvre. Selon la Commission européenne, la Grèce aurait par exemple besoin de 4.000 personnes, agents d'immigration et traducteurs, pour repérer rapidement les migrants illégaux censés être renvoyés directement en Turquie depuis le 20 mars, et pour traiter les demandes des « vrais » réfugiés. Mais ce ne seront pas des agents « européens ». Pour l'instant, la France et l'Allemagne ont promis 200 policiers et une centaine d'agents administratifs. D'où viendront les autres ?
L'Union de droit entre Européens ne pèse pas lourd face à cette situation exceptionnelle et où l'on doit compter sur la puissance turque et les navires de l'Otan pour dissuader les passeurs.
Frontex, l'agence chargée d'aider au contrôle des frontières extérieures, ne dispose que d'un budget de 114 millions d'euros en 2015... La Grèce vient de se voir promettre 700 millions d'euros sur trois ans pour faire face, quand les États membres ont, eux, promis 3 milliards à la Turquie, mais celle-ci manque cruellement de personnel et d'infrastructures. La Commission assure que dix milliards d'euros ont été mobilisés pour gérer la crise des migrants. Mais chaque centaine de millions promis amène son lot de pénibles négociations, comme lorsque le Premier ministre italien Matteo Renzi a mis sa contribution à la Turquie dans la balance pour obtenir un peu plus de souplesse dans l'application des règles budgétaires de la zone euro.
Une non politique migratoire européenne
En matière de politique migratoire européenne, on partait de zéro, ou presque. La Cour des comptes dévoilait la veille du sommet du 18 mars un rapport sans pitié sur son indigence.
« C'est une politique sans stratégie claire, avec un seul programme dédié spécifiquement à l'immigration », explique la rapporteure Danièle Lamarque.
Tous programmes compris, les moyens ne dépassent pas, 1,4 milliard d'euros par an.
Et « les dépenses manquent cruellement d'instruments de suivi et de pilotage. Les objectifs très larges devraient être traduits en indicateurs clairs. Mais les États comme la Commission préfèrent être dans un système non contraignant. Certes, à présent, la tendance porte sur le contrôle des flux migratoires. Mais en a-t-on les moyens ? », s'interroge la magistrate.
Avec la « solution » trouvée le 19 mars, Angela Merkel a certes promis que l'Europe allait « casser le modèle économique des passeurs ». Mais, ce système d'échange de migrants par-dessus le Bosphore reste très limité en nombre, puisqu'il porte pour l'instant sur 72.000 personnes... quand on compte huit millions de personnes déplacées en Syrie, dont près de trois millions dans des camps rien qu'en Turquie, et plusieurs dizaines de milliers quelque part en Grèce. La Commission européenne est censée plancher désormais à la fois sur une extension de l'accord de répartition des migrants entre pays, mais aussi sur une refonte de l'accord de Dublin (qui encadre le traitement des demandes d'asile) et même de Schengen. Autant dire qu'il y a du pain sur la planche.
Bruxelles prépare déjà le terrain pour une solution plus durable en mettant en avant, comme elle l'a fait dans le passé, l'argent du « coût » de la non-Europe ou du « moins d'Europe ». Une étude de l'institut Prognos chiffre la facture à 470 milliards en dix ans si l'espace Schengen était de facto suspendu. Jean-Claude Juncker assurait récemment que le rétablissement durable des contrôles aux frontières coûterait 18 milliards d'euros par an, essentiellement dans le fret et le tourisme.
Sans compter le temps perdu par 1,7 million de travailleurs transfrontaliers.
Mais ces chiffres ont-ils un sens ? « Sans espace Schengen, le marché unique et l'euro n'auraient, à la fin du compte, plus aucun sens », ajoutait le président de la Commission dans un entretien au Handelsblatt. Autant dire que le contrôle des frontières extérieures est devenu une question de vie ou de mort pour le projet européen.

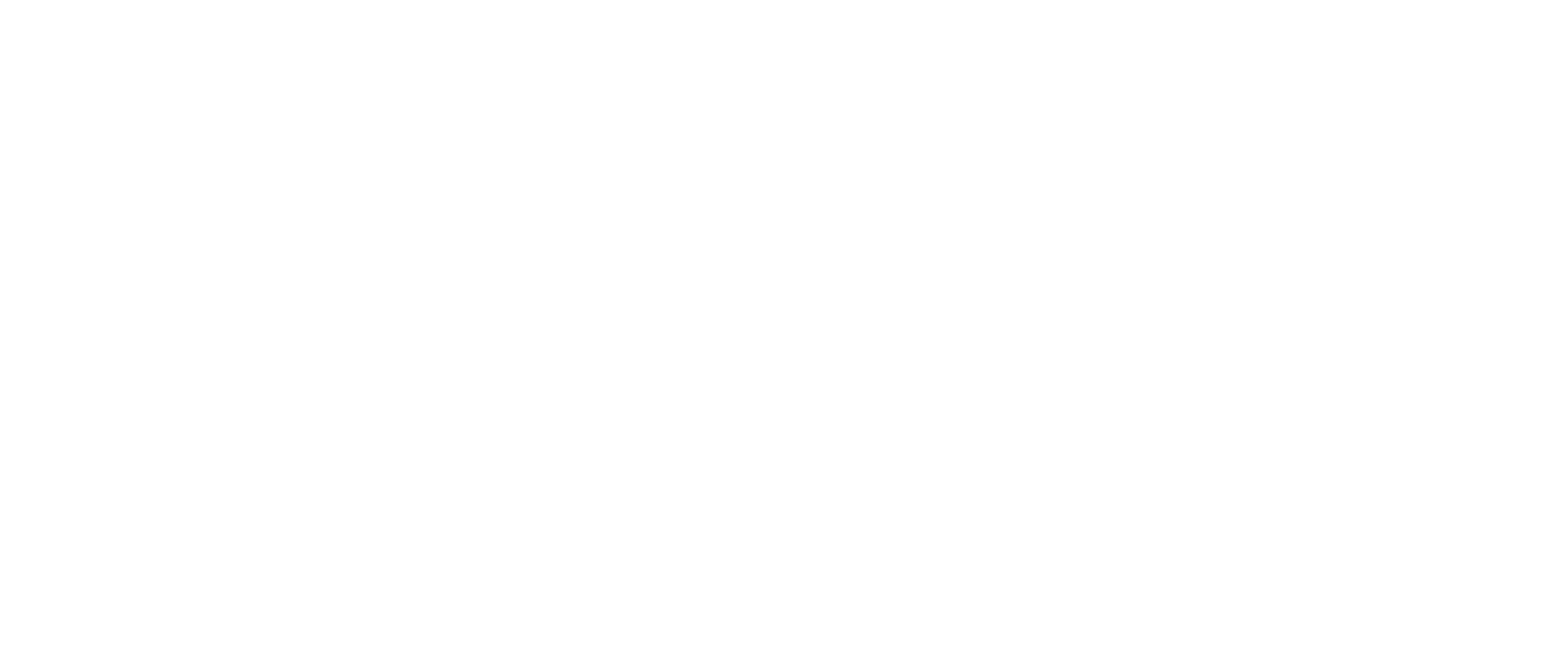
 Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français
Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français

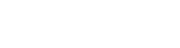
Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !