Tout au long du siècle dernier, le débat politico-économique a tourné autour des vertus et des rôles respectifs de l'État et du marché. Le marché contrôle-t-il l'État, dans la mesure où il pose une limite à la capacité d'emprunt des gouvernements ? Ou existe-t-il une responsabilité de l'État dans la prise en charge des affaires lorsque les marchés échouent à exercer les fonctions sociales nécessaires - telles que le départ en guerre ou le maintien du plein-emploi ?
Ce débat se situe au c?ur des désaccords qui divisent aujourd'hui profondément l'Europe sur la question de savoir comment agir face à la crise de la dette. Cette même question sème la discorde dans le monde politique américain à l'approche des élections présidentielles et législatives de novembre.
Réparer les dégâts des marchés
Au cours des vingt années qui ont précédé la crise financière, la plupart d'entre nous - ainsi qu'une majorité de politiciens - considéraient qu'il existait une suprématie du marché. Aujourd'hui, il semble que la balance intellectuelle penche désormais en faveur d'une opinion selon laquelle l'action de l'État permettrait de réparer les dégâts causés par les marchés - de même qu'avait été observée une certaine vénération de l'État dans les années 1930 consécutivement au culte des marchés qui avait régné pendant les années 1920.
Il y a une vingtaine d'années, un certain nombre d'hommes politiques européens s'étaient judicieusement penché sur la question d'une « troisième voie », constitutive d'un juste milieu en zigzag entre l'importance des mécanismes de marché et celle d'autres priorités sociales nécessitant une certaine canalisation des marchés. Par exemple, lors de la préparation du rapport de 1988-1989 du Comité Delors sur la manière d'instaurer une union monétaire en Europe, les experts avaient prêté une attention considérable à la question de savoir si la pression des marchés suffirait à discipliner les États. Beaucoup avaient répondu par la négative - affirmant que les rendements des obligations seraient susceptibles de converger dès le départ, ce qui permettrait aux États dépensiers d'emprunter à des taux inférieurs aux taux accordés à d'autres États. Ces discussions opérées au début des années 1990 aboutirent à un ensemble de règles toutes prêtes et sévères à l'égard des déficits ainsi que des niveaux de dette, mais qui ne fut jamais pris au sérieux. Ces règles ne suscitaient en effet que moqueries parmi les économistes, et Romano Prodi, alors président de la Commission européenne, les avait qualifiées de « stupides ».
Garantie implicite des dettes
Jusqu'à la seconde moitié de l'année 2008, l'Europe semblait avoir atteint le paradis budgétaire : le marché ne faisait pas de distinction entre les obligations des différents États de la zone euro. Certains pensaient qu'il existait une sorte de garantie implicite des dettes ; un postulat tout à fait erroné, dans la mesure où le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne avait toujours explicitement exclu cette possibilité. Non, cette confiance indivisible des investisseurs reposait sur tout autre chose : une croyance généralisée en la capacité des gouvernements de pays riches.
Selon cette approche, les pays développés jouiraient d'un degré élevé de sophistication fiscale. Ils seraient toujours en mesure d'augmenter l'impôt afin de régler leur dette. Par opposition, dans les pays pauvres, la puissance des intérêts personnels des plus riches entraverait la possibilité d'augmenter l'imposition à leur endroit, et la pauvreté généralisée compliquerait la démarche consistant à faire peser sur les pauvres un impôt universel sur la consommation.
Cette conception s'est vue renforcée par les innombrables épisodes de crises de la dette dans les États périphériques, dont le plus destructeur frappa l'Amérique latine il y a exactement 30 ans, à la suite de booms économiques entraînés par un recours effréné à l'emprunt. Il s'est parfois agit de simples booms de la consommation - concernant les ménages comme les dépenses militaires, ou encore les palaces présidentiels - et parfois de booms de l'investissement, bien que la plupart des investissements aient été alloués de manière inappropriée en raison de priorités politiques.
Crise et faiblesse des institutions
La nouveauté de notre monde, depuis 2008, réside dans le fait que pour la première fois depuis plus d'une génération, les pays développés connaissent la crise de la dette - et commencent à ressembler à des pays pauvres caractérisés par la faiblesse de leurs institutions. Aurait-on ainsi mis à nu une particularité de la zone euro, par laquelle les pays souverains auraient échoué à contrôler leur propre monnaie ?
La crise de la dette européenne a créé une division profonde dans les opinions politiques, comme économiques. Ceux qui soulignent le caractère unique de l'histoire de la solution monétaire en Europe insistent sur le fait qu'il serait impossible de voir les autres pays - qui sont en mesure de contrôler leur propre monnaie - se retrouver dans une situation aussi délicate. La thèse étatiste est ici représentée dans sa forme la plus audacieuse : il ne peut se produire de grève des obligations aux États-Unis ou au Royaume-Uni, dans la mesure où leur banque centrale détient à disposition la panoplie complète des outils politiques - dont un certain nombre d'opérations non conventionnelles - nécessaires pour garantir la monétisation de la dette.
Cette théorie va à l'encontre d'une bonne partie de l'expérience historique, ainsi que de l'approche dominante en faveur d'un système bancaire centralisé, qui a émergé dans les années 1990. Selon cette conception, les investisseurs puniraient les États excessivement dépensiers en exigeant auprès d'eux des taux d'intérêt plus élevés afin de se prémunir contre la probabilité de l'inflation ; la meilleure manière de garantir le faible coût de l'emprunt consisterait ainsi pour les politiciens à conférer aux banques centrales autant d'indépendance que possible, et de placer ensuite la stabilité des prix au c?ur des priorités de leur mandat.
Cesser ce va-et-vient idéologique propre au XXe siècle
La Banque centrale européenne est probablement la plus parfaite expression de cette philosophie. Son indépendance s'est vue garantie non seulement par la législation nationale des États membres, mais également par un traité liant ces États. Les traités sont plus contraignants que les législations nationales, dans la mesure où ils sont plus difficiles à révoquer, à amender ou à abroger.
Les dettes des grands emprunteurs industriels - Royaume-Uni et États-Unis - étant financées de manière externe, l'argument selon lequel leur gouvernement pourrait toujours monétiser la dette n'est pas convaincant. Un jour prochain, les investisseurs étrangers pourraient bien cesser de croire que leurs actifs en livres sterling ou en dollars sont protégés contre l'inflation, et à ce moment-là leur volonté de détenir des actifs en livres sterling ou en dollars à faible rendement pourrait disparaître.
L'idée sous-tendant l'approche des années 1990 en matière de politique monétaire reste aujourd'hui fondamentalement valide, mais requiert pour autant un renforcement institutionnel. Il serait bénéfique de cesser ce va-et-vient idéologique propre au XXe siècle, pour retourner à certains préceptes plus anciens. Les États et les marchés ne fonctionneront correctement ensemble que lorsque des règles juridiques appliquées de manière appropriée garantiront la sécurité nécessaire.
Copyright Project Syndicate

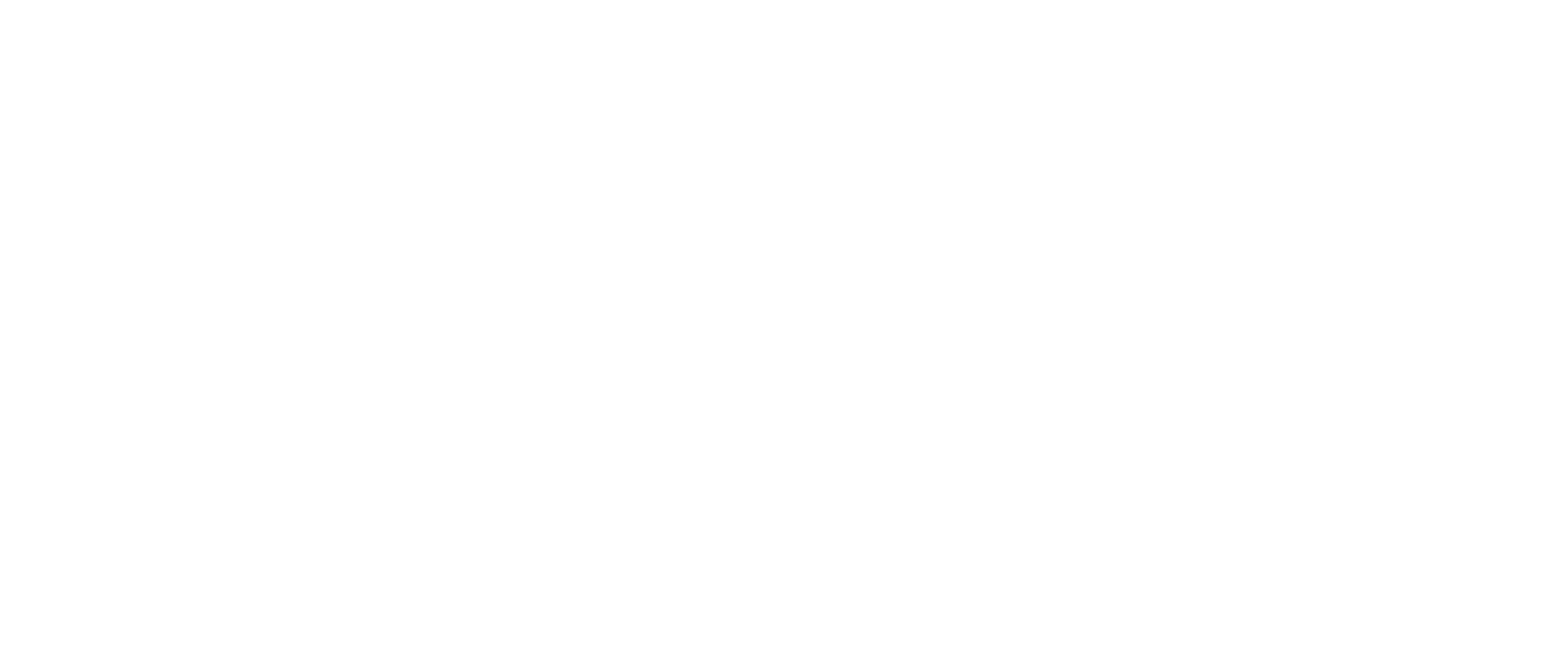
 Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français
Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français

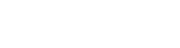
Sujets les + commentés