
Les faits qui ont conduit à l'arrêt Allée / France, rendu le 18 janvier 2024 par la Cour européenne des Droits de l' Homme, sont éclairants sur les ravages de la délation. La requérante, employée comme secrétaire dans un établissement d'enseignement avait exprimé son désir de ne plus travailler sous la supervision du vice-président exécutif en raison de son comportement, qu'elle percevait comme du harcèlement. L'époux de la salariée avait contacté le directeur général, demandant une intervention. Le directeur général avait alors proposé à la requérante un arrêt de travail ou une réaffectation en attendant une rupture conventionnelle. La requérante avait alors envoyé un email accusateur contre le vice-président, réclamant une rupture conventionnelle et une dispense d'activité, et annoncé son intention de porter l'affaire en justice. Plus tard, son époux publiait un billet sur Facebook dénonçant le vice-président comme un "prédateur sexuel".
La position de la Cour Européenne
Celui-ci avait initié une procédure contre la requérante et son mari pour diffamation publique, les accusant de diffuser par courriel des allégations de harcèlement et d'agression sexuelle. La requérante a fait valoir en défense que le courriel n'avait pas un caractère public et invoqué son droit de signaler des infractions selon le Code du travail. Le tribunal correctionnel de Paris a jugé que le courriel était public et diffamatoire, rejetant l'argument de la bonne foi. La requérante avait été condamnée à payer une amende et des frais de procès. La salariée avait interjeté appel et la cour d'appel avait pour l'essentiel confirmé le jugement. La Cour de cassation avait ensuite rejeté le pourvoi de la requérante, fondé notamment sur l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Saisie, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) conclut à une violation par le juge français de l'article 10 de la Convention, qui protège la liberté d'expression. Elle estime que la condamnation pénale de la salariée pour diffamation publique, suite à ses allégations de harcèlement moral et sexuel contre un dirigeant de l'association qui l'employait, n'était pas proportionnelle au but légitime de protéger la réputation. La motivation de cette décision peut se résumer comme suit :
- S'agissant de la nature de la diffusion des allégations, la cour a noté que le courriel envoyé par la requérante avait été diffusé à un nombre restreint de personnes principalement impliquées ou informées de la situation, ce qui limitait son impact sur la réputation de l'accusé ;
- Concernant la charge de la preuve et la bonne foi, les juridictions nationales sont critiquées pour avoir exigé de la requérante une preuve excessive des faits qu'elle dénonçait, sans prendre en compte les difficultés inhérentes à la preuve de harcèlement, notamment en l'absence de témoins ;
- L'effet dissuasif de la condamnation est également instrumentalisé par la cour, qui estime que même une sanction pécuniaire modérée, en l'occurrence accompagnée d'une condamnation pénale, peut avoir un effet dissuasif important, décourageant les victimes de dénoncer des comportements répréhensibles.
- Et par-dessus tout, il existerait un manque de proportionnalité entre la restriction imposée à la liberté d'expression de la salariée et le but poursuivi de protection de la réputation, résultant en une violation de l'article 10.
Cette décision est éminemment critiquable. Elle constitue clairement un encouragement à la diffamation en abaissant le seuil de responsabilité pour des accusations graves sans fondement adéquat, qui sont légion et font des ravages avec des mouvements du type MeToo. À la clé, la destruction de la réputation de personnes injustement accusées, qui se voient contraintes de se défendre contre des allégations potentiellement infondées désormais protégées par une interprétation élargie de la liberté d'expression.
Cette jurisprudence va sans nul doute décourager les victimes de telles diffamations de tenter de faire valoir leurs droits en justice, dans un environnement où les fausses accusations sont moins susceptibles d'être questionnées ou examinées sérieusement, par crainte de répercussions juridiques. L'employeur lui-même pourrait être tenté de ne pas considérer les plaintes de ses salariés victimes de tels agissements.
Équilibrer expression et réputation
La CEDH a omis de considérer l'importance de maintenir un équilibre entre la protection contre le harcèlement et la protection de la réputation. La décision pourrait donc être vue comme un précédent dangereux qui favorise les droits d'un individu au détriment d'un autre, sous le couvert de la liberté d'expression. Ce faisant, elle ouvre également la porte à des abus potentiels de cette protection, créant un terrain juridique glissant où la diffamation pourrait être plus facilement excusée sous prétexte de liberté d'expression.
C'est pourquoi il convient de rappeler à toutes les victimes de diffamation sur les réseaux sociaux qu'elles disposent d'outils pour se défendre, notamment la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par ailleurs, la dénonciation calomnieuse est réprimée par l'article 226-10 du Code pénal français, qui dispose que la dénonciation, adressée aux autorités judiciaires ou administratives, d'un fait qui est déterminé mais que l'on sait totalement ou partiellement inexact, et qui pourrait entraîner des sanctions, est punissable.
Il est difficile de se départir du sentiment qu'une fois de plus, la décision de la CEDH dans cette affaire est motivée par une volonté de renforcer la protection juridique des dénonciateurs et délateurs de tout poil, comme c'est le cas dans un univers parallèle à celui de Strasbourg avec la directive du Parlement européen et du Conseil contre les prétendues « procédures-bâillons » du 11 avril 2024. Dans les deux cas, la liberté d'expression a tendance à devenir le droit de dire publiquement n'importe quoi au sujet de n'importe qui, au cas où ce serait vrai.
Ce texte met en place un certain nombre de mesures supposées protéger les individus participant au « débat public » contre les poursuites judiciaires abusives, appelées un peu naïvement, et souvent exagérément, "poursuites-bâillons". Quand on commente ce genre de démarche, il est difficile de ne pas faire un usage important de guillemets, tant l'impression d'une forme discrète de novlangue est forte.
Les tribunaux vont désormais pouvoir, mais surtout devoir, évaluer « rapidement » la validité des plaintes et rejeter celles qui ne reposeraient sur aucun fondement légal sérieux.
De telles dispositions ne laissent pas d'étonner. S'il existe certes ce qu'on appelle des « fous judiciaires » qui tentent de faire feu de tout bois en justice et polluent le circuit judiciaire, le juge peut déjà actuellement apprécier la viabilité et surtout la recevabilité de telle ou telle action à bref délai. Ce qui est le plus gênant, c'est la consécration du pouvoir, et du devoir, du juge de décider « rapidement » de ce qui est sérieux et de ce qui ne l'est pas, comme s'il s'agissait d'une notion objective. Il s'agit en réalité d'une consécration de la possibilité donnée au juge de faire montre de mépris pour telle ou telle action judiciaire un tant soit peu créative, ce qui existe déjà avec le concept d'irrecevabilité. Celle-ci est mise en avant dans des proportions indécentes notamment par la Cour européenne des Droits de l'Homme, qui balaie ainsi d'un revers de main l'immense majorité des requêtes par une lettre laconique.
La leçon sur les périls de la délation
On a bien compris que la directive tend à protéger les bons qui dénoncent les méchants - notamment les « lanceurs d'alerte » au sujet desquels on peut regretter qu'il n'existe pas de statistiques probantes pour démontrer l'inanité assez fréquente de leur industrie qui est mue le plus souvent par un désir de vengeance - mais le simple fait que le juge national puisse rendre une décision radicalement infirmée par une juridiction supranationale quelques années plus tard gêne un peu la démonstration des tenants du « rejet rapide » et donc la motivation même retenue par le Parlement européen pour adopter la directive.
Celle-ci met également en place un système dans lequel les plaignants déposent une caution pour couvrir les frais de procédure estimés. Cette mesure vise à dissuader les poursuites abusives en rendant les requérants potentiellement responsables des coûts qu'ils « imposent » aux défendeurs. On signalera simplement que la consignation existe déjà en droit français, notamment en matière de constitution de partie civile, et qu'il est douteux que de nombreux États Membres de l'UE ignorent cette pratique.
Il en va de même de l'allocation des frais due en cas de jugement en faveur du défendeur : la directive permet d'imposer au requérant de rembourser tous les frais de procédure encourus par le défendeur. En augmentant ainsi le risque financier pour les requérants, la directive s'éloigne un peu plus du droit d'agir en justice, qui était déjà bien encadré sur ce plan en France par l'article 700 du Code de procédure civile, ou par exemple en Belgique par le système de l'indemnité de procédure.
S'il faut se réjouir du fait que de telles mesures visent à renforcer la liberté d'expression et la participation démocratique, il convient de se demander si elles maintiennent efficacement l'équilibre entre le droit à un recours judiciaire et la nécessité de prévenir l'abus de ce droit pour réprimer le débat public.
S'il faut également se féliciter d'une meilleure protection théorique des journalistes et de l'extension de la protection à ceux qui assistent le défendeur, comme les avocats, les membres de la famille, et même les fournisseurs de services comme les éditeurs ou les plateformes en ligne, il reste que les faiblesses manifestes du texte cachent mal une démarche cosmétique et bien sûr, probablement idéologique.
Mais on ne sait s'il faut s'en réjouir ou le regretter. Par exemple, le texte limite son champ d'application aux matières civiles et commerciales et ne couvre pas directement les cas de diffamation, qui relèvent essentiellement du droit pénal, notamment en France. Cette seule restriction souligne le caractère superficiel de la démarche, qui semble ne pas répondre aux attentes de ceux qui cherchent des solutions législatives « robustes » pour démêler le vrai du faux dans le cadre de débats publics. La diffamation, souvent utilisée comme un outil dans les poursuites-bâillons, reste ainsi en dehors du champ d'application du texte, laissant un vide important dans la lutte contre les abus judiciaires qui visent à réprimer la liberté d'expression.
Un juriste anglo-saxon remarquait que ce manque « d'inclusion » des aspects pénaux peut être perçu comme un manque de profondeur dans l'analyse et la réflexion législative nécessaire pour « adresser » de manière « holistique » la complexité des interactions entre droit civil, commercial et pénal. Il y a meilleur aristarque, et nous laisserons de telles analyses à la côte ouest des États-Unis. Il n'en demeure pas moins que l'impression d'approximation qui se dégage de la directive pourrait être forte si l'on ne gardait pas à l'esprit que l'amateurisme et l'hypocrisie sont évidemment étrangers aux institutions européennes.
Par ailleurs, la directive ne s'applique évidemment qu'aux affaires ayant une incidence transfrontière. Cette limite restreint considérablement la portée du texte, qui ne cible dès lors qu'une petite fraction des affaires potentielles, et négligeant ainsi de nombreux cas qui restent confinés à un cadre national. La limitation à des cas transfrontaliers semble ignorer la réalité quotidienne des poursuites judiciaires qui, bien qu'impactant profondément le débat public, ne dépassent pas les frontières nationales. Cette orientation renforce l'idée que l'UE « n'adresse » pas pleinement les défis rencontrés par ses citoyens dans leur propre pays, où la majorité des litiges liés à la liberté d'expression et à la diffamation se jouent.
Au total, le texte, comme l'arrêt Allée d'ailleurs, se garde à distance de la problématique de la propagation rapide des fausses informations, en particulier via les réseaux sociaux, et de la nécessité de lutter contre la désinformation, qui sont pourtant des enjeux majeurs. Voilà plutôt le chantier auquel il convient de s'atteler : développer des réponses juridiques et législatives qui intègrent pleinement la complexité et l'interconnexion des défis posés par la désinformation et les attaques contre la liberté d'expression, tout en veillant à ne pas entraver le droit fondamental d'agir en justice.
_____
(*) Emmanuel Ruchat est avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles. Il pratique depuis 1996 le droit international dans divers domaines : droit pénal, immigration d'affaires, droits fondamentaux, sanctions européennes, mobilité des travailleurs. Il est l'auteur de nombreuses publications sur ces sujets.

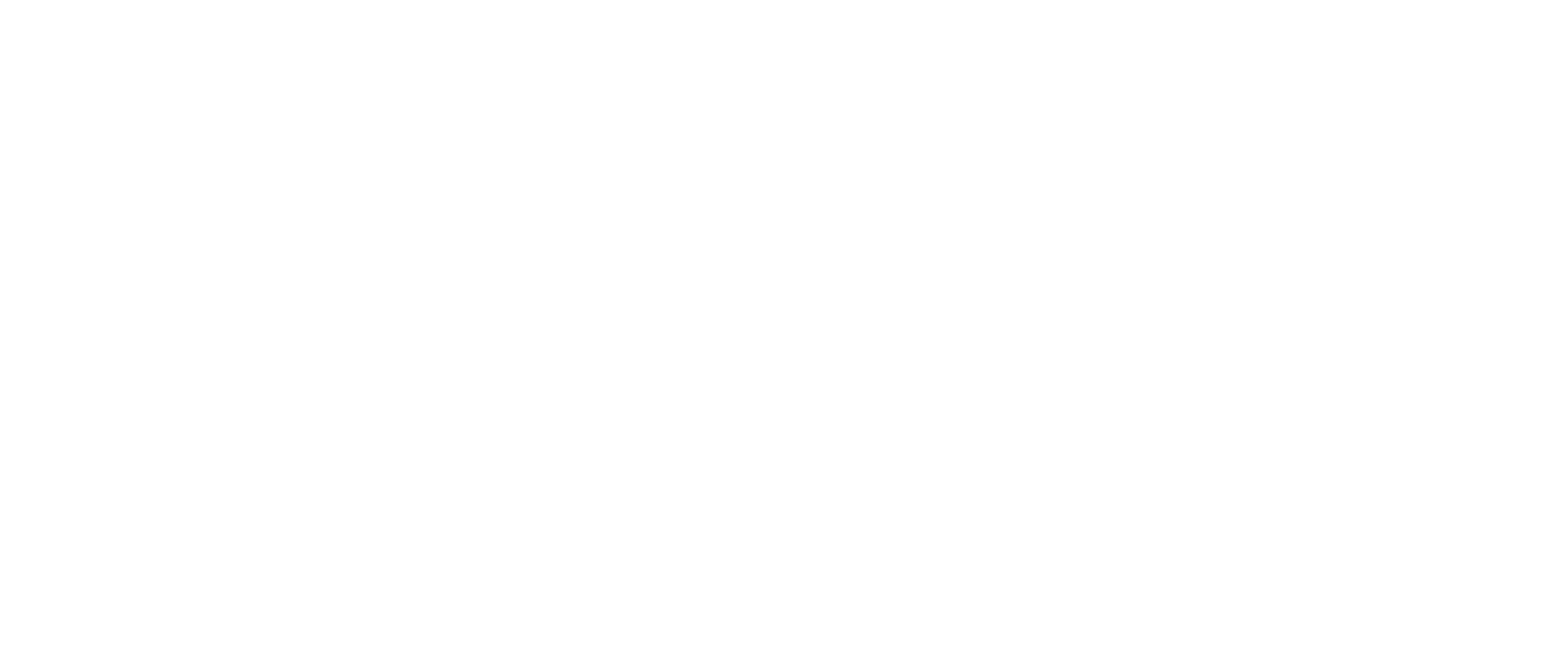
 Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français
Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français

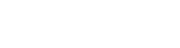
Sujets les + commentés