
Deux ans après le début de la crise sanitaire, les Français ont commencé à comprendre l'étendue du problème : nous devons reconstruire notre système de santé plombé par les contraintes administratives et nous donner les moyens de soutenir l'industrie pharmaceutique sans s'obstiner à la financer au rabais. Comment sortir de cette posture de mauvais élève du médicament qui n'incite pas les industriels de Big Pharma à miser sur la France ? Les grands dirigeants de l'Europe sauront-ils enfin se donner les moyens d'esquisser une vraie Union en matière de santé ? Comment décliner un retour vers l'excellence sanitaire dans la région AURA, pôle d'excellence français ? Et comment rétablir un accès égal aux soins au niveau de territoires ?
Pour trouver des réponses à toutes ces questions, découvrez le #ForumSanteInnovation organisé à Lyon par La Tribune mardi 8 novembre. Cette séquence traite sur le sujet suivant : "Economie et philosophie du soin font-ils bon ménage ?"
Pour cette table ronde nous accueillons : - Nicolas BOUZOU, Economiste et directeur de la société d'études économiques Asterès - Cynthia FLEURY, Philosophe, Chercheur à l'Institut des Sciences de la communication et Professeur à l'American University of Paris.
Résumé du débat
Philippe Mabille : Economie et philosophie du soin, une équation impossible ? C'est le thème inédit autour duquel vont débattre nos deux invités. Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, est professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Cnam et auteur de plusieurs livres, dont « La fin du courage», et « Le soin est un humanisme ». À ses côtés, Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet Asterès est un économiste très présent dans les médias, notamment pendant la crise du Covid, auteur d'un livre avec Julia de Funès, « La Comédie (in)humaine ». Première question : la crise sanitaire a mis en lumière la vulnérabilité du système de soin et de l'individu soigné, le malade, face au système, vulnérabilité qui perdure aujourd'hui. Pour commencer Cynthia, faut-il repenser le soin, le penser différemment ? Est-ce que nous avons tiré les leçons de cette crise ?
Cynthia Fleury : J'aimerais bien, mais ce n'est pas tout à fait sûr. En revanche, je pense que la Covid 19 a permis de mettre en lumière un sujet qui n'est pas un impensé, mais qui est tellement implicite qu'il mériterait d'être un tout petit peu plus réinvesti, à la fois dans la reconfiguration des politiques, de l'organisation et de quantité de sujets. Mais c'est vrai qu'avec la pandémie, il y a eu en ce qui concerne la santé, de la vulnérabilité. Mais le terme clé de cette histoire, c'est peut être la vulnérabilité systémique. Une prise de conscience de ce qu'est une vulnérabilité systémique. Pour le dire rapidement, une vulnérabilité systémique, c'est lorsque ce qui se passe à Wuhan, se passe X jours après dans le monde entier. Ce n'est pas nouveau et c'est ce qu'on appelle la mondialisation, mais à un point absolument déterminant, puisque personne n'avait imaginé être impacté comme ça dans sa vie la plus quotidienne, avant la pandémie.
Maintenant, on comprend que ces vécus d'effondrement, d'effondrement au sens où un accès à une ressource matérielle ou immatérielle, est mise en danger, raréfiée, rentre en pénurie structurelle. Et alors qu'elle était jusque-là relativement équitable, ne l'est plus du tout et va subir des systèmes de priorisation... C'est maintenant notre lot commun. Je pense que chacun comprend que ce qui s'est passé avec la pandémie va être récurrent. Que nous allons rentrer dans des systèmes qui, régulièrement, seront en mode dégradé. L'hôpital est régulièrement en mode dégradé, mais ça peut être une entreprise, ça peut être l'école demain, ça peut être quantité d'endroits. C'est le passage très désagréable pour des sociétés modernes, qui va relancer la vulnérabilité de ce qu'on pourrait appeler l'éthique jurisprudentielle centrée sur la personne, à de l'éthique publique utilitariste, centrée sur le score, la stat. Ce n'est pas du tout la même chose et ça fait très mal aux vulnérabilités. Parce que toute norme, qui est générale, est discriminante pour les singularités qui sont sur les côtés. On va rentrer là-dedans également. C'est le côté vulnérabilité systémique. Le côté un peu plus positif, c'est la question de l'holistique de la santé. Qu'est-ce que c'est que la santé ? La définition de l'OMS, c'est non pas l'absence de maladie, mais un état global de bien-être physique, psychique et social. Et notre premier geste pour protéger la santé en contexte systémique de vulnérabilité, ça a été ce qu'on appelle la biologisation de la santé. En gros, le contraire de la définition de l'OMS. Pour préserver la santé, on nous a mis sous bulle. Ce qu'on peut comprendre, mais c'est n'est pas tenable et c'est mortifère. C'est l'antithèse de la santé comme relation holistique. Et si cette pandémie était un cas inédit, cela se reproduira. Il va falloir qu'on repense à la façon de réagir. Parce qu'on ne va pas à chaque fois pouvoir produire des vulnérabilités qui vont être très cher payées par la collectivité. J'en donne juste un exemple : quand tout d'un coup vous pensez que des enfants, qui ont entre deux et six ans, vont pouvoir produire un développement viable dans leur système d'apprentissage devant un zoom, pour les préserver d'un virus qui par ailleurs ne les touche pas, vous gagnez peut être du temps, là, dans la demie seconde, mais c'est une génération entière de problèmes sur les systèmes d'apprentissage qui s'en suivra. C'est déjà ce qu'on voit avec des inégalités drastiques sur les jeunes gens. Tout ça pour dire que derrière la santé, il y a le continuum des soins et ce qui fait qu'une société tient debout.
PM : On dit que l'économie, c'est la science de la rareté. On a vu réapparaître des pénuries. On y reviendra avec vous, Nicolas. Quelles leçons tirez-vous de l'épisode Covid où pour la première fois dans l'histoire du XXᵉ siècle ou d'un début de XXIᵉ siècle, on a mis l'humain devant l'économie. Est-ce qu'on a vraiment tiré les leçons de cet événement et qu'est-ce que ça a provoqué dans nos sociétés ?
Nicolas Bouzou : Même réponse que Cynthia, on n'en a pas véritablement tiré toutes les conclusions. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que dans beaucoup de domaines, il y a une espèce de retour à la pensée d'avant. Notamment quand on réfléchit à l'organisation du système de santé. Ce que je vais dire peut sembler contre intuitif, mais je ne pense pas que ce soit pendant la période de la pandémie de Covid, en tout cas pendant sa phase aiguë, que notre système de santé ait le plus montré ses vulnérabilités. J'aurais presque tendance à dire l'inverse. A dire que c'est là qu'il a montré le meilleur de lui-même, parce que justement on est revenu à du sens. Comme le disait Cynthia très justement, le système de santé est guidé aujourd'hui par une espèce d'éthique utilitariste, avec en point de mire la norme. Pendant la pandémie, il n'y avait plus tout ça, ou juste un tout petit peu. Mais grosso modo, ce que disaient le ministère et les ARS aux hôpitaux, c'était débrouillez-vous, faites au mieux, et si vous ne devez pas faire comme vous faites d'habitude, ne le faites pas. Et au fond, on voit qu'à partir du moment où vous laissez de la souplesse à l'organisation, que vous lui laissez l'initiative, les choses se passent mieux.
PM : Pendant la crise, on a vu que l'hyper centralisation ne fonctionnait plus. On critique l'ARS, mais au-delà des personnes dans les ARS, c'est le système qui n'était pas suffisamment proche du terrain ?
NB : Absolument. Parce qu'on a un système qui est guidé par la norme. Et la principale norme, je voudrais le rappeler, c'est les dépenses de santé. La progression des dépenses de santé est votée tous les ans au Parlement. Cela s'appelle l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cela se divise en sous ONDAM, l'ONDAM hospitalier, l'ONDAM médicament,... En début d'année, on dit l'augmentation des dépenses à l'hôpital, ce sera de X %. Vous êtes dans un système qui, dès le départ, est normé. Et même quand on considère qu'il faut élargir la norme, ou qu'on considère qu'on a trouvé une norme qui est bonne, un objectif qui est bon, en réalité, il ne l'est pas. J'ai eu beaucoup de débats pendant la crise sur la question du nombre de lits d'hôpital. Même si on veut les augmenter, les lits d'hôpital ne sauraient constituer un objectif en soi. Ce n'est pas parce que dans un pays vous avez beaucoup de lits d'hôpitaux que vous avez automatiquement de meilleurs résultats en matière de santé. Il faut revenir à une approche qui soit beaucoup plus souple, beaucoup plus holistique, qui donne au système de santé des objectifs qui soient extrêmement généraux. Je reviens sur ce que vous disiez au départ, on a eu pendant cette crise le sentiment de la vulnérabilité du système. Je pense que ce n'est pas pendant la crise qu'on l'a vu le plus cette vulnérabilité, mais elle existe très clairement. On le voit quand on regarde l'espérance de vie en bonne santé qui stagne en France, ou quand on regarde la mortalité évitable.
P.M. : Sur tous ces sujets, on n'est pas très bons en France...
N.B. : C'est une blessure narcissique très importante pour les Français, parce que l'idée d'avoir le meilleur système de santé au monde, c'est quelque chose qui est très ancré dans l'inconscient politique français. Or en France, quand les gens vont aux urgences, ils attendent 12 heures. Si je veux faire une analogie, c'est un peu comme les coupures d'électricité dans un pays qui a misé sur le nucléaire. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais on voit que l'accès à l'électricité et à la santé sont deux promesses qui n'ont pas été tenues.
P.M. Cynthia, le diagnostic est je pense partagé, avançons sur les solutions. On a aujourd'hui un système qui a été le meilleur, et après on est rentré dans une logique comptable, mais du point de vue de la philosophie du soin, est-ce qu'on a fait la révolution ? L'espérance de vie en bonne santé est mauvaise, il y a un vrai sujet sur la prévention, par exemple, qui n'est absolument pas dans le scope aujourd'hui, ou trop peu, par rapport à d'autres pays.
CF : Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui les « grands shifts » des besoins des personnes en santé, c'est ce qu'on appelle le tournant épidémiologique. Même si avec la Covid c'est plus compliqué, il n'empêche que dans la Covid c'est la comorbidité qui est problématique, donc la chronicité. Et la chronicité, c'est quand même une autre manière de vivre la maladie et les traitements. Ça doit nous faire repenser différemment les parcours de soins. Il faut considérer par exemple que les entreprises doivent être beaucoup plus intégrées dans le système de soin. Parce que la moitié des employés sont des aidants et que de nombreux employés ont des cancers. Le cancer est une maladie chronique, il faut l'accompagner différemment. Par exemple, on voit très bien que les cabines de télémédecine, ça marche très bien dans les entreprises et pas nécessairement à la mairie ou ailleurs. Demain, il faudra peut-être inventer des tiers lieux de santé, parce que c'est moins stigmatisant sur des problématiques de santé mentale, etc. Donc il y a la question de la chronicité et la question du rétablissement. La France est assez faible en recovery, elle est bonne en aigu, mais avant et après pas vraiment...
P.M. : Il y a aussi un sujet de l'errance médicale pour certaines maladies de Lyme ou le Covid long.
CF : L'errance diagnostic cela existe et ce n'est pas spécifiquement français.
PM : Mais c'est vrai qu'il y a quand même des pays qui reconnaissent ces maladies, les Etats-Unis notamment.
CF : Même sur l'endométriose, on a mis du temps en France. J'ai accompagné en tant que psychanalyste quantité de femmes qui étaient véritablement stigmatisées par ce phénomène, alors qu'aujourd'hui on commence à lui donner un diagnostic, à le reconnaître.
P.M. Ça veut dire qu'on ne prend pas assez en compte le patient au cœur du système?
C.F : Il y a un défaut de prise en compte de la médecine narrative. La médecine narrative, c'est tout ce que le patient vous raconte de sa maladie. Ce qu'on appelle la biographisation de la maladie. Très souvent, parce que nous sommes dans un monde de tarification à l'activité, à l'acte, l'écoute, le diagnostic, la clinique disparaissent. La verbalisation du patient sur son état, la généalogie familiale qui est un point important disparaît. Avant, on avait les médecins de famille, ça n'existait plus. Mais il n'empêche que c'était déterminant dans le suivi des pathologies. Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter la technique, la technologie, l'évidence based médecine, etc. mais cela sera d'autant plus accepté que c'est humaniste.
PM : D'où viendrait le changement ?
CF : Des patients.
PM : Qu'est-ce qu'il faut faire comme révolution des esprits ?
CF : Sincèrement, les grandes « révolutions » sur les comportements sont arrivées des associations de patients qui ont fait beaucoup d'advocacy, de plaidoyers, elles ont énormément aidé à reprendre de la démocratie sanitaire. C'est un outil de régulation du système.
PM : La démocratie sanitaire, c'est un mot qui n'est pas un mot tabou ?
CF : Non, ce n'est pas un mot tabou. Et je pense que les associations de patients sont assez déterminantes. Mais ça viendra aussi des soignants. Parce que ceux qui étaient en burn-out longtemps et le sont encore aujourd'hui, ce sont les soignants. Ce sont eux qui vous disent la souffrance éthique, qu'ils ne peuvent pas bien faire leur métier. Cela viendra de la façon dont nos institutions peuvent prendre soin des patients, mais aussi des soignants. Parce qu'une institution qui est malade, soigne moins bien. Donc cela viendra par ces deux catégories d'humains. Mais pour les questions de prévention, c'est vrai que le monitoring de la santé pourrait être intéressant. Mais le monitoring de la santé technologique ne doit pas basculer dans ce que j'appelle la bien surveillance. C'est-à-dire quelque chose qui relève plus du contrôle des personnes. Dire demain tiens, on va penser le crédit sanitaire, comme d'autres pensent le crédit social, ce n'est pas possible. Voilà quelques pistes. Mais c'est vrai que pour l'instant, si dans le discours on est plutôt bon, dans les faits, c'est plus compliqué.
PB : Nicolas, on a les réalités budgétaires. Comment concilier ce qui vient d'être dit, un besoin d'accès plus égalitaire, avec cette question des soignants avec l'équation économique et financière ?
N.B. Première chose, c'est très difficile le secteur de la santé. C'est un secteur qui est très compliqué, parce qu'on essaie de concilier l'efficacité économique, l'innovation et l'équité. Donc ce n'est pas facile. Il y a des sujets de politique publique qui sont politiquement difficiles, mais intellectuellement simples. L'exemple que je prends toujours, c'est la question des retraites. On s'y met vraiment et en 25 minutes maximum, on résout le problème. Ça ne veut pas dire que c'est facile politiquement, mais ça ne pose pas de difficulté intellectuelle. La question de la santé pose une difficulté intellectuelle et d'ailleurs, il n'y a pas de modèle de santé idéal.
PM : On cite souvent les pays nordiques comme étant meilleurs dans la prévention.
NB : Les pays nordiques ont beaucoup de problèmes aujourd'hui. J'étais en Norvège récemment. Ils n'ont plus de médecins. Leur situation est absolument catastrophique. Aujourd'hui, je pense vraiment que tous les pays ont de grosses difficultés. Pour répondre à la question est-ce qu'on peut quand même concilier les besoins de santé et une augmentation des coûts, il faut avoir en tête que le vieillissement de la population augmente les coûts, que l'innovation thérapeutique, ça augmente les coûts. Les thérapies géniques extrêmement sophistiquées, très performantes pour des maladies rares et pour certains cancers sont des traitements très chers. Donc on a vraiment d'un côté cette augmentation structurelle des coûts et de l'autre la dépense de santé qui en France est mutualisée. Donc il faut quand même des moyens de régulation. Première piste, c'est la question de la prévention qui en tant qu'économiste me passionne. Il y a des modes de prévention dont on sait qu'ils sont coûteux mais rentables. C'est-à-dire qu'ils sont bons pour la santé et qu'ils réduisent les coûts de santé à terme. Je vous donne trois exemples très concrets : l'activité physique. On sait que c'est bon pour réguler les coûts de santé. Deuxième exemple, la vaccination des jeunes filles contre le papillomavirus. Le Royaume-Uni est le pays le plus en avance dans ce domaine. Ils ont commencé il y a quinze ou vingt ans et voient déjà une baisse spectaculaire des cancers du col de l'utérus. Troisième acte de prévention très efficace, et sur lequel on n'est pas très bon en France : le dépistage du cancer du côlon, qui se pratique en France à partir de 50 ans. Ce sont trois exemples très concrets de leviers qu'on peut actionner et qu'on peut améliorer, pour réguler les dépenses de santé. Et à côté de ça, on a évidemment la piste de l'organisation. En France, on a un système de soins, en particulier à l'hôpital, dont l'organisation est incroyablement inflationniste. Pendant longtemps, on a dit que l'hôpital n'avait pas assez d'argent et c'était vrai. Mais en 2023, on va affecter plus de 100 milliards d'euros à l'hôpital. On ne peut pas dire que c'est rien. Ce sont des sommes conséquentes. J'ai fréquenté l'hôpital pour mon père et mon fils et j'ai pu constater que l'organisation y est absolument délirante. Parce qu'elle est basée sur le respect de normes, sur des objectifs chiffrés, qui du coup déclenchent des process. C'est nécessaire les process. Mais quand ils passent devant le bon sens et le patient, ce n'est pas bon du point de vue de la santé publique et je peux vous garantir que c'est inflationniste. Cela conduit à des coûts inutiles. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour rendre notre système plus coût/efficace, en améliorant la qualité des soins. Et je suis entièrement d'accord avec Cynthia, elle le voit d'un point de vue philosophique et moi d'un point de vue marketing, le patient n'est pas au cœur du système. C'est l'organisation qui est au cœur du système, pas le patient et ça, c'est un sujet majeur. Donc je compte aussi beaucoup sur les associations de patients.
PM : Mais quand on regarde en pourcentage du PIB, les dépenses de santé, y compris les dépenses liées à la dépendance, c'est autour de 14 % du PIB. Est-ce qu'il faut plafonner, ou est-ce qu'une société doit se dire, pourquoi pas dépenser quinze, seize, 18 % de son PIB pour la santé ?
NB : Je suis toujours sur la même ligne. Je suis pour le déplafonnement. Cela fait quinze ans que j'écris là-dessus. Je suis pour le dé-rationnement des dépenses de santé. Je ne vois pas pourquoi la santé serait le seul secteur où on limiterait les dépenses. Ça n'a pas de sens en soi de limiter les dépenses de santé et leur part du PIB va augmenter, je vous le dis.
PM : De combien ?
NB : Ça dépend de beaucoup de choses. La question que vous posez en filigrane c'est qui finance ? Je dis que la part des dépenses de santé dans le PIB va augmenter, mais j'ai un surmoi libéral qui reste assez fort, je ne pense pas que c'est à la puissance publique de financer la totalité de ces dépenses-là.
PM : On en arrive à la question public/privé.
NB : On a un système dual en France, on a des complémentaires. Notre système est mutualisé. Le reste à charge est faible. Il y a encore des trous dans la raquette, pour le dire vulgairement, mais le reste à charge, globalement, est faible. Donc on peut mettre les complémentaires santé beaucoup plus à contribution qu'elles ne le sont aujourd'hui.
C.F. : Moi je ne vais pas répondre de façon économique et macro, mais je vais répondre au sens où, qu'est ce que c'est qu'un état social de droit. C'est moins un certain type de gouvernement, que fondamentalement un certain type de soins et d'éducation. Ce qui nous fait tenir en tant que démocratie, c'est essentiellement comment, en amont de ces gouvernements, on a aidé à construire des individus à la fois par la santé et par l'éducation. Donc je suis pour un très, très gros réinvestissement sur ces deux questions connexes : éducation et santé.
P.M. : Est-ce qu'on n'a pas trop désarmé la santé et l'éducation. Est-ce qu'on est prêt à ce réinvestissement ?
N.B. : Je ne veux pas être démago, il faut quand même réguler les dépenses. Il faut des moyens de régulation des dépenses. Mais je vais reprendre un exemple concret, Cynthia l'a évoqué tout à l'heure, et c'est peut être un petit point de désaccord entre nous, la tarification à l'acte. Tu es très critique envers la tarification à l'acte. Je pense qu'elle s'est substituée à un système qui était pire, de dotations aux établissements. On donnait de l'argent aux hôpitaux et si au mois de novembre il n'y avait plus d'argent, on leur disait débrouillez-vous, prenez dans votre caisse ou ne soignez plus les gens. Donc on a mis en place cette tarification à l'acte, qui aujourd'hui en revanche, et là je suis d'accord, a des effets pervers, parce qu'elle pousse justement au process. Elle pousse même parfois à faire plus d'actes, et pas nécessairement les actes dont les patients ont le plus besoin. Donc il faut essayer de faire ce qu'on essaie de faire en France, mais qui est très compliqué, je ne dis pas ça pour défendre le gouvernement, je le dis parce que très sincèrement je pense que c'est compliqué, d'avoir des modes de tarification au forfait, avec des objectifs. L'idée, c'est de dire, on ne va plus payer une chimiothérapie, mais un parcours de soins pour un patient qui souffre d'un cancer. Mais c'est des sujets qui sont compliqués et sur lesquels il est difficile d'avoir des réponses arrêtées. La seule chose que je peux vous dire et dont je suis sûr, c'est que la part des dépenses de santé dans le PIB va augmenter. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que derrière ça, il y a des innovations thérapeutiques qui sont bonnes pour nous et dont on sera contents de pouvoir profiter quand on en aura besoin.
P.M. : Je voudrais profiter de la présence de Cynthia pour aborder ce sujet philosophique de la science en matière de santé. Le rapport à la science et à la vérité en matière de médecine a été beaucoup bousculé notamment pendant la dernière crise. Avec l'arrivée du vaccin ARN messager, les complotistes se sont dit, pourquoi aussi vite. La France est à la fois le pays qui a inventé les vaccins et celui qui est le plus anti-vaccins. Comment on explique ça ?
C.F. : C'est vrai qu'on a un pays qui est, aujourd'hui encore, très critique. C'est d'ailleurs une force de l'esprit critique d'être sceptique. Mais notre pays traverse une crise de confiance forte envers les élites. Et dans ces élites, jusqu'à présent, le monde scientifique et universitaire était plutôt protégé. Dorénavant, ce n'est pas si simple. On l'a vu. Par ailleurs, avec la viralité des réseaux sociaux, on parle d'info d'EMI, d'épidémie de fausses informations, parmi lesquelles des informations concernant la santé. Et on a une surexposition à ces informations qui nous rend malade.
PM : Il y a le rapport à la vérité, mais aussi un rapport à la liberté individuelle. Le droit de ne pas se faire vacciner, même pour défendre l'intérêt général.
CF : On instrumentalise toujours l'état de droit contre lui-même. La ligue antivax a été créée dans la foulée de Pasteur au 19ᵉ. Quand elle s'est renommée dans les années 50, pas folle la guêpe, elle s'est renommée pour la liberté vaccinale. Elle avait très bien vu et aujourd'hui elle utilise la peur panique du liberticide. Encore une fois à juste titre. On doit continuer de défendre les libertés individuelles et les libertés publiques. Mais quand vous avez de l'évidence based médecine aussi forte sur un certain type de vaccins, il y a sincèrement même pas à discuter. Là, on est véritablement dans un retour un peu obscurantiste sur ces questions, alimenté par des réseaux sociaux, des communautés radicalisées, tout ce qu'on appelle le populisme scientifique. Et ça, sincèrement, hélas, ça va continuer. Donc il va falloir recréer un lien de confiance fort. Et la question, c'est comment demain on va communiquer intelligemment. Puisqu'il y a ce paradoxe compliqué : vous ne communiquez pas, vous augmentez le soupçon, vous communiquez, vous augmentez l'inquiétude et l'anxiogène. Cet écueil n'est pas simple. On en a fait l'expérience. Parce j'ai trouvé que les scientifiques avaient fait un très gros travail de communication publique au moment de la Covid. Et quand vous regardez la traduction du sentiment des individus par rapport à la science dans les sondages, la confiance dans la science a baissé, alors que les scientifiques ont fait un effort considérable de transparence. On voit qu'il faut grimper en maturité, en acculturation scientifique du côté des citoyens. C'est mon travail d'enseignant chercheur. Ma modeste contribution au monde de la santé, c'est d'essayer de faire en sorte que nos étudiants ne partent pas. Parce qu'il y a une baisse des vocations dans les études de médecine et surtout dans le fait de rester dans le système public. Ce qui est important, parce que ce n'est pas avec un système public faible qu'on va protéger la santé. Il faut à la fois un système privé fort et un système public fort. On est en danger, sincèrement. Et évidemment il faut faire en sorte que les soignants ne tombent pas malade. Indépendamment des approches centrées patients, mon travail, c'est aussi d'accompagner ce qu'on appelle la clinique du burn-out des soignants.
PM : Dernier point. Le sujet de la santé mentale a quand même beaucoup été évoqué en sortie de crise.
CF : C'est un point essentiel. Je crois que jusqu'à présent, à tort, on considérait que la santé mentale, c'était pour certains. Alors que bien évidemment, la santé mentale concerne tout le monde. C'est de la santé, tout simplement. On voit aujourd'hui que la chronicité et l'aigu n'ont pas du tout le même type d'impact sur la santé mentale. Il faut le comprendre. C'est-à-dire que des personnes qui n'avaient pas de pathologie spécifique au départ vont rentrer dans une clinique de l'érosion de la chronicité clinique très compliquée. Elles vont avoir des risques de dépression augmentés et des risques de quantité de somatisations augmentés, liés à des années de maladies chroniques. La santé mentale devient corollaire de la santé tout court. C'est un point essentiel. Sans parler, bien évidemment, de nos modes de vie. Je passe sur le compulsionnel, l'addiction... Je passe sur un grand combo qui est devant nous et qui s'appelle « le cognitif, la sénilité et la pathologie psychiatrique ». Là, vous avez un jeu pas drôle du tout. Vous allez en gériatrie quand vous avez des problèmes psychiatriques, on vous dit non, ce n'est pas ici. Et quand vous êtes une personne âgée, que vous avez des problèmes psychiatriques et que vous allez dans le service psychiatrique, on vous c'est pas ici non plus, allez en gériatrie. Ces espèces de combo qui combinent quantité de pathologies, parce que nous vivons plus longtemps, ça aussi ça va être une refonte nécessaire de nos parcours de soins.
Départ de Cynthia Fleury.
PM : Après ce débat, on va revenir sur la réindustrialisation et la souveraineté sanitaire. Nicolas Bouzou, l'Agence de l'innovation de la santé vient d'être posée sur les fonds baptismaux, il y a dans France 2030, 54 milliards dont beaucoup d'argent pour la santé. Il y a ce projet de créer les dix médicaments du futur. Est-ce que la France veut vraiment se réindustrialiser en santé ? Est-ce qu'elle s'en donne les moyens ? Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait qu'on a pris ce chemin ?
NB : Je suis modérément optimiste. Ce qui me rend confiant, c'est qu'il y a bien eu une espèce de déclic culturel vis-à-vis de l'industrie. Le discours selon lequel la désindustrialisation, ce n'est pas grave, qu'on peut devenir une économie de services sans que ça cause de problème, n'existe plus. Aujourd'hui, toutes les élites et tous les gens qui réfléchissent, les économistes, la haute fonction publique, ont un discours pro industrie. C'est très bien. Et dans le domaine de la santé, on retrouve ce discours. Il s'est passé quelque chose dans les têtes. En matière de politiques publiques, c'est plus compliqué, parce que c'est assez contradictoire. En France, il y a beaucoup de dispositifs qui existent sur ces sujets. Vous avez par exemple évoqué France 2030. Je pense que c'est un très bon dispositif. C'est la bonne gouvernance. Ce n'est pas quelque chose qui est trop descendant, cela part du terrain et la BPI est partie prenante dans la sélection des dossiers, donc je pense que c'est la bonne façon de faire. Donc ça, c'est bien,
PM : Ça va profiter à qui ? Aux biotechs ?
NB : Le but, c'est d'encourager des innovations de rupture. Ça peut être des biotechnologies, mais il y a aussi tout un tas de domaines en santé qui ne relèvent pas des biotechnologies. Ce qu'on appelle les dispositifs médicaux. Par exemple à l'hôpital, si vous avez un dispositif médical qui permet à l'entrée des urgences de scorer un risque d'accident cardiaque ou d'AVC et d'orienter beaucoup plus vite les patients, ce n'est pas du médicament, ce n'est pas de la biotech, c'est de l'industrie. Mais je peux vous dire que ça a des conséquences très positives et très importantes sur le système de santé. Donc France 2030, c'est bien. Le Conseil stratégique des industries de santé, le CSIS, le président de la République est intervenu deux fois avec ce qui était pile le bon discours : la France a des atouts, on a des grandes entreprises, des grands laboratoires, des grands industriels et un écosystème de startups extrêmement dynamique. On a un bon système de prise en charge, en France, ça compte. Un assez bon système d'accès pour les études cliniques, pour ce qui est très innovant. Donc sur le papier, on a pas mal de choses. En revanche, et c'est là où je suis obligé de modérer mon optimisme, les mauvaises habitudes reviennent vite. Par exemple, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il a un peu évolué, mais c'était quand même au départ un PLFSS assez anti industrie, où on se remettait à taper sur le médicament et sur les dispositifs médicaux, parce qu'il faut réduire les déficits et qu'il faut faire des économies. On cherche à baisser les prix des médicaments...
PM : Le problème c'est que c'est fait de façon comptable ou un peu aveugle ? Il y avait autrefois un discours qui disait qu'il fallait arrêter de rembourser les rhumes pour pouvoir rembourser les cancers. Il y a un sujet de financement de l'innovation et du prix à payer pour cette innovation, notamment dans les maladies chroniques. Évidemment, ce sont des médicaments qui vont coûter pour certains traitements très chers, mais ça en vaut la peine puisqu'on met l'humain devant.
NB : La question que vous posez est très profonde. J'y ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'une grande partie de la réponse tient dans le fait qu'en matière de santé, on n'est pas capable d'avoir des projections pluriannuelles. On a une vision uniquement à court terme. Au fond, ce qu'on demande dans le cadre du PLFSS, ce n'est pas de réindustrialiser la France, c'est de réduire les déficits.
PM : C'est la programmation pluriannuelle des finances publiques.
NB : C'est très macro et est assez théorique en réalité. Et dans le domaine de la santé, c'est encore pire. Il faut qu'on soit capable de réfléchir en matière d'investissement. Je vais jusqu'au bout du raisonnement. La thérapie génique qui vaut 1 million d'euros, j'ai une formation d'économiste et je sais faire des calculs, je peux vous dire que pour quelqu'un de 18 ans, qui a une maladie potentiellement mortelle, si la société dépense 1 million d'euros pour le soigner, c'est moins que ce qu'il va rapporter. La valeur actualisée de ce que cette personne va apporter à la société, en bénéficiant de ce million, est très supérieure. Donc, c'est un bon calcul économique. Si vous voulez m'embêter, vous allez me dire, est-ce que pour la chimiothérapie de la personne qui a 82 ou 83 ans, on peut faire le même type de calcul ? Je pourrais vous démontrer que oui. En réalité, même la thérapie ciblée ou l'immunothérapie d'une personne qui est en échec thérapeutique et qui a plus de 80 ans, peut se voir aussi comme un investissement pour la société.
PM : Aujourd'hui, 50 % des dépenses de santé sont concentrées sur les deux ou cinq dernières années de vie. D'où cette formule brutale, que je ne reprends pas à mon compte, il suffirait de supprimer les dernières années de vies pour faire des économies
NB : Cette formule est fausse, pour une raison assez simple, c'est qu'il y aura toujours deux dernières années dans notre vie. Vous ne pouvez pas supprimer les deux dernières années de vie. L'idée derrière ça, c'est de dire qu'au fond, si tous ceux qui vivaient avec des médicaments et des thérapies à 92 ans mouraient à 90 ans, ça irait mieux pour les autres.
PM : Mais il y a quand même une compétition contre la mort. Il y a des gens qui sont en train d'essayer de passer des frontières, 110 ans, 120 ans avec des recherches sur la cellule.
NB : Cela me va très bien.
PM : Mais cela change quand même les données du problème.
NB : Exactement. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Cynthia. Ce sont des innovations. C'est un petit peu caricatural, même si dans le domaine de la lutte contre le vieillissement, il y a une recherche et développement absolument passionnante. Mais il n'y a pas que ça. Pour revenir à un sujet qui concerne quasiment tout le monde, en tout cas un Français sur deux, l'oncologie, le cancer, c'est un domaine où on fait des progrès extrêmement rapides. Des progrès coûteux, mais je pense qu'il y a quand même un assentiment global de la société pour dire que si on pouvait soigner, non pas un cancer sur deux, mais quatre cancers sur cinq, on s'en porterait collectivement pas plus mal.
PM : On ne retrouve pas seulement l'innovation, mais les sujets de prévention, de non perte de chance.
NB : Pour revenir au cœur de notre sujet, la question industrielle c'est comment est-ce qu'on fait en France pour en profiter du point de vue économique ? Et je reviens sur une question que vous avez posée tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on voit toujours la santé comme une dépense et pas comme un investissement ? Parce qu'on a des silos entre les questions de santé et les questions économiques. Il n'y a pas de pont entre les deux. Le ministère de la Santé ne s'occupe pas d'économie et Bercy n'aime pas beaucoup s'occuper des questions de santé. On voit bien qu'on a des terrains assez étanches. Mais cela commence à changer, notamment en cancérologie. En ce moment, il y a un certain des appels à projets dans des grands CHU, ou dans des grands centres de lutte contre le cancer, c'est le cas à Paris avec l'Institut Gustave Roussy, où on va essayer de travailler avec des startups, des grandes entreprises, où on va faire venir du capital investissement... Là, on voit qu'on est au début de quelque chose qui est, de mon point de vue, très positif. C'est ce qu'il faut faire.
PM : Il y a deux sujets qui se croisent. Il y a le sujet de la science, des brevets, la bataille mondiale. Et puis il y a l'autre volet, la réindustrialisation. Jusqu'à présent, Big Pharma avait délocalisé pour faire des médicaments le moins cher possible. On avait également développé les génériques en Inde ou ailleurs. Sur ce sujet de souveraineté, compte tenu de ce qu'on a vécu, du monde dans lequel on va vivre, et on a tous conscience qu'il est en train de changer, si demain on n'a pas l'approvisionnement, les citoyens auront beau jeu de se retourner vers ceux qui n'auront pas anticipé. Pour résumer la question, est-ce qu'on se donne vraiment une politique en la matière ?
NB : Il ne faut pas non plus se dire qu'on va tout relocaliser.
PM : Comme pour l'énergie ?
NB : Alors là oui, je pense que la production d'électricité, il faut la faire chez nous et il faut être autonome chez nous. La production de Doliprane, je pense qu'on va en faire un petit peu chez nous, très bien, mais ce sera plus cher. Les relocalisations, ça coûte cher. Il faut aussi donner la totalité des données du sujet.
PM : Mais cela va créer des emplois, donc moins de chômeurs en France. Le prix du Doliprane, ce sera dans les comptes publics.
NB : Cela aura un coût. La souveraineté ou je préfère le terme d'autonomie moins connoté, l'autonomie et le fait de tout produire chez soi, c'est deux choses différentes. Ce qui nous a causé problème au début de la pandémie, c'est que tout était produit dans les mêmes usines en Chine. Ce n'était pas le fait qu'on ne produisait pas nécessairement nous-même. C'est le fait qu'on s'est rendu compte que la pénicilline était en Chine.
PM : Et qu'on avait tous besoin de Doliprane en même temps.
NB : Exactement. Le travail qui est à faire, c'est un travail de relocalisation, mais de relocalisation partielle. On ne va pas tout faire nous-même. Mais c'est surtout un travail de diversification de nos approvisionnements. Concernant les masques, pardon, je ne veux choquer personne, mais je pense que le destin industriel de la France, ça peut être encore mieux que faire des masques. Et si on en a manqué, ce n'est pas parce qu'on ne produisait pas de masques, c'est parce qu'on avait détruit nos stocks. Ce sont deux choses tout à fait différentes. On peut avoir des masques et ne pas en produire. J'imagine que vous en avez chez vous, vous ne les produisez pas vous-mêmes. L'avenir de l'industrie, de la santé française, je pense que c'est plus les thérapies géniques que le Doliprane. Pour le dire un peu brutalement.
--
Philippe Mabille
Directeur de la rédaction
Twitter @phmabille
La Tribune
54 rue de Clichy - 75009 Paris

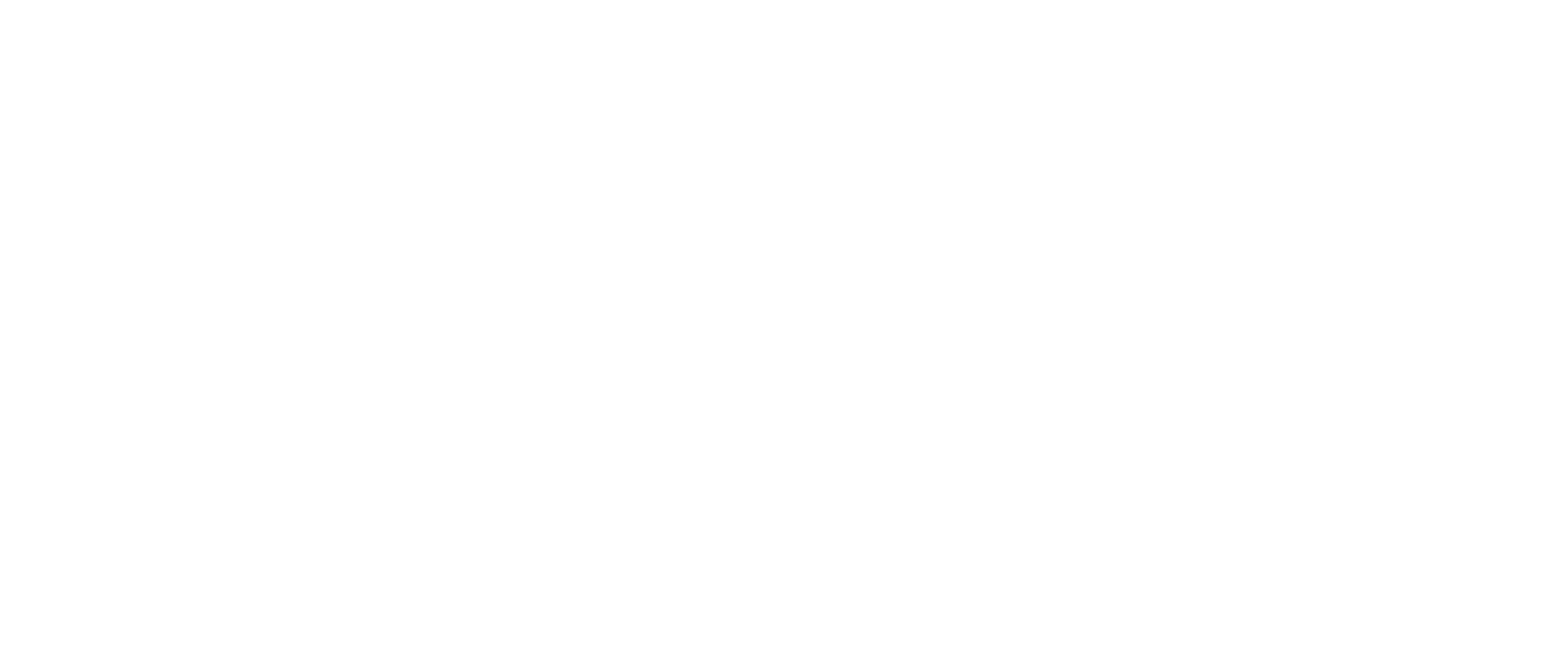

 Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français
Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français

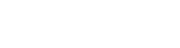
Sujets les + commentés