
Le 7 janvier dernier, les députés ont voté une proposition de résolution, visant selon son intitulé à « protéger la compétitivité du financement de l'économie dans le cadre de la transposition de l'accord du Comité de Bâle de 2017 ».
Ce type de texte a une très faible portée juridique, mais cela en dit long sur le degré de capture intellectuelle de nos parlementaires et gouvernants, comme l'explique dans cette interview Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère éditoriale au Centre d'études prospectives et d'informations (CEPII).
--
The Conversation France - Le financement de l'économie aurait-il à gagner à ce que les accords signés au sein du Comité de Bâle en décembre 2017 fassent l'objet d'un rabotage, comme l'avancent les auteurs de la proposition de résolution votée à l'Assemblée nationale ?
Jézabel Couppey-Soubeyran - Assurément non ! Prétendre l'inverse, c'est être sous l'emprise du « blablabanque », cette rhétorique si bien rôdée par laquelle le lobby bancaire capture l'esprit de nos parlementaires et gouvernants, pour faire prévaloir l'intérêt des banques (les profits de court terme) sur celui de la collectivité (un secteur bancaire sain et stable, contribuant du mieux possible au financement de l'économie et tout particulièrement à celui des entreprises). Et c'est bien cela le problème : la résolution votée par les députés français ne reflète absolument pas l'intérêt de la collectivité, mais uniquement celui des grands groupes bancaires.
Pouvez-vous revenir sur l'historique de ces accords de Bâle pour mieux comprendre la portée du texte signé en décembre 2017 ?
En réponse à la crise financière de 2007-2008, le G20, lors de sa réunion de crise à Pittsburgh en septembre 2009, avait enjoint le Comité de Bâle, où se réunissent les superviseurs bancaires du monde entier, à renforcer ses recommandations prudentielles.
Depuis la fin des années 1980, les fonds propres, c'est-à-dire l'argent apporté par les actionnaires ou les sociétaires des banques ainsi que les réserves qui correspondent à leurs bénéfices qui ne sont pas redistribués, sont au cœur du dispositif de prévention des risques bancaires. En effet, ces fonds propres sont à la gestion des risques bancaires ce que l'aspirine est à la médecine, un traitement généraliste, qui permet de traiter tout type de risques de perte, ceux des activités de crédit, de marché, y compris ceux liés à des erreurs humaines, des fraudes, des pannes informatiques, etc. C'est aussi la seule ressource non remboursable au bilan des banques, donc un coussin indispensable d'absorption des pertes non prévues.
Par deux fois avant la crise, des standards internationaux de fonds propres avaient été recommandés par le Comité de Bâle : en 1988 (Bâle 1), en ne considérant que le risque de crédit, ce qui était trop étroit, et, en 2004 (Bâle 2), en élargissant l'assiette de risques à couvrir, mais sans revoir le seuil de l'exigence, restée à 8 % de fonds propres en proportion des actifs risqués, et en déléguant aux banques la mesure du risque de leurs actifs pour gagner en... précision !
Résultat, les grandes banques, disposant de modèles internes d'évaluation de risques, se sont appliquées à les calibrer au mieux pour minimiser la valeur de leurs actifs risqués pondérés par les risques. Cela leur permet de respecter le ratio réglementaire avec moins de fonds propres que les établissements sans modèles internes, obligés de se conformer à l'approche standard du régulateur. En outre, les fonds propres avaient une définition à tiroir, telle qu'il était possible de satisfaire les 8 % de fonds propres requis avec seulement 2 % de vrais fonds propres. Bâle 2 était à peine transposé dans les droits nationaux que la crise financière éclatait et que s'imposait déjà une révision du standard prudentiel.
Quel bilan peut-on tirer de Bâle 3 ? Ces accords, signés après la crise, ont-ils permis de mieux sécuriser le système bancaire ?
Bâle 3 a eu le mérite de redéfinir les fonds propres en qualité et en quantité, en faisant porter l'essentiel de la nouvelle exigence de 10,5 % sur des vrais fonds propres (actions et bénéfices non distribués), et aussi de prévoir des rehaussements possibles en cas d'emballement du crédit (coussin contracyclique) ainsi que pour les groupes bancaires systémiques (surcharge systémique). Mais pour parvenir à l'accord de 2010, les négociateurs avaient soigneusement évité de remettre en question l'usage des modèles internes, alors même que bon nombre de travaux avaient déjà mis en lumière les manipulations dont ils font l'objet.
Il aura fallu attendre décembre 2017 pour qu'un nouvel accord soit trouvé en la matière. Un accord a minima, comme assez souvent au Comité de Bâle, étant donné la nécessité de parvenir à un consensus entre ses membres : pour limiter l'avantage que les grandes banques tirent de leurs modèles internes d'évaluation de risque, il a été recommandé que la valeur des actifs risqués évaluée à partir de modèles internes (approche dite avancée) ne puisse plus être inférieure à 72,5 % de celle obtenue avec l'approche standard du régulateur à laquelle se soumettent les établissements qui n'ont pas de modèles internes validés.
C'est le fameux plancher ou output floor, auquel nos députés n'ont manifestement rien compris. Ce n'est pas, en tant que telle, une exigence supplémentaire de fonds propres, mais une réduction de l'avantage que les grandes banques tirent de leurs modèles internes et qui renforce leur position dominante. Avant de se soucier des conditions égales et loyales de concurrence entre mastodontes européens et américains, nos députés pourraient d'abord identifier leur manque sur le marché intérieur...
En quoi la séance parlementaire du 7 janvier dédiée au « financement de l'économie dans le cadre de l'accord du comité de Bâle de 2017 » est-elle selon vous édifiante ?
Le vote de cette proposition de résolution témoigne d'un manque de maîtrise du sujet par les députés présents. La plupart ne faisaient que psalmodier leurs textes. L'ONG Finance Watch, qui se consacre à faire comprendre ces sujets, l'a déploré à juste titre.
Notons au passage que la technicité et la complexité de ces dispositions a ceci de bien pratique pour les banques que cela rend le tout inaccessible à ceux qui n'en ont pas l'expertise. Pas si étonnant dans ces conditions que ce soit auprès des banques elles-mêmes que nos parlementaires aillent chercher l'explication, en se laissant sciemment ou non embobinés par la rhétorique du lobby bancaire.
Quels sont les mécanismes de cette rhétorique ?
C'est une rhétorique de l'inaction, autrement dit un discours conçu pour empêcher l'action, en l'occurrence ici le progrès de la régulation financière. Ses arguments sont exactement ceux qu'analysait l'économiste américain Albert Hirschman dans Deux siècles de rhétoriques réactionnaire. J'avais transposé sa grille de lecture au discours du lobby bancaire dans mon livre Blablabanque.
Le lobby bancaire fait comme les conservateurs ou réactionnaires dont Albert Hirschman décortiquait le discours. Il construit systématiquement son discours autour de l'un ou plusieurs des trois arguments suivants : l'effet pervers, l'inanité, la mise en péril. En matière de réglementation bancaire, cela donne un discours qui oppose systématiquement à une nouvelle réglementation soit qu'elle aboutira à des effets contraires à ceux recherchés (effet pervers), soit qu'elle ne servira à rien (inanité), soit qu'elle fera payer un lourd tribut, en l'occurrence au financement de l'économie, au crédit, à la croissance, etc. (mise en péril).
La séance parlementaire du 7 janvier fut un concentré de ces faux arguments. Tout y était ! Des effets « contraires », « délétères » des exigences de fonds propres pour le financement de l'économie, au coût d'opportunité que représenterait les centaines de milliards de fonds propres « immobilisés » au bilan des banques, en passant par le « fossé réglementaire » que cela creuserait avec les banques américaines.
En quoi est-ce que cela témoigne d'une désinformation ?
Les fonds propres ne sont pas une somme immobilisée dans un coffre, mais une ressource que les banques investissent comme bon leur semble. Il n'y a pas de raison mécanique pour que plus de ressources disponibles réduisent les financements accordés, pas plus qu'en termes relatifs quand la part des fonds propres dans le total des ressources augmente. D'ailleurs, les petites et moyennes banques de détail, les plus orientées vers le crédit aux entreprises et aux ménages, sont plus capitalisées que les grandes banques d'investissement davantage tournées vers les activités de marchés.
Si les grandes banques préfèrent la dette de marché aux fonds propres, c'est parce que la garantie implicite de sauvetage dont elles bénéficient encore, en dépit de la mise en place des dispositifs de résolution (comme le mécanisme de résolution unique dans le cadre de l'Union bancaire), continue de subventionner implicitement leur dette de marché. Il n'y a qu'à se rappeler la satisfaction du groupe BPCE lorsque, en novembre 2018, il a été réintroduit dans la liste des établissements systémiques que le Financial Stability Board met à jour chaque année. Le quotidien Les Échos rapportait alors les propos d'un observateur à ce sujet : « dans la perception des investisseurs, c'est une distinction. Le fait d'appartenir à la catégorie "établissement systémique" est très importante. En Asie, par exemple, cela peut ouvrir l'accès à certains fonds qui ont des poches d'investissement dédiées aux plus grandes banques considérées comme plus solides ».
En clair, un établissement, lorsqu'il est reconnu comme systémique, lève de la dette de marché à moindre coût. D'où sa préférence pour la dette. S'y ajoute l'attachement des grands groupes cotés à une base étroite de capital pour pouvoir servir une rémunération par action (return on equity, ROE) à la hauteur de celle attendue par leurs actionnaires ou de l'idée qu'eux-mêmes s'en font. Plus la base de fonds propres est large, plus le nombre de parts à rémunérer est grand, ce qui mécaniquement réduit le ROE. À l'inverse, avec une base de fonds propres plus étroite, il est possible de servir avec un même bénéfice un ROE plus élevé.
Qu'en est-il du fameux fossé réglementaire avec les banques américaines qui pénaliserait les banques européennes ?
La concurrence des banques américaines est une antienne des lobbies bancaires européens. Or, en matière de fonds propres, la contrainte est plus sévère pour les banques américaines que pour les banques européennes. Il y a certes aux États-Unis, depuis la mandature de Donald Trump, une volonté de dérégulation. Mais, d'une part, ce n'est pas une bonne raison pour suivre le mouvement, car il en va de la stabilité financière. Et, d'autre part, les exigences de fonds propres n'ont pas (encore) été défaites.
Il s'avère que, en la matière, le régulateur américain est plus exigeant que ce que recommande le Comité de Bâle et que ce qu'appliquent les régulateurs européens. Les banques américaines sont, en effet, soumises à un ratio de levier qui rapporte les fonds propres au total des expositions sans pondérations de risque. C'est plus exigeant qu'un ratio pondéré par les risques des actifs, car c'est beaucoup moins manipulable. À la demande des Américains, un ratio de levier a certes été introduit dans les accords de Bâle 3, parallèlement au ratio pondéré, mais à un niveau peu contraignant d'au moins 3 % : à ce niveau, la valeur des actifs peut encore aller jusqu'à 33 fois celle des fonds propres, soit un levier d'actifs digne de ceux d'avant la crise financière de 2007-2008.
Il peut être utile de rappeler quelques ordres de grandeur en la matière sur la base du rapport de suivi du Comité de Bâle d'octobre 2019. Les banques européennes sont, avec un ratio de fonds propres pondéré moyen de 15 %, légèrement au-dessus des banques américaines, mais en termes de ratio de levier la donne s'inverse : les banques américaines ont en moyenne un ratio de 6 % de pratiquement 1 point supérieur à celui des banques européennes.
Comme nos députés appellent à « assurer un niveau de contrainte commensurable à celui des banques américaines », voici une proposition pour y parvenir : feu les pondérations, optons comme le fait le régulateur américain pour un ratio de levier, plus fruste certes mais plus simple, plus facilement vérifiable et moins contournable. Tout le monde au même diapason ! Ce n'est pas faire l'apologie du dispositif prudentiel américain que de soutenir la généralisation du ratio de levier, c'est simplement reconnaître l'impasse que constitue une sophistication à outrance des mesures prudentielles, qui finit par échapper au régulateur lui-même, et qui échappe plus encore au décideur et aux citoyens, se retrouvant dans l'incapacité totale d'exercer une quelconque vigilance.
Pendant la séance parlementaire du 7 janvier, les députés qui soutenaient la proposition de résolution se sont également montrés soucieux de la transition énergétique... Que faut-il penser de cet argument ?
Effectivement, ils ont trouvé là une justification supplémentaire bien commode de leur action ! « À l'heure des investissements requis par la transition énergétique, il ne faudrait pas pénaliser les financements d'infrastructure », ont-ils expliqué. Voilà donc une autre raison de se pencher sur le ratio de levier, car sa simplicité en fait un instrument aisément ajustable. Il pourrait être rendu plus exigeant pour les financements accordés à des secteurs trop carbonés et redonner ainsi de l'attractivité aux financements utiles à la transition écologique, dont ceux de long terme et d'infrastructure.
Les propositions ne manquent pas aujourd'hui pour renforcer la stabilité financière, réorienter dans le même temps la finance vers la transition écologique, et tracer le chemin d'une croissance plus inclusive et soutenable. Mais, pour cela, il faut de la volonté politique. Et pour réenclencher cette volonté, nos parlementaires doivent d'abord réaliser la capture dont ils font l'objet. Condition sine qua non pour s'en libérer.
![]() ________
________
Par Conseillère éditoriale au CEPII, maître de conférences en économie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

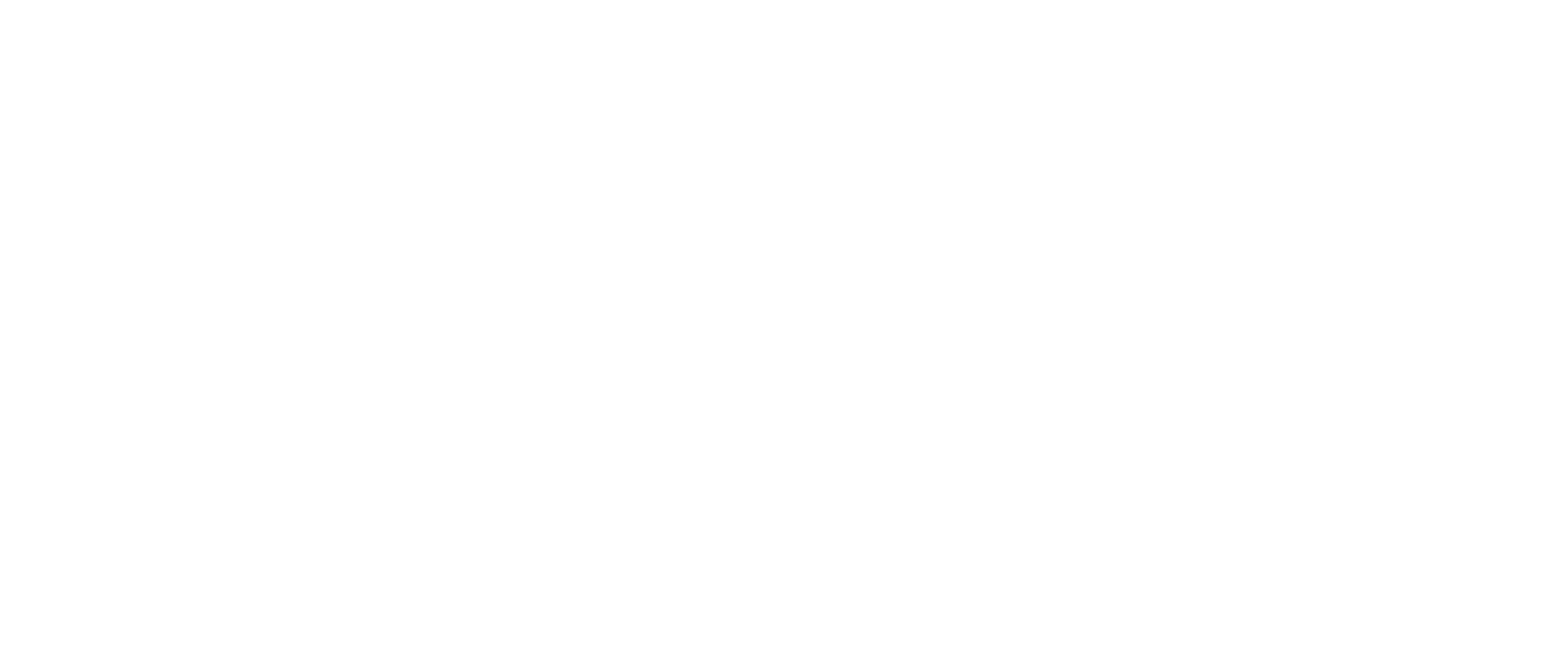
 Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français
Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français

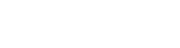
Sujets les + commentés