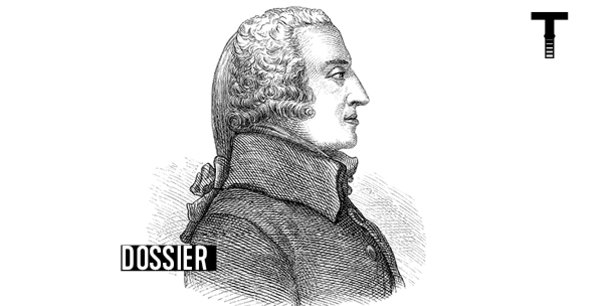
La crise du coronavirus provoque une large introspection dans la société tout entière sur ce qu'il conviendrait de changer pour aborder le « monde d'après ». Les politiques environnementales, les politiques de santé publique, le sort fait aux séniors, l'aménagement des villes, la surconsommation, le traitement des inégalités, la recrudescence des violences faites aux femmes, ont figuré en bonne place dans les débats, les discussions, les articles de presse, mobilisant les plus brillantes intelligences, lesquelles, en fait de « monde d'après », ont rapidement convenu que ces sujets étaient anciens et que le seul impact de la crise sanitaire n'était pas de nature à les faire évoluer rapidement même si elle a en souvent révélé la terrible acuité. Il en est de même avec le capitalisme, pointé du doigt comme la source de la plupart des maux dénoncés par ailleurs, puisque l'on lui devrait à la fois les excès de la mondialisation, la montée des inégalités, le réchauffement climatique, la toute-puissance de l'argent, la corruption, l'exploitation éhontée des matières premières, la mainmise sur les affaires du monde d'une nouvelle oligarchie de milliardaires... et autres cataclysmes à venir. Les appels, de toutes parts, à la réforme du capitalisme se font de plus en plus pressants. Ils n'émanent plus seulement de ses habituels pourfendeurs - la gauche, les syndicats, les écologistes - mais aussi des responsables économiques eux-mêmes, d'experts, d'universitaires et d'économistes.
Et la crise sanitaire a encore accentué les critiques et alimenté les débats, réclamant un capitalisme plus humain, plus attentif aux intérêts de la société, ouvert au dialogue avec les ONG et s'engageant de façon plus active dans la « croissance durable ». Qui ne souscrirait pas à ces objectifs ? La première question qui se pose est : qui va commencer ? Les attaques contre le capitalisme sont aussi anciennes que le capitalisme lui-même.
Bien avant Karl Marx, la détention d'argent, la spéculation, la Bourse ont alimenté de nombreux écrits critiques (dont ceux de Balzac). Après la Première Guerre mondiale les jeunes économistes de l'école de Vienne qui prônaient la libéralisation des échanges et de la circulation des capitaux au niveau mondial se sont heurtés à la fois aux gouvernements mais aussi au déploiement des mouvements communistes et syndicaux.
Dans les années 1930, il était de bon ton de dénoncer en France les « 200 familles » qui contrôlaient les banques et les premiers empires industriels. Plus tard la France gaullienne a fait davantage confiance à l'action de l'État, au Plan, à l'économie mixte qu'aux capitalistes privés. La crise de 2008-2009 a cristallisé l'opposition au capitalisme financier accusé de détruire « l'économie réelle ». En fait, les critiques du capitalisme se sont toujours plus ou moins cristallisées sur trois sujets essentiels : le pouvoir exorbitant des puissances d'argent sur la décision politique, les inégalités sociales, l'avidité des détenteurs de capitaux. S'y ajoutent aujourd'hui les atteintes à l'environnement et la contribution aux dérèglements climatiques. La difficulté de réformer le capitalisme est qu'il n'est pas un système de régulation de la production et des échanges, mais qu'il est le système dans lequel baigne toute l'économie mondiale. Il est un écosystème vivant, qui a nourri les différentes révolutions industrielles et technologiques, et qui s'en est nourri en retour, et qui a su faire preuve, au fil des décennies, d'une très grande capacité d'adaptation.
Il s'est révélé, malgré les crises, comme un outil d'une redoutable efficacité pour créer de la richesse. Son rôle n'a jamais été de veiller à sa juste répartition ou de faire le bonheur de l'humanité. Il est une fusée propulsée par deux boosteurs : le risque et le profit, le second devant être proportionnel au premier.
Le gagnant rafle tout
Au sortir de la crise financière de 2008, l'idée selon laquelle les subprimes avaient constitué une sorte d'apogée du capitalisme financier, brillant de ses derniers feux avant de s'assagir, était assez répandue. Il n'en a rien été. Au contraire. Non seulement le mouvement n'a pas ralenti, mais il s'est accéléré encore. En décembre 2019, la capitalisation boursière mondiale frôlait les 87 000 milliards de dollars, soit près de 100 % du PIB mondial, bien au-delà du pic de 57 500 milliards qu'elle avait atteint en mai 2008, juste avant l'effondrement des subprimes et la faillite de Lehman Brothers. Certes, en 2020, la crise du coronavirus a entraîné une baisse des marchés, mais ils ont regagné une bonne partie du terrain abandonné en mars et en avril. D'une certaine façon, la crise de 2008 a plutôt provoqué une nouvelle fièvre sur les marchés boursiers. L'injection massive de liquidités par les banques centrales a eu pour effet de diminuer les taux d'intérêt des placements sans risques (et même de créer le phénomène des taux nuls ou négatifs). Les gestionnaires de capitaux se sont alors tournés vers des investissements plus risqués - la Bourse, le private equity, le capital-risque, le capital investissement - mais plus rémunérateurs. Cet afflux d'argent a permis en particulier le financement des géants de la technologie à un rythme accéléré, leur conférant une puissance presque unique dans l'histoire du capitalisme, comme le montre Apple dont la capitalisation boursière a frôlé durant l'été les
2 000 milliards de dollars. Non seulement le capitalisme ne s'est pas assagi, mais il a imposé « la logique des vainqueurs ». Il n'y a plus de place pour les « moyens », seuls les premiers survivent. Le gagnant remporte tout, comme l'explique Philippe Delmas dans l'essai qu'il a consacré aux nouvelles technologies (1). En réalité, ses fondamentaux n'ont pas changé depuis qu'en 1920 Friedrich Hayek et Ludwig von Mises posaient les bases de la théorie néolibérale à Vienne. L'historien canadien Quinn Slobodian (2) explique parfaitement la façon dont, après la Première Guerre mondiale, ces deux jeunes économistes entendaient rebâtir l'âge d'or de la révolution industrielle de la fin du xIxe siècle et du début du xxe, en fixant quelques règles essentielles : la liberté des échanges commerciaux et financiers, une régulation au niveau mondial et non à celui des États, la lutte contre les revendications sociales et la puissance des syndicats ouvriers partout dans le monde. Le gagnant emporte tout vaut aussi pour la richesse privée. Le Crédit Suisse, par l'intermédiaire de son Institut de recherche, produit chaque année un « Global Wealth Report » qui mesure l'évolution des actifs immobiliers et financiers détenus par les particuliers. Entre 2017 et 2018, la richesse des ménages a augmenté de 4,6 %. Depuis 2007, les 1 % des plus fortunés détiennent 50 % de la richesse privée mondiale - même si le taux de concentration des fortunes varie selon les pays, plus faible au Japon et en France, élevé aux États- Unis et au Brésil, très élevé en Inde et en Russie. Et si l'on agrandit la taille de l'échantillon, en passant aux 10 % les plus riches, on constate qu'ils concentrent entre leurs mains plus de 80 % de la richesse privée mondiale, de façon constante depuis 2007. Toujours selon ce rapport du Crédit Suisse, 62 % des adultes dans le monde possèdent une fortune inférieure à 10 000 dollars, soit 3,2 milliards d'individus. Au sommet de la pyramide, environ 150 000 personnes détiennent une fortune supérieure à 50 millions de dollars, dont 4 390 dépassent les 500 millions.
Et chaque année, plus de 2 millions de nouveaux millionnaires apparaissent. Selon les projections du Crédit Suisse, la richesse des individus augmentera de 26 % au cours des cinq prochaines années, atteignant 399 000 milliards de dollars, ce qui gonflera à 55 millions le nombre de millionnaires dans le monde et à 205 000 celui des ultra-riches.
La crise du coronavirus n'a rien changé à cette logique. Au contraire. Depuis quelques semaines, les opérations de fusions-acquisitions reprennent. On annonce la prochaine plus grosse introduction en Bourse mondiale avec celle de la firme chinoise Ant Financial. Veolia veut racheter Suez. Les fonds activistes font leur retour, les hedge funds reprennent du poil de la bête, d'autant que désormais, seuls trois pays continuent de proscrire la vente à découvert (Corée du Sud, Malaisie, Indonésie).
Inverser la tendance ?
Comment serait-il possible d'inverser cette tendance ? Au sein de ceux qui défendent l'émergence d'un capitalisme nouveau, plusieurs approches se confrontent. Certains plaident pour un changement global des comportements.
C'est notamment la thèse défendue par Jonathan Aldred (3) qui enseigne l'économie à Cambridge. Il soutient que la théorie économique a fait de l'efficacité immédiate son point d'ancrage, au détriment des valeurs morales. Il attribue ce qu'il considère comme une dérive mortelle aux économistes qui ont inspiré en leurs temps Margareth Thatcher et Ronald Reagan, et qui ont transformé les acteurs économiques, individuels et collectifs, en agents amoraux, cherchant à traduire en termes monétaires les interactions humaines. D'où les excès que l'on a connus dans les années 1980 et que l'on observe encore aujourd'hui, qui ont mené le monde vers un certain nombre d'impasses, dont la plus significative est naturellement liée au dérèglement climatique. Or, il n'en a pas toujours été ainsi.
À l'origine, l'économie était considérée comme une science morale, proposant une véritable philosophie de la vie. Dans son livre Théorie des sentiments moraux, Adam Smith exposait ainsi qu'en dépit de son égoïsme naturel, l'homme était foncièrement attaché à contribuer au bonheur des autres. L'économie est un sujet éthique, soutient Jonathan Aldred. Elle doit nous permettre de répondre à cette angoissante question : dans quel monde les humains veulent-ils vivre ? C'est aussi la thèse de deux économistes britanniques de premier plan, Paul Collier, professeur d'économie et de politique publique à Oxford, (déjà auteur du Futur du capitalisme) et de John Kay, professeur à Oxford lui aussi et fondateur d'un think tank très respecté Outre-Manche, The Institute for Fiscal Studies. Dans leur tout nouveau livre, Greed is Dead (la cupidité est morte), ils joignent leur science de l'économie pour condamner l'individualisme. « L'extrême individualisme affiché par tant de personnalités de premier plan au cours des dernières décennies, n'est désormais plus intellectuellement tenable », écrivent-ils. Qu'il s'agisse de la recherche systématique de l'enrichissement individuel, de la quête effrénée de célébrité ou des tentations libertariennes de la Silicon Valley, tout cela est allé beaucoup trop loin. Et se paie en termes d'inégalités, de mécontentement social, de division de la société qui sont une menace pour les démocraties. L'alliance des théories libérales et de la recherche de privilèges produit une société inégalitaire, dont, selon les deux auteurs, les limites et les dangers commencent à apparaître. Pour autant, Collier et Kay ne sont pas des apôtres de l'économie étatique ou de la réduction des libertés individuelles. Au contraire, ils sont convaincus que la liberté d'entreprendre et le respect de la propriété privée sont essentiels à la bonne marche de l'économie. Mais, comme certains de leurs collègues, ils appellent à ce que ces libertés fondamentales soient mises au service des « communautés », notamment par un plus grand rôle des collectivités, villes et régions, en matière de politique économique, fiscale et sociale. Ils se réfèrent notamment aux politiques « centristes » menées dans l'après-guerre, dont l'objectif était de rassembler un consensus communautaire. C'est la raison pour laquelle ils plaident à un retour vers les « communautés », par exemple avec le développement de véritables banques régionales, dédiées à la prospérité des territoires dans lesquelles elles sont implantées. « Bientôt, écrivent-ils, soit nous célébrerons les valeurs de l'esprit communautaire, soit nous contemplerons les désastreuses conséquences de sa disparition. »
Les ultra-riches dans le viseur
À côté de ces réflexions sur la nature profonde du capitalisme, d'autres auteurs ont identifié la mère de toutes les batailles : la lutte contre les inégalités. Un vaste courant de pensée a pris forme dans les pays développés pour imposer une « éthique » du capitalisme, le forcer au « partage ». La sénatrice démocrate Elizabeth Warren, candidate éphémère à l'investiture de son parti, avait proposé d'imposer une taxe de 2 % sur les fortunes supérieures à 50 millions de dollars et de 6 % sur celles qui dépassent le milliard de dollars. Selon ses calculs, ces nouveaux impôts permettraient de lever 3 750 milliards de dollars en dix ans, qui pourraient être consacrés aux budgets sociaux, médicaux et éducatifs des États-Unis. Les économistes français Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, tous deux professeurs d'économie à l'université de Berkeley, plaident-ils ainsi pour une refonte de la fiscalité sur les riches dans leur livre Le Triomphe de l'injustice(4). Faisant, comme d'autres, le constat « que le système économique laisse au bord de la route une partie croissante des classes moyennes et populaires » et que « les ultra-riches s'acquittent de taux d'imposition qui sont désormais inférieurs à ceux des classes moyennes », ils proposent d'augmenter l'imposition des grandes fortunes. Selon le modèle qu'ils ont élaboré, et qui est développé sur un site Internet dédié (Taxjusticenow.org), ils montrent qu'aux États-Unis, les ultra-riches ont vu leur taux d'imposition s'effondrer au cours des dernières années, pour atteindre un niveau historiquement bas, jamais vu depuis les années 1920. Ce modèle montre également que si un impôt sur la fortune du type de celui proposé par Elizabeth Warren, avait été en place depuis 1982, la richesse de Jeff Bezos serait aujourd'hui de 59 milliards de dollars au lieu de 160 milliards, celle de Bill Gates de 20 milliards au lieu de 90, celle de Warren Buffet de 14 milliards au lieu de 88, celle de Mark Zuckerberg de 36 milliards au lieu de 61. Ces calculs ont le mérite de démontrer l'impact de la fiscalité sur la constitution et l'accroissement des grandes fortunes. Mais les chances de voir mise en oeuvre une telle réforme aux États-Unis sont minces. D'abord parce que le déclin de la progressivité de l'impôt est un phénomène mondial et que les écarts de fortune se sont considérablement creusés dans de nombreuses économies du monde, y compris dans les pays émergents.
Freiner la concurrence fiscale
Comme le soulignent d'ailleurs Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, la relative passivité des États, depuis les années 1980, face à ce phénomène mais aussi face à l'évasion fiscale et au recours aux paradis fiscaux, a créé des situations de fait que l'on éprouve bien des difficultés à traiter aujourd'hui, comme le démontrent les laborieuses négociations sur la taxation des Gafa. Enfin, il sera très difficile de donner un coup d'arrêt à la concurrence fiscale entre les États, qui demeure une arme redoutable dans la compétition économique mondiale.
La grande leçon de l'histoire économique est que le capitalisme a toujours su s'auto-réformer. Il ne le fera encore que si ses acteurs, les investisseurs, les entreprises, les financiers, convergent progressivement vers une vision commune de ce que pourrait être, dans les années qui viennent un « capitalisme durable ». Inverser la logique de l'accélération dans la recherche de profits, de rendement et d'accumulation suppose que les acteurs du capitalisme s'accordent sur un point essentiel : ne pas le faire est plus risqué que de le faire. Autrement dit, reconnaître et accepter le fait que les externalités négatives de la croissance (notamment les dérèglements climatiques et l'instabilité sociale) généreront un coût économique que la croissance ne permettra plus d'assumer. On voit aujourd'hui que deux mouvements sont engagés.
Le premier est celui de l'investissement éthique : 500 fonds ESG (respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) ont été lancés sur les principaux marchés mondiaux en 2019. À la condition que la matérialité des efforts annoncés en matière d'émissions de gaz à effet de serre dans les entreprises dans lesquelles investissent ces fonds, soit rapportée, ce qui est loin d'être le cas, selon une analyse de The Economist (« The Trouble with Green Finance », 20-26 juin 2020), cette tendance est porteuse d'un changement d'état d'esprit progressif. Le second mouvement mobilise les entreprises dans un dialogue plus riche avec l'ensemble de leurs parties prenantes, visant à élargir leur contribution au « bien commun ».
Même si ce terme mériterait d'être explicité et surtout contextualisé, cette approche est porteuse de changements profonds, pouvant lancer une réflexion sur le « ralentissement » du système capitaliste dans son ensemble. C'est de la puissance respective de ces deux mouvements et surtout de leur convergence dont dépend tout processus crédible et pérenne d'un changement de paradigme dans les logiques actuelles du capitalisme.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. « Un Pouvoir implacable et doux. La tech ou l'efficacité pour seule valeur », Philippe Delmas, Fayard, 2019.
2. "Globalists. The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, Quinn Slobodian", Harvard University Press 2018.
3. "Licence to be Bad. How Economics Corrupted Us", Jonathan Aldred (Allen Lane, 2019).
4. « Le Triomphe de l'injustice. Richesse, évasion fiscale et démocratie », Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, Le Seuil, 2020
---

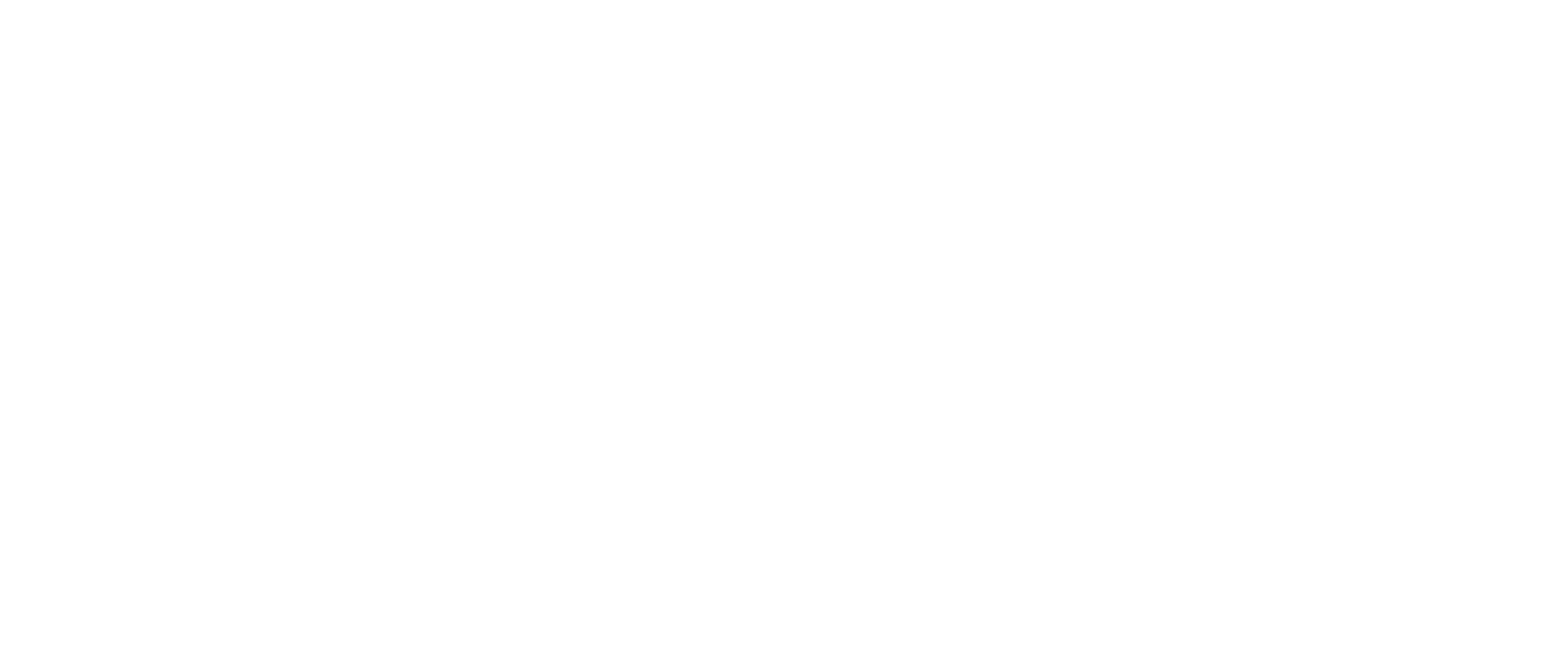


 Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français
Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français

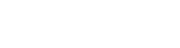
Sujets les + commentés