On ne compte plus les rapports qui évoquent sans cesse la « fin imminente du travail » ; selon une étude de Roland Berger, ce sont 42 % des emplois qui devraient disparaître à court terme. McKinsey parle de cinq millions d'emplois potentiellement à risque, uniquement dans les transports aux États-Unis. Les acteurs politiques ne sont pas en reste ; s'ils ne comprennent généralement que mal les enjeux de la révolution digitale, ils n'hésitent pas à exacerber les aspects les plus anxiogènes de celle-ci pour mieux apparaître comme des sauveurs providentiels, disposant des solutions pour vivre dans la société de l'après-travail.
Ainsi, un candidat à la présidentielle évoque la disparition du travail comme certaine ; il proposera comme solution la mise en place d'un revenu minimum universel. Rapidement, des analyses faites par le think-tank Institut Montaigne démontreront le coût exorbitant d'une telle mesure.
L'idée, sympathique au premier abord, est soudainement devenue irréaliste. Et tant pis s'il ne semble pas y avoir de solution à un chômage de plus en plus ancré dans le « modèle français », et s'il ne paraît y avoir que peu d'alternatives aux potions amères de type zero-hour jobs ou loi Hartz, telles que le Royaume-Uni et l'Allemagne les ont adoptées pour revenir au plein-emploi.
En réalité, il existe un sous-jacent important aux politiques publiques liées à l'emploi, et plus largement à l'ensemble des politiques publiques. Ce sous-jacent se dénomme productivité. Ce qui, fondamentalement, permet à l'économie et au système social de la France d'être tout à fait différent de ceux des pays à faibles revenus, c'est avant tout la productivité. Avec une productivité horaire de 63 $ par heure en 2015 (OCDE), la productivité française est de dix à vingt fois plus importante que celle des pays en développement les moins avancés. Or, cette productivité est issue d'un mix de facteurs rarement analysés ensemble : la qualité de la formation, la disponibilité du capital, les effets de spécialisation des acteurs économiques dans une région donnée, etc.
Quelle traduction dans la réalité économique ?
L'autre facteur intéressant à confronter à la productivité, c'est celui de la révolution digitale. Si révolution industrielle ou économique il y a, elle doit nécessairement se traduire en termes d'accroissement de la productivité. Une évidence qu'il serait bon de rappeler à tous ceux qui ne cessent de nous alarmer sur la disparition imminente du travail par l'automatisation de toutes les tâches. S'il est indubitable que la technologie initie de grands changements, cela ne se traduit que peu dans les indices économiques. L'enjeu est ici justement de comprendre cette dichotomie entre ce que les machines nous donnent à voir et leur traduction en réalités économiques.
Ce document est scindé en deux parties : L'enjeu de la productivité - ce que l'on observe et ce que l'on peut en attendre en matière de productivité et Productivité et emploi, soit l'impact actuel et futur sur l'organisation du travail et de la formation.
1. L'ENJEU DE LA PRODUCTIVITÉ
Productivité, révolution digitale et Intelligence artificielle : quelles relations ?
Si, comme l'écrit si bien Paul Krugman, « la productivité n'explique pas tout, mais sur le long terme, elle explique presque tout », elle devrait être un sujet majeur d'intérêt. Or, elle n'intéresse généralement que peu le néophyte, et est souvent mal comprise. On l'évoque fréquemment comme une constante, sur laquelle les politiques publiques et parfois même les modèles de management n'ont que peu, ou pas, d'impact.
Qu'est ce que la productivité ? Elle fait que nous ne risquons plus - du moins en Occident - de faire face à des famines de masse, elle permet toute la prospérité qui nous entoure : routes, voitures, chauffage, nourriture, éducation, santé, loisirs... sont finalement le résultat de la productivité. Depuis le début de la Renaissance, la productivité par habitant de l'Europe s'est élevée d'un facteur supérieur à 100. La richesse produite par un Européen était alors de 200 $ par an, pour s'élever aujourd'hui à environ 35 000 $, soit 175 fois plus, créée dans un délai beaucoup plus court qu'autrefois (voir illustration I).
Or, alors qu'on ne peut pas consulter un quelconque média sans être confronté à la notion de « révolution numérique », il convient de juger celle-ci à l'aune de la seule unité de mesure vraiment pertinente à l'égard d'une révolution que l'on dit a minima économique : celle de la productivité. Et si révolution il y a, cela doit nécessairement se traduire par des améliorations notables de la productivité, comme cela fut chaque fois observé lors des deux précédentes révolutions industrielles.
C'est bien là où le bât blesse, car, à l'égard de l'informatique, il a toujours existé une polémique récurrente en matière de productivité. Dès les années 1970, les économistes mirent beaucoup d'espoir dans cette discipline que l'on dénommait alors cybernétique (du grec « gouvernail »). De plus en plus de sociétés s'en servaient alors pour des tâches très répétitives, comme la réalisation des bulletins de paie. Au début des années 1970, l'expertise technologique était alors limitée à quelques très grandes sociétés telles que la Compagnie des machines Bull, International Business Machine (IBM), la Compagnie Générale d'Informatique (CGI) et quelques autres acteurs de second plan. Les choses changèrent en quelques années lorsque l'on comprit que l'informatique était capable d'effectuer des tâches plus complexes, de comptabilité, de gestion financière, ou encore de production industrielle... Bien avant le boom des années 2000, l'informatique en tant que secteur économique à part entière connut un fort développement.
Tout le monde s'attendit à un accroissement rapide de la productivité, particulièrement dans les services, grâce aux ordinateurs. Nombre de revues de vulgarisation et de livres d'anticipation évoquaient la possibilité d'automatiser et de robotiser massivement tous types de tâches : les ordinateurs dessineraient pour nous les voitures de demain, calculeraient la façon la plus solide de construire des ponts, les robots feraient le ménage, et les hôtels ne seraient plus administrés que par des ordinateurs.
Mais on fut déçu. En 1987, l'année même où il reçut un prix Nobel, l'économiste Robert Solow déclara : « On peut voir l'ère digitale partout, sauf dans les statistiques de la productivité », signifiant par là que les techniques informatiques n'augmentaient pas plus la productivité que celles qui préexistaient.
L'ensemble de ce constat partait d'une analyse détaillée des trois facteurs qui contribuent à la croissance : la mise à disposition du capital, la qualité du travail et le progrès technologique. Une économie idéale permet de faire en sorte que le système productif puisse disposer d'une ressource abondante en capital, d'une main-d'oeuvre dont la qualité augmente régulièrement et surtout, que les innovations technologiques permettent d'accroître la productivité et la demande des consommateurs. Solow donne une importance toute particulière à ce dernier facteur, qu'il considère largement prépondérant. C'était à peu près le paradigme des années glorieuses, à ceci près qu'il était biaisé par un accès à une énergie bon marché, qui a longtemps masqué nombre de dérèglements affectant l'outil productif.
Dans un premier temps, Robert Solow avait été un fervent défenseur de l'idée que les ordinateurs pourvoyaient à l'augmentation de la productivité dans tous les secteurs, tant cela démontrerait l'importance de son troisième facteur productif - l'innovation technologique - et il chercha longtemps à faire la démonstration de son intuition. Mais qu'il s'agisse d'analyses macroscopes ou sectorielles, il observait - comme l'ensemble des économistes à cette époque - un clair décrochage dans la croissance de la productivité entre les périodes 1950-1970 et 1970-1980. Dans la première période, les gains de productivité - très variables d'une région à l'autre de la planète avaient été de l'ordre de 2 % à 3 % par an, tandis que dans la seconde, ils se situaient poussivement entre 1 % et 1,5 %.
Malgré le caractère particulièrement innovant de l'ère informatique, Solow fut incapable de traduire cela en accroissement de la productivité.
Sa déclaration devint si célèbre qu'elle est aujourd'hui couramment dénommée par les médias « paradoxe de Solow ». Solow devint d'ailleurs, tout au moins aux États-Unis, une star des plateaux de télévision consacrés à l'économie, cela d'autant plus que la productivité continue, trimestre après trimestre, de provoquer des sueurs froides chez les macro-économistes, qui connaissent mieux que personne son importance pour améliorer le sort d'une nation.
La baisse de la croissance de la productivité au XXIe siècle
Les choses furent loin de s'améliorer : malgré une petite remontée au cours des années 1990, la croissance de la productivité a continué à se réduire. Entre 2000 et 2008, elle n'a été dans la plupart des grands pays de l'OCDE que de l'ordre de 1,1 % par an et depuis la crise de 2008 - et pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale -elle est devenue inférieure à 1 %, tout au moins dans un certain nombre d'économies parmi les plus avancées. Ainsi, au Royaume-Uni, elle fut même négative pendant les années de l'après-crise financière, ce qui représente une perspective plus qu'inquiétante car, sans gains de productivité, il n'y a pas d'accroissement de richesses autrement qu'en déshabillant Paul pour habiller Pierre. La question de la baisse de la croissance de la productivité fait largement débat et plusieurs thèses s'affrontent. L'une, défendue avec brio par l'économiste Robert Gordon, postule tout simplement le fait que les grandes découvertes sont terminées (moteur à explosion, chimie fine, électricité, etc.) et qu'il nous faut nous résoudre à une grande « stagnation séculaire » où les nations devraient évoluer dans un contexte de changements très lents en matière de productivité, et donc de création de surcroît de richesse.
Si Robert Gordon reconnaît que les innovations continuent de se produire, il considère qu'elles n'ont plus la même amplitude :
« Quand les gens utilisent Facebook, cela ne crée pas plus d'emplois, et cela ne permet pas aux entreprises de payer des salaires plus importants... C'est quelque chose que les consommateurs apprécient, mais pas quelque chose qui diffère radicalement de ce qu'était la télévision une génération auparavant ».
Robert Gordon est particulièrement critique à l'égard de la révolution digitale dont il considère qu'elle n'a amené que des innovations mineures, certainement pas comparables avec celles de la précédente ère. En cela d'ailleurs, il est rejoint par l'entrepreneur Peter Thiel, cofondateur de Paypal avec Elon Musk, qui déclara un jour « Nous voulions avoir des voitures volantes, nous avons eu des messages de 140 caractères à la place ».
Mais la thèse de la stagnation séculaire est largement contestée. Nombreux sont d'ailleurs les chercheurs qui considèrent même que le thermomètre de la productivité est contestable. Des économistes comme Bruce Chew font ainsi observer que l'on a mis des décennies à mesurer à peu près convenablement la productivité industrielle, qui a ensuite migré dans les services et pour lesquels la méthodologie de mesure de la productivité a dû être reconstruite. Or, alors que celle-ci ne se mesure en effet qu'à l'intérieur des entreprises, il n'est pas impossible que l'apport du numérique affecte avant tout la productivité domestique. Il est également possible que les employés de bureau soient plus productifs à l'intérieur du temps imparti et qu'ils aient plus de temps libre, temps invisible des analyses économiques de productivité, car ce temps serait utilisé au sein de l'entreprise, à la cafétéria par exemple. Ainsi, en théorie, un cadre qui ferait son travail en trois fois moins de temps mais qui continuerait à aller travailler huit heures par jour ne serait pas identifié comme étant plus productif qu'auparavant. D'autres économistes, comme Jonathan Rothwell (Gallup), ou encore Martin Baily (Brookings Institution) pensent, eux, que la baisse de la productivité est plus généralement due à une mauvaise régulation empêchant les facteurs innovants d'apparaître, tout en protégeant les acteurs traditionnels de façon exagérée. Ce serait selon eux le cas du monde de la finance ou encore de l'assurance, mais également du monde des transports aériens ou de celui de la santé qui tous seraient excessivement protégés, empêchant de nouveaux acteurs d'apparaître.
Nombreuses sont les variantes de cette thèse : des économistes de l'OCDE, comme Giuseppe Nicoletti, affirment que c'est tout simplement l'excès de régulation qui altérerait la croissance en réduisant les gains de productivité au travers de normes de plus en plus contraignantes. Dans l'autre camp se trouvent principalement Erik Brynjolfsson, qui s'est rendu célèbre dès 1993 pour avoir écrit le manifeste The productivity paradox of information technology ainsi qu'Andrew McAfee avec lequel le premier écrivit en 2009 Le second Age de la machine, ouvrage où tous deux prophétisaient d'importants gains de productivité à venir.
Cette thèse, longtemps considérée comme manquant de fondements, semble désormais étayée par différents travaux.
Dès 2007, une étude signée par l'économiste Robert Atkinson affirma que les gains de productivité issus du numérique étaient considérables, et cette étude fut une première étape dans la mesure où elle documentait assez précisément le surcroît de productivité des entreprises digitales, comparées à leurs consoeurs traditionnelles. Pour la première fois, l'étude souligne qu'« il est improbable que le secteur du numérique crée un nombre proportionnel d'emplois avec sa taille. En partie car la productivité de ce secteur est telle qu'elle lui permet de produire beaucoup avec moins de travailleurs. »
Puis, en 2015 et 2016, de nouveaux travaux de l'OCDE, menés par des équipes indépendantes les unes des autres, démontreront que les firmes globales ayant réussi à mettre en oeuvre des hauts degrés de capital humain et de technologies sont sensiblement plus compétitives que les autres et que leur productivité croît beaucoup plus vite qu'ailleurs, et surtout qu'auparavant. Les chiffres qui y sont rapportés sont sans équivoque : les études menées sur des milliers d'entreprises parmi les plus performantes montrent des niveaux de productivité sensiblement plus importants que ceux que l'on observe au sein des firmes les moins performantes... Il s'agit là encore une fois de ratios élevés, et plus élevés que ceux que l'on observait par le passé, semblant ainsi attester de l'existence d'un nouveau paradigme en matière de production. En mars 2017, une étude approfondie, réalisée par l'Information Technology and Innovation Foundation, a également fait le constat de l'existence de gains de productivité très significatifs (trois à cinq fois supérieurs à ce qui était initialement envisagé par les protagonistes les plus optimistes).
Dès aujourd'hui comparer les résultats par employé d'Apple, Google et Facebook par rapport à la holding de Warren Buffet (Berkshire Hathaway), considérée comme la plus rentable au monde, démontre que le niveau de productivité dans les entreprises de la première catégorie est sensiblement supérieur.
Il semble donc désormais possible de réfuter l'affirmation de Robert Solow et de faire la démonstration statistique qu'une révolution productiviste, et peut-être plus, est en cours. Cela soulève cependant deux questions d'importance. Pourquoi donc ces techniques ne se diffusent pas plus largement dans le monde et pourquoi n'observe-t-on pas des gains de productivité à une échelle macroéconomique, et pourquoi ceux-ci sont-ils visibles seulement de façon microéconomique ? Seconde question : pourquoi les nations ont-elles réussi à entrer successivement dans deux révolutions industrielles et pourquoi y aurait-il plus de difficultés à y parvenir cette fois-ci ?
Capital financier, humain et productivité
Nombreux sont les partisans de la théorie de l'« absence de demande », dont le porte-drapeau est certainement Larry Summers.
Ceux-là considèrent que la baisse de la productivité est due à une trop faible demande, ne poussant pas suffisamment les entreprises à créer assez d'innovations pour répondre à de nouveaux marchés ou simplement pour produire plus à moindre coût. Comme Larry Summers l'a déclaré en 2014 lors de son passage à Davos, « sans classe moyenne vigoureuse, il n'y a plus d'accroissement de la consommation, et sans accroissement de la consommation il n'y a plus de croissance [...] et sans croissance, il n'y a plus d'investissement, [...] nous avons donc tous un problème ». Son analyse principale consiste à penser que les surcroîts de richesse sont mal répartis : les bénéfices des entreprises ne sont plus redistribués sous forme de salaires et cela se traduit en une moindre consommation qui ne pousse pas les producteurs à améliorer leurs appareils productifs, à innover. C'est une approche assez simple, mais que les chiffres ne semblent pas démentir. Que ce soit sous forme de distribution sous forme de capital ou de travail, la diffraction est réelle entre les revenus intermédiaires et ceux des très hauts revenus (dirigeants d'entreprise, actionnaires etc.).
Confronter les chiffres des tableaux 4 et 4b à la croissance de la productivité aboutit d'ailleurs au même constat : les gains de productivité n'ont pas été équitablement répartis entre producteurs - rémunération du capital - et travailleurs. La question reste toutefois de savoir s'il y a un rapport entre la répartition des richesses et la baisse des gains de productivité.
L'une des conséquences probables de cette rupture dans l'équité de la distribution pourrait se traduire dans le fait que les salariés ne se forment plus à de nouvelles techniques par manque de temps et de moyens. Larry Summers pense d'ailleurs également que l'absence de capital humain bien formé est l'un des problèmes qui expliquent la baisse de la productivité.
Si, au cours de la première révolution industrielle, le capital humain représentait un facteur probablement très secondaire, dans la mesure où les quasi-esclaves qui travaillaient avec les hauts-fourneaux et métiers à tisser n'avaient besoin que d'une formation rudimentaire pour mettre en oeuvre ces techniques, il est devenu surdéterminant à une ère - celle de la seconde révolution industrielle - où les technologies se sont sophistiquées et nécessitaient des niveaux d'expertises élevés pour être mises en oeuvre. Savoir lire, écrire et compter est ainsi nécessaire pour pouvoir envoyer un télégramme, monter un moteur électrique sur une unité de production ou provoquer une opération de catalyse dans les processus de transformation chimique. Ce n'est donc pas un hasard si l'éducation devint alors obligatoire à la fin du XIXe siècle dans la plupart des pays qui aujourd'hui composent l'OCDE : la nécessité de disposer d'un capital humain propre à mettre en oeuvre des techniques plus avancées devint indispensable au développement des nations. Et, tout au long du xxe siècle, la durée éducative a continué à croître. En France par exemple, la durée obligatoire de l'éducation est passée de 8 à 15 ans en trois générations environ.
L'économiste Thomas Piketty relève d'ailleurs avec justesse que le retard européen observé durant des décennies par rapport aux USA en matière de productivité s'expliquerait « par un relatif retard éducatif : la faible population américaine est entièrement alphabétisée dès le début du XIXe siècle, alors qu'il faut attendre la fin du siècle pour qu'il en soit de même en France, à un moment où les États-Unis sont déjà passés à l'étape suivante (l'enseignement secondaire de masse, puis le supérieur). C'est l'investissement éducatif des Trente glorieuses qui permet à la France et à l'Allemagne d'effectuer un rattrapage historique sur les États-Unis entre 1950 et 1990. Le véritable enjeu aujourd'hui est de maintenir et d'amplifier cette évolution.
À l'inverse, le retard persistant de la productivité britannique, qui n'a jamais atteint le niveau américain, est généralement attribué aux faiblesses historiques de son système de formation. De même, le décrochage de l'Italie depuis le milieu des années 1990 peut s'expliquer pour partie, d'après une étude récente, par l'insuffisance des investissements éducatifs. »
Il s'agit d'une analyse certes radicale, mais finalement assez difficile à contester, tant la maîtrise des techniques est un élément déterminant de la productivité. La note du Trésor à laquelle fait d'ailleurs référence Piketty est assez élégante dans sa démonstration. Au cours des Trente glorieuses, la qualification du capital humain avait également eu l'occasion de démontrer son importance dans la croissance de la productivité. Ainsi, lorsque les missions de productivité furent instituées par l'économiste Jean Fourastié, au cours de l'année 1949, il parvint à accroître la productivité de nombreuses filières (textile, construction automobile, agroalimentaire etc.) simplement en envoyant des milliers de contremaîtres, ingénieurs, ouvriers aux États-Unis pour apprendre les meilleures techniques en matière de production. Ainsi, la confection d'un costume passa de 240 heures à 70 heures, celle d'une automobile de 17000 heures à environ 4 500 heures, et ainsi de suite.
Incidemment, il est intéressant de relever l'observation des économistes Jean-Michel Boussemart et Michel Godet : selon eux, il existerait une relation nettement visible entre les gains de productivité et la part des jeunes actifs qui sont effectivement au travail. Mieux : les caractéristiques des périodes de très forte croissance du PIB et de la productivité (les Trente glorieuses sont prises en exemple) coïncideraient à des moments où les jeunes actifs seraient particulièrement mobilisés au sein de l'outil productif. Ce type d'observation rejoint d'ailleurs les observations faites par l'économiste Paul David qui note que les techniques sophistiquées sont généralement plus aisées à mettre en oeuvre par les jeunes générations. En particulier, il s'intéressera longuement à l'émergence des techniques de la seconde révolution industrielle, dont les gains de productivité se matérialisèrent, selon lui, plus de quarante ans (soixante-dix ans dans le cas du moteur électrique) après leur invention, tant il est difficile pour les responsables d'outils productifs de comprendre ce que ces techniques nouvelles impliquent.
Capital humain et révolution numérique
Or, cela a été dit plus haut, la grande caractéristique de cette révolution digitale, c'est d'être avant tout composée de KBC : Knowledge Based Capital, comme le définit l'OCDE. En d'autres termes, ce n'est plus principalement la disponibilité du capital financier, et même l'innovation technologique - les technologies numériques sont, au moins pour leur part logicielle, étonnamment ouvertes et libres de droits - qui sont les sous-jacents de l'avantage compétitif des temps à venir, mais en premier lieu la qualité du capital humain. Nombreuses sont à cet égard les analyses qui démontrent que les nations les plus dynamiques sur le plan économique sont également celles qui disposent du meilleur capital humain.
Il est donc assez aisé d'en déduire que les nations qui vont également le mieux réussir à moyen terme seront celles qui auront réussi à massifier des systèmes de formation de qualité. Ces investissements se révèlent donc d'ores et déjà plus performants en gains de productivité que les autres, particulièrement ceux effectués dans le logiciel. Dans la même logique, une analyse préliminaire consistant à comparer le DESI (The Digital Economy and Society Index) avec la performance éducative semble démontrer que les nations les plus dynamiques sont aussi celles qui disposent de systèmes éducatifs de qualité.
Mais, dans la mesure où la révolution digitale est faite de technologies qui sont particulièrement sophistiquées, la marche à franchir pour disposer d'une base de capital humain de bonne qualité à volume élevé est particulièrement haute : le directeur technique de Google France concède préférer recruter « en priorité à l'École Normale Supérieure et à Polytechnique [...], les autres écoles venant... après ». Ce qui donne une idée assez claire du niveau d'expertise requis... Pour l'instant, les travailleurs digitaux sont incroyablement peu nombreux, de l'ordre de 10 à 15 millions à l'échelle de la planète ; ils ne représentent donc pas plus d'1% de l'ensemble des travailleurs. Rien ne promet que la transition vers un monde du travail où ces travailleurs seraient nettement plus nombreux soit réellement possible.
Il ne faut d'ailleurs pas s'étonner que les nations les plus performantes en matière digitale sont généralement des nations d'immigration ou/et disposant de grandes diasporas (États-Unis, Chine, Royaume-Uni, Israël...) ; leurs creusets initiaux de compétences, aussi pointues soient-elles, ne parvenant pas à suffire pour répondre aux besoins de sociétés hypertechnologiques et hyperspécialisées.
Tout cela répond particulièrement bien au modèle décrit par Erik Bryndjolfsson et Andrew McAffe : celui de nations technologiques, où le marché du travail absorbe sans difficulté la vaste majorité des diplômés du supérieur, malgré leur accroissement très sensible, tandis que les travailleurs peu qualifiés voient leurs rémunérations proportionnellement baisser et le travail se raréfier, tant ces types de positions sont en concurrence avec la machine.
Cette tendance devrait s'avérer immanquablement assez croissante. En effet, malgré un phénomène certain de « démondialisation » et de remontée des barrières douanières, l'une des caractéristiques du monde qui vient est la globalisation des idées, des techniques et dans une vaste mesure, des services numériques. Ainsi, l'apparition d'un service numérique comme WhatsApp, inventé à l'autre bout des États-Unis, ne mettra que quelques trimestres avant de commencer à perturber de nombreux marchés, en apparence fermés, d'opérateurs de télécoms nationaux. Dans certains pays, la part de minutes de téléphones utilisant WhatsApp est déjà supérieure à celle utilisant les réseaux téléphoniques traditionnels. L'innovation de rupture se substitue donc à l'innovation incrémentale et les compétences nécessaires pour la mettre en oeuvre différent largement de celles qui précèdent.
L'importance du capital humain n'en est que plus aiguë, et s'exprime au travers d'une double injonction : la nécessité de former largement et à un niveau élevé les populations ; la part plus relative de la formation initiale par rapport à la formation continue, pour répondre aux enjeux de cycles d'innovations plus raccourcis et globalisés. Il est donc vraisemblable que si la révolution digitale ne s'exprime que très partiellement, c'est la conséquence du fait que les compétences manquent cruellement. Il est remarquable d'observer que plus de 80 % des effectifs de Google aux États-Unis sont composés d'ingénieurs (soit environ 50 000), tandis que le pays entier n'en forme qu'un peu plus de 90 000 par an. Une seule société peut ainsi disposer de plus de la moitié d'une promotion annuelle d'ingénieurs !
Certes, il n'y a pas que les ingénieurs au coeur de cette révolution. On y trouve également des designers, des programmeurs, des experts du marketing. Mais les ingénieurs sont parmi les rares à disposer de compétences scientifiques et techniques assez homogènes dans un grand nombre de disciplines. Ils disposent aussi de formations en mathématiques assez poussées, une dimension essentielle dans la part algorithmique que comprend la programmation.
Scénarios pour la productivité : des facteurs positifs...
Il est difficile de prédire ce que pourrait être le devenir de la productivité, tant les scénarios sont variés. Or, si la productivité ne croît pas, il sera difficile de parler de révolution industrielle.
Dans la mesure où son origine est largement multifactorielle, elle reste dépendante de la conjonction de nombreuses hypothèses, positives pour certaines, négatives pour d'autres. Dans les facteurs positifs, on trouvera donc :
L'autoformation massive via les Moocs et plateformes en ligne.
Il y a deux ans, la plateforme Codeacademy disposait de 24 millions d'utilisateurs. Elle est ainsi devenue l'un des sites les plus populaires - avec Codeschool, le français OpenclassRooms (Fr), dataCamp... - pour l'enseignement de codes tels que Python, le code le plus populaire actuellement aux États-Unis. Il est probable que le développement des Moocs et autres plateformes de formation vienne accélérer ce phénomène et permettre une massification de la distribution des connaissances dans le domaine du numérique, s'affranchissant aussi largement des disparités qualitatives existant entre les nations en matière de qualité éducative.
Il n'est pas impossible d'envisager que d'ici à cinq ans, sensiblement plus de 100 millions de personnes auront accès à une formation au code via une plateforme numérique. L'impact d'une telle dynamique est donc relativement fort.
Doublement global du nombre de diplômés issus des STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics) dans les cinq ans à venir.
La dynamique est régulièrement relevée par les statisticiens : il existe une accélération forte en matière d'étudiants diplômés dans les « STEM », emmenée par la Chine, mais également, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran. Des pays comme la France, les États-Unis, le Royaume Uni, ont également des politiques d'expansion, plus ou moins efficaces dans ces filières. Si la probabilité qu'on assiste à un doublement du nombre d'ingénieurs diplômés est importante d'ici à cinq ans, l'impact pourrait en être plus modéré.
D'une part, cette massification se fait au détriment de la qualité des cursus dans de nombreux pays, et d'autre part, ces formations ne comprennent que dans une minorité de cas des volets numériques suffisamment consistants pour permettre la mise en oeuvre de ces technologies. Toutefois, comme observé plus haut, même en doublant le nombre d'étudiants qualifiés dans les « STEM », leur nombre resterait presque insignifiant face à la masse générale des travailleurs arrivant sur le marché du travail sans qualification ou avec des qualifications intermédiaires. Il est possible que le point central de la concrétisation de la révolution industrielle se trouve là.
« Packaging » du code en mode accessible pour les développeurs.
Des technologies complexes, comme le cloud il y a dix ans, ou l'intelligence artificielle d'ici à quelques années, deviennent de plus en plus accessibles à des développeurs non spécialisés du fait de la mise en place de solutions pré-packagées. Ainsi Amazon Web Service a été un acteur de premier plan dans la démocratisation des solutions de cloud, en industrialisant des offres sophistiquées, simples d'accès pour le monde numérique. Il est vraisemblable que cette démocratisation ait un impact significatif sur la dissémination des technologies numériques dans des secteurs plus traditionnels.
Amélioration des expériences utilisateurs (UX).
D'une façon générale, le raffinement des expériences utilisateurs, qu'il s'agisse de produits ou de services disponibles dans des environnements professionnels, ou encore de consommateurs disposant d'interfaces plus conviviales, est également de nature à impacter la productivité. Il permet en effet au plus grand nombre, et en particulier à ceux qui n'ont pas nécessairement de fortes compétences digitales, d'accéder à des outils sophistiqués, comme l'intelligence artificielle.
Émergence massive de l'intelligence artificielle.
Dans l'intelligence artificielle, on assiste à des logiques semblables à ce qui est expliqué dans le précédent paragraphe : l'IA, encore réservée il y a peu de temps à des experts chevronnés ou même à des chercheurs, peut désormais être mise en oeuvre par des codeurs qui n'ont pas nécessairement la compréhension de « ce qui est dans la boîte ». Dans la mesure où le propre de l'intelligence artificielle consiste à automatiser des tâches à fort niveau d'incertitude (conduire une voiture, converser avec un être humain, etc.), il est raisonnable d'attendre des gains de productivité très importants grâce à cette technologie et cela dans un temps d'autant plus rapproché que celleci a fait des progrès considérables ces dernières années, du fait de découvertes (GPU, gestion des couches réseaux de neurones...) que l'on peut qualifier de fondamentales.
Accroissement du capital disponible pour l'innovation.
Il est notable que partout dans le monde le capital-risque croît. Cela correspond aux besoins d'une nouvelle ère, où l'innovation de rupture a remplacé l'innovation incrémentale du fait que la connaissance est désormais largement accessible et que les innovations « par associations de techniques » sont désormais plus faciles d'accès. Il est également notable que les pays disposant d'un accès aisé au capital-risque (États-Unis, Chine, Suède, Royaume-Uni, Israël...) disposent d'un niveau de développement de leurs scènes startups sans précédent. Les rendements croissants du capital-risque tendent à généraliser la disponibilité de ce type de financement, tant dans les pays mentionnés que dans l'ensemble des autres, où se trouvent des startups.
... Et dans les facteurs négatifs
La fin de la loi de Moore.
Souvent annoncée, pas encore effectivement constatée, la loi de Moore [la puissance des microprocesseurs double tous les deux ans, ndlr] devrait toutefois, selon les experts, connaître une fin brutale pour des raisons physiques (les transistors approchent de la taille des atomes), d'ici quelques années. Pour autant, l'impact devrait en être limité dans la mesure où d'autres designs devraient permettre de continuer à augmenter la vitesse de calcul des processeurs. De surcroît, des technologies alternatives apparaissent (photoniques, quantiques, amélioration des logiciels).
Augmentation du coût de l'enseignement.
Il s'agit là d'un constat en apparence contreintuitif, mais différents travaux de recherche tendent à démontrer que le coût de l'enseignement supérieur ne cesse de croître, une dynamique qui tend à ralentir une massification de l'accès des classes populaires à l'enseignement. Toutefois, si cette dynamique est préoccupante, elle relève également l'importance que prend le savoir au sein d'une ère dont il est tout simplement devenu la matière première.
Impossibilité de démocratiser les compétences les plus pointues.
En France, le besoin en data-scientists serait, selon Yves Poilane, le président de l'école d'ingénieurs Suptelecom ParisTech, trois à quatre fois supérieur au nombre de diplômés dans cette discipline. Les débouchés très valorisants que l'on trouve dans ces métiers ne sont peut-être pas assez médiatisés. Il est à craindre que le manque de data-scientists, en France comme ailleurs, ait une origine plus structurelle : l'impossibilité de trouver des compétences initiales, en mathématiques, qui soient d'un niveau suffisant. Si cela ne pose pas de problème majeur pour mettre en oeuvre des technologies « pré-packagées », c'est beaucoup plus pénalisant pour faire de la recherche ou développer des technologies sophistiquées. Il est vraisemblable que la clé de l'accélération de la révolution digitale se trouve soit dans la capacité à massifier les compétences digitales, soit en celles qui consistent à démocratiser les technologies également digitales.
L'illustration 7 le met clairement en évidence : si, en dehors du nucléaire, les technologies de la seconde révolution industrielle ont été maîtrisées, ce n'est pas encore le cas de celle de la révolution digitale où les compétences continuent à manquer dans bien des domaines essentiels.
Éviction des compétences, par pays et / ou par filières.
Si les compétences essentielles venaient à manquer, ce qui est déjà le cas, il est à craindre que les secteurs les moins rentables, ou les économies les moins productives, se trouvent face un « effet de marche » et, ne parvenant pas à attirer les compétences essentielles, se déclassent peu à peu, tandis que les experts rejoignent des sociétés ayant des gains de productivité et donc des marges plus fortes du fait de leur expertise digitale. Un phénomène que l'on peut déjà observer au niveau des PME en France. Celles-ci, du fait de leur faible rentabilité, ne parviennent que difficilement à attirer les compétences digitales, accélérant d'autant leur retard dans leur transformation.
Concentration des plateformes.
Dans de nombreux pays, les autorités de la concurrence voient avec une inquiétude croissante l'émergence d'acteurs qui, ne suivant pas les règles classiques de l'économie, parviennent à se créer des situations de position dominante très solides. Le risque est évidemment de créer des situations de rente, et de limiter les opportunités d'émergence d'innovations susceptibles de remplacer les acteurs dominants. On évoque d'ailleurs souvent le principe du gagnant qui prend tout « winner takes it all » à l'égard des Gafa et de leurs semblables. Si ce risque est important, il n'est pas certain. Ainsi chacun des Gafa est potentiellement en situation de perdre sa position dominante, notamment en raison de ruptures technologiques. Il serait par exemple intéressant de savoir comment Google va réussir à perdurer avec autant de succès lorsque l'on ne fera plus requête dans Google mais que l'on parlera à une intelligence artificielle, capable de comprendre des demandes beaucoup plus élaborées. Le passage à des économies où les cycles d'innovations sont plus resserrés semble limiter au moins partiellement les positions dominantes durables.
Régulations inappropriées.
Les normes de sécurité, sociales, environnementales sont parfois considérées comme autant de facteurs contraignants, apparus au cours des dernières décennies et expliquant la relative baisse des gains de productivité. À l'égard de la transition numérique, l'enjeu est également significatif. Ainsi, la France et l'Allemagne disposent de réglementations assez contraignantes, qui pourraient par exemple expliquer l'absence de système de santé numérisé, ou de système d'identité électronique. Il en résulte probablement une absence de gains de productivité significatifs du système de santé publique ainsi que des services administratifs.
Concentration des capitaux.
La concentration des capitaux est, selon Larry Summers, l'un des principaux enjeux de notre économie contemporaine. A défaut de croire en la théorie (non démontrée) du ruissellement, il est vraisemblable que les stocks de capitaux soient autant d'opportunités perdues de création de richesses. Les plateformes, en accentuant la non-redistribution, amplifient ce phénomène. S'il est difficile de dire comment y remédier, l'étude d'une situation comparable lors de la transition entre la première et la seconde révolution industrielle a vu cette concentration se résorber lorsqu'une concurrence accrue est apparue. Il n'en est pas moins vrai que ces phénomènes se jouent sur le temps long et créent des dysfonctionnements importants sur le temps court. Des taux d'intérêt continuellement bas accroissent significativement la portée de ce phénomène.
Il est toutefois à noter que la concentration des capitaux aurait au moins une vertu : si elle est la conséquence de fortunes faites grâce aux caractéristiques de la globalisation des marchés ou/et de l'émergence de l'économie numérique, ces fortunes ont plus souvent tendance à être réinvesties dans l'économie numérique, sous forme de capital-risque. Il est notable que l'accroissement de la disponibilité des capitaux pour l'économie numérique a connu une véritable explosion au cours des dix à quinze années passées.
Fragmentation géopolitique de l'Internet.
Si le risque d'une fragmentation totale de l'Internet semble limité, il n'en reste pas moins exact que l'isolationnisme numérique de la Chine consiste en une limitation forte à la propagation de certaines techniques. Un renforcement de cette dynamique, pour l'instant peu plausible, et l'émergence de standards locaux pourraient avoir un impact très préjudiciable sur le développement de la révolution numérique. Le renoncement à Tafta, le traité transatlantique de libre échange, quoi que l'on puisse en penser, a largement achoppé sur le volet « données », tant la relation Europe-États-Unis était déséquilibrée sur ce sujet.

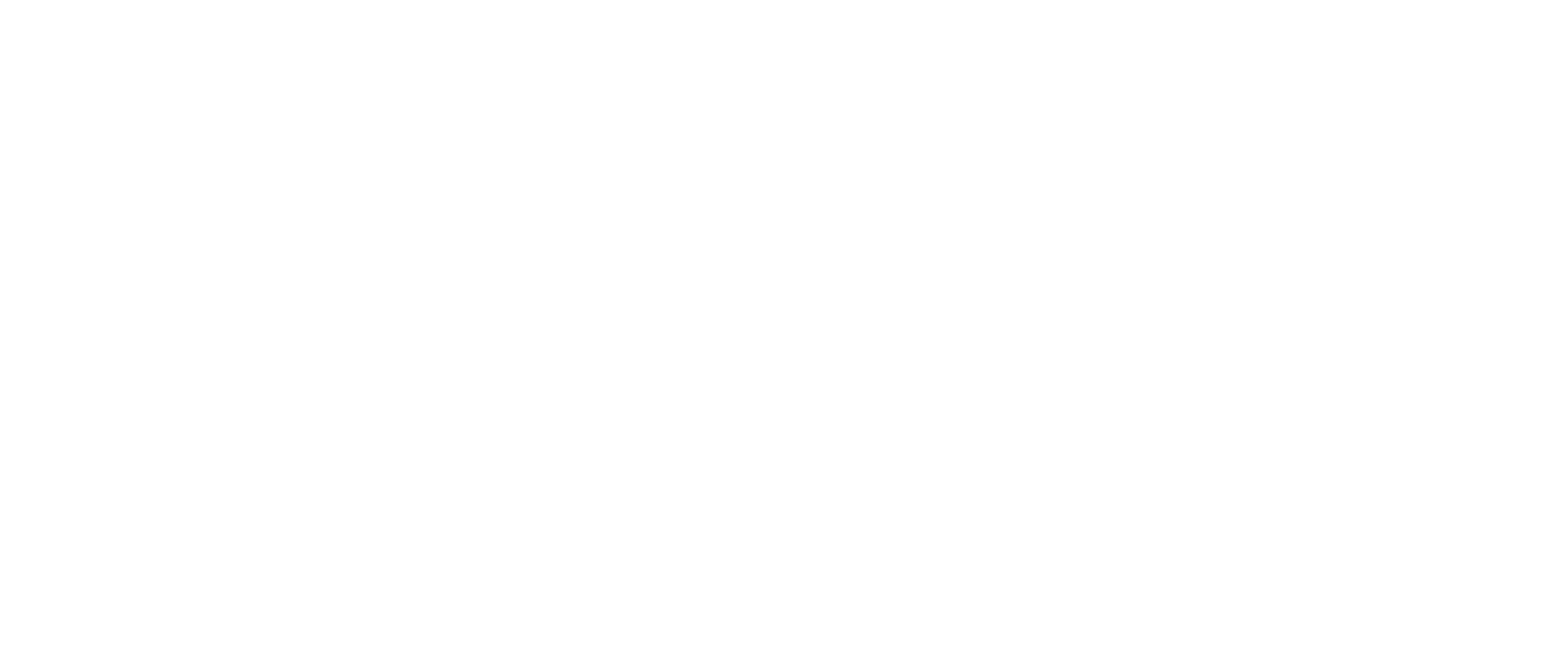
 Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français
Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français

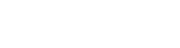
Sujets les + commentés