
S'il ne faut pas confondre qualités littéraires et qualités humaines, certains grands écrivains sont aussi de grands humanistes. Tel Aharon Appelfeld exaltant ce que l'homme a de meilleur en lui après avoir vu, avec le nazisme, ce qu'il avait de pire. Ou tel Albert Camus, ex-rédac chef du journal clandestin Combat, qui refusait de parler de sa résistance mais écrivit La Peste pour nous faire comprendre l'engagement. Et tel l'Irlandais Colum McCann, qui, dans American Mother (à paraître jeudi), met son talent au service de Diane Foley, mère du journaliste indépendant Jim Foley, kidnappé, séquestré et assassiné par Daech ; assassinat dont les images filmées ont fait le tour du monde.
American Mother est à la fois un livre de paix et un livre de combat. On y voit Diane Foley se battre pour la libération de ses compatriotes détenus hors des États-Unis et contre la politique américaine qui refuse tout versement de rançon en cas d'enlèvement à l'étranger mais prône le contraire quand cela se passe sur le territoire national. On la voit surtout lutter pour comprendre. La froideur de l'État - symbolisée par un coup de fil compassionnel d'Obama donné depuis un terrain de golf. Et le parcours de ces jeunes gens nés en Angleterre et devenus bourreaux de Daech.
Comprendre, pas leur trouver des excuses. Approcher par l'empathie ce qu'ils ont d'humain sans jamais oublier ce qu'ils ont commis. Faut-il préciser que si la question des otages se pose dès l'Antiquité, American Mother trouve des résonances cruciales avec l'actualité ?
Exact de bout en bout, American Mother n'en demeure pas moins romanesque. Car Diane n'est pas n'importe quelle héroïne : en elle, ni haine ni naïveté, juste du chagrin sublimé en foi et en activisme tous azimuts. Et McCann n'est pas n'importe quel écrivain : révélé par le splendide Les Saisons de la nuit, célébré pour ses romans biographiques, il a glissé vers la littérature du réel sans perdre le lyrisme maîtrisé de ses débuts et son obsession féconde pour la symétrie. Dans Apeirogon, il décryptait point par point le conflit israélo-palestinien en partant de deux pères endeuillés par la mort d'un enfant.
American Mother se centre sur la seule Diane. Colum McCann a reconstitué le journal de son attente, de son deuil et de sa révolte. Et il a recréé sa confrontation avec l'un des bourreaux de son fils. Un morceau de bravoure, dans tous les sens du terme. La puissance de son message, serti de nuances, nous a convaincus de vous en offrir un extrait en avant-première. ■
EXTRAIT CHOISI
Rien n'est enregistré. Tous les téléphones et les appareils audio restent en dehors de la salle. Mais dans les quelques heures qui vont suivre, chaque syllabe sera le sifflet des vérités et des mensonges.
Elle écoute: telle est maintenant sa mission. Elle doit écouter.
Il est coupable, il le reconnaît, entièrement coupable des infractions qui lui ont été reprochées - assassinat en bande organisée, prise d'otage ayant engendré la mort et soutien matériel à l'État islamique. Il recevra son châtiment. « J'accepte mon sort », dit-il. Il a plaidé en vertu du droit occidental, bien qu'il regrette de n'avoir pas été jugé au nom de la jurisprudence islamique. Il ne croit pas au système judiciaire américain, pour lequel il n'a aucun respect. Il a fait ses choix. « J'avais des supérieurs. J'ai fait ce qu'on me demandait. » Il a participé à la détention et au traitement d'otages, oui. On lui avait dit dès le début de « faire en sorte que leur peau devienne bleue ». Il a frappé James, oui, il le reconnaît, mais seulement deux fois au cours de ses deux années de captivité - d'abord une petite gifle sur le visage à travers le grillage d'une prison, car il pensait que James insultait l'islam, ensuite une série de coups, avec d'autres soldats de Daech, dont feu Mohammed Emwazi, connu dans les médias sous le nom de Jihadi John. Pour James, ç'a été léger, laisse-t-il entendre, « principalement des coups sur le corps ». Il n'est pas celui qu'a dépeint la presse, dit-il en jetant des regards vers la salle. Il n'était pas présent lors de l'exécution. Il n'a pas égorgé le fils de Diane. Il n'a pas filmé la scène dans le désert. Il n'était pas là quand la tête coupée de son fils a été reposée sur
son dos. Il était, dit-il, un soldat de l'islam. « J'étais en guerre. » Il obéissait à
ses supérieurs, mais il n'a assassiné aucun des détenus ce jour-là. Il affirme s'être senti impuissant face aux ordres. Il a tué des gens, oui. Une fois, il a tué un prisonnier d'une balle à l'arrière du crâne, de sang-froid. « J'assume la responsabilité de tout ce que j'ai fait. » Il ne se dérobe pas face à son passé, dit-il. « J'ai fait ce choix et vous avez le droit d'entendre pourquoi. » Il savait ce qu'il faisait en quittant la Grande-Bretagne pour la Syrie. Il a franchi des montagnes pour arriver là-bas. Il se battait pour des tas de raisons, morales, politiques, religieuses. L'invasion américaine de l'Irak. Guantanamo. Abou Ghraïb. Le sort réservé aux musulmans dans le monde. Toute sa vie, il s'est battu contre les instincts impériaux. Il a laissé derrière lui sa petite fille de huit ans. Il ne sait pas encore précisément ce qu'il regrette de son séjour en Syrie, ni même s'il a des regrets. Il se pose des questions, aussi, sur l'innocence de ses victimes, le caractère moral de la prise d'otage selon les lois de l'État islamique, le langage de la charia tel qu'employé pendant la guerre. Mais à la fin des fins, dit-il, il est coupable, oui, coupable, en vertu du droit américain. Il ne peut pas le nier. Toutefois, sa culpabilité est d'ordre technique. Il est important qu'elle sache que tout ça a été commis sous les auspices de la guerre. Il faisait ce qu'on lui demandait. « Tout ce que j'ai fait, dit-il, je l'ai fait sans méchanceté. »
Elle sait qu'il ment.
Aveux minimaux. Remords minimaux. Pensés et confectionnés pour trahir juste ce qu'il faut de vérité. Pourtant, quelque chose - Diane ne saurait dire quoi - se cache sous les mensonges, une autre peau, une autre version de la vérité, quelque chose de viscéral, de compréhensible, qui se peut atteindre.
Elle a entendu dire, par l'accusation et par les anciens otages, qu'Emwazi était le plus brutal de tous, mais que Kotey le suivait de près. D'une cruauté exceptionnelle, disait-on. Le waterboarding. Les techniques pour affamer. Les prises d'étranglement. Les décharges électriques. Les tortures psychologiques. Les simulacres de crucifixion. Il prétend n'avoir frappé Jim que deux fois, mais l'affirmation est douteuse, voire pathétique, au vu de tout ce que Diane sait grâce aux otages européens qui ont pu rentrer chez eux. Ils ont raconté que Jim a été le plus maltraité. Il était soumis à des violences constantes, aussi bien mentales que physiques. Il était la cible privilégiée des passages à tabac.
Cet homme-là, pense-t-elle. À moins d'un mètre vingt de moi. Il a frappé mon fils. Il a participé à l'exécution. Là, tout près. Devant moi. Elle sent presque son souffle glisser sur la table.
Il baisse la tête et murmure, comme s'il s'adressait au sol. « Emwazi en avait après James », dit-il, toujours les yeux baissés. C'est une bonne ruse, pense Diane: se dédouaner, accuser les morts. Mohammed Emwazi. Pulvérisé par une attaque de drone américaine presque six ans plus tôt. Un monstre, oui. Mais un monstre bien commode, aujourd'hui.
Elle serre les bras autour de son torse. À quoi bon tout cela ? Qu'y a-t-il à gagner à interroger Kotey sur ces passages à tabac ? Pourquoi prolonger le malheur ? Quelle utilité y a-t-il à mettre toujours plus à nu sa cruauté ? Pour lui, c'est une question de survie. Il ne fera que continuer de mentir, et elle ne veut pas que le temps laisse monter une cacophonie de duperies. Qui plus est, cette conversation risque de glisser une lame tranchante sous ses ongles, comme une autre forme de torture.
Une chose dont elle est sûre et certaine : elle n'est pas là pour se venger.
Les minutes passent. Kotey s'enferme dans la grande rhétorique de l'islam, les complexités de la guerre, l'organigramme touffu de l'État, la charia, les décisions soudaines, les interprétations sur le champ de bataille. Il est doué pour ça - les effets de manche, les fausses pistes, les discours verbeux. Pourtant, il y a autre chose. Elle n'arrive pas bien à en saisir la teneur : de quoi s'agit-il ?
Pourquoi a-t-il plaidé coupable? S'il était si sûr de ses convictions, il aurait opté pour un procès en bonne et due forme, non ?
Grâce à la négociation de peine, il pourra retourner en Grande-Bretagne après avoir passé quinze ans dans les prisons américaines. Perpétuité incompressible.
« La prison est la prison », dit-il.
Mais si la prison est la prison, et si la vie est la vie, pourquoi ne pas aller au procès et y exposer ses convictions ? S'il n'a vraiment pas participé aux exécutions - s'il dit la vérité -, pourquoi ne pas le dire en public ? Il affirme ne pas croire au système américain, mais jusqu'à présent celui-ci l'a plutôt bien traité. Oui, il est en prison, mais la peine de mort a été exclue, il est bien nourri, protégé, il a des avocats, il a accès à la justice. C'est d'ailleurs son équipe d'avocats qui, la première, a évoqué le fait que s'il plaidait coupable il parlerait aux victimes et à leurs familles. Comme un chemin vers la vérité. Comme une voie vers la guérison.
Il paraît si sûr de lui dans ses réponses que Diane soupçonne un instant la présence, derrière cela, d'un homme terrifié. Ou alors ce n'est rien du tout : peut-être n'y a-t-il que ça, une coquille en guise d'âme, douée pour la comédie - un homme peut sourire, sourire, et n'être qu'un scélérat -, brisée, psychotique, qui se servirait d'elle comme d'un étrange instrument humain.
Et pourtant. Et pourtant.
Elle veut désespérément qu'il sache ce qu'il a arraché au monde, ce qu'il a volé : non seulement le journaliste et militant James Wright Foley, son fils, l'aîné de ses garçons, mais tout ce qu'il a représenté au fil des années. C'est une des raisons de sa présence ici. Dire la vérité. Sans sentimentalisme. Sans guimauve. La simple, la pure vérité. « Jim était un professeur », lui dit-elle en se penchant en avant et en faisant tinter ses bracelets. Il travaillait avec de jeunes délinquants. Des mères célibataires, aussi. En tant que journaliste, il témoignait. Il cherchait la vérité du terrain. Il était juste, il était curieux, il était placide. Il affectionnait l'équanimité. Il voulait avoir du courage moral. Il était dévoué aux autres. Devenu journaliste, il a donné sa vie pour tenter de montrer au monde les souffrances du peuple syrien. Il se sentait obligé de témoigner. Il était un fils attentionné, aussi. L'aîné de cinq enfants. Un ami. Tout le monde l'aimait. Il voyait, en chacun, le bien. Il croyait à la complexité de la vérité. Il aurait écrit l'histoire de Kotey - qui plus est, il n'aurait pas fait la moindre erreur. Elle le regarde droit dans les yeux. « C'était une bonne personne. »

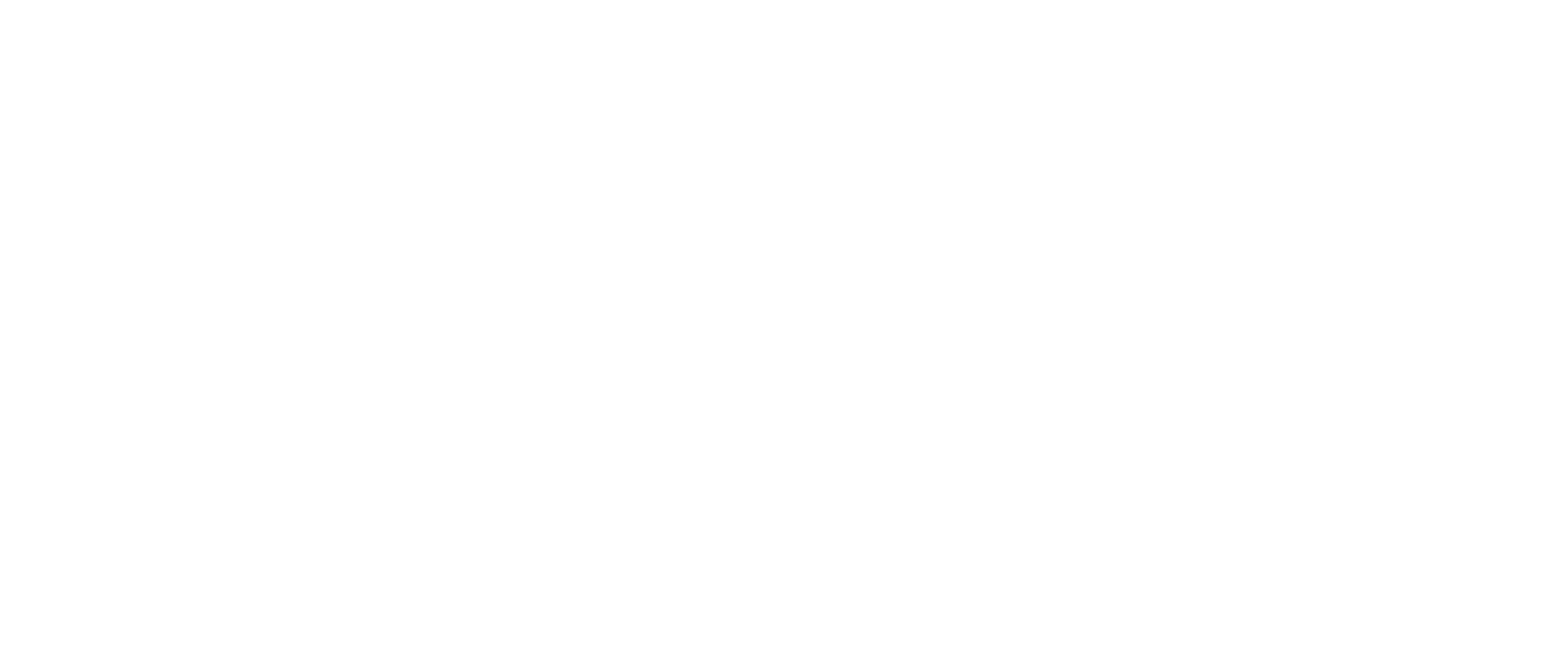

 Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français
Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français

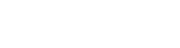
Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !