
François-Henri Désérable* Jeter un sortilège
Il y a eu la période où le livre que j'ai le plus offert était Vies minuscules, de Pierre Michon. Il y a eu la période où c'était Le Parfum, de Patrick Süskind, ou D'autres vies que la mienne, d'Emmanuel Carrère, ou Belle du Seigneur, d'Albert Cohen. Quand ce gros roman de huit cent cinquante-huit pages est sur le point de paraître, en avril 1968, son auteur est un jeune écrivain de soixante-douze ans. Une pile de cent cinquante livres l'attend aux éditions Gallimard : c'est l'éternelle corvée du service de presse, quand il faut orner chaque exemplaire d'une dédicace. Le jeune écrivain de soixante-douze ans en signe un, deux, dix, et bien qu'il en reste encore au moins cent-quarante à dédicacer, il se lève, s'en va trouver son attachée de presse et l'informe qu'il a terminé. «Déjà ?», s'étonne l'attachée de presse. « Oui, répond Cohen, j'ai décidé de ne plus faire de gratis sur ce monument. » Il y a donc eu une période où le livre que j'ai le plus offert était un monument.
Depuis quelques années, le livre que j'offre le plus est un monument de la littérature de voyage. Son titre est l'un des plus beaux titres de la littérature tout court : L'Usage du monde. Son auteur est un Suisse, mort en 1998, mais qui survit, ô combien, dans le cœur des vivants qui l'ont lu : Nicolas Bouvier. L'Usage du monde relate le périple qu'il fit, en 1953-54, avec son ami Thierry Vernet, en Fiat Topolino à travers les Balkans, l'Anatolie, l'Iran, jusqu'à la passe de Khyber, en Afghanistan. Le merveilleux surgit à chaque page de l'émerveillement du regard, la mélancolie est mise en sourdine au profit de l'allégresse, de la jubilation sensorielle, de l'étonnement perpétuel. Lire Bouvier, c'est prendre la vraie mesure du monde, en même temps que son pouls. C'est s'aviser qu'il est vaste, et grandiose, et terrible - et qu'on n'en a rien vu. Dès lors, on ne connaît pas de mot plus beau, plus enivrant que celui de voyage, et l'on est mû par une seule obsession : prendre la route.
En début d'année, j'ai offert L'Usage du monde à un ami qui travaillait dans la banque. Il passait ses journées dans un bureau, devant des écrans d'ordinateur avec des fichiers Excel à vingt-cinq onglets. Il n'avait plus qu'un épais brouillard dans la tête, où trottaient tout un tas d'anglicismes : capital innovation, leverage buy out, private equity...
S'il continuait sur cette pente, il y en aurait bientôt un nouveau : burn-out. Vous me croirez ou non, mais un mois après avoir terminé le récit de Bouvier, il posait sa démission, rendait son appart, stockait ses affaires dans un garde-meuble, faisait son sac et partait à l'aventure. Aux dernières nouvelles, il est en Patagonie, quelque part entre Ushuaia et Bariloche. Cette vie nomade, il appelle ça le bonheur. Lui offrir L'Usage du monde, c'était lui jeter un sortilège : le sortilège de Bouvier.
(En vérité, les livres que j'ai le plus offert sont peut-être les miens - c'est encore le moyen le plus sûr de gagner des lecteurs.)
*Dernier livre paru : L'Usure d'un monde, Gallimard, 2023.
Dominique Barbéris* Anita Brookner chez Balzac
Pourquoi faut-il que j'éprouve toujours, à lire les romancières anglaises, le même plaisir vaguement coupable ? Parce qu'elles ne sont pas à la mode ? Parce qu'elles sont moins intellectuelles qu'intelligentes ? Parce qu'elles sont drôles, franches à l'excès, un peu cruelles et infiniment distrayantes ? Parce qu'elles ont un solide sens du concret ? Parce qu'elles parlent de nos illusions et de la manière dont la vie les défait ?
Elles font partie de ce que Louise Erdrich, dans La Sentence, appelle les lectures de paresse : je veux parler de la pile de livres qui s'entassent sur la table de nuit (à côté de la pile d'obligations) et vers laquelle on tend la main, le soir, avec délices.
Ainsi du premier roman d'Anita Brookner, opportunément ressorti en traduction à la rentrée chez Bartillat. Un de mes anciens étudiants, aujourd'hui libraire, me l'a signalé. Je ne l'avais pas lu et je lui dois cette découverte. J'en profite pour signaler sa librairie : À l'Ouest, rue de l'Ouest, près de Montparnasse [Paris 14e].
À mon tour de proposer d'offrir (ou de s'offrir à soi-même) en ces fêtes de Noël Un début dans la vie. Les longues soirées de la saison sont faites pour les lectures « de paresse » ; celle-ci l'est à double titre, puisqu'il s'agit d'une traduction.
Le roman a été publié en 1981 sous le titre A Start in Life, décalque exact de celui de Balzac - non sans raison : Ruth Weiss, l'héroïne, est spécialiste de l'écrivain. Et elle affirme tout de go que la littérature a gâché sa vie.
Soit donc Ruth, une enfant pâle et sage. Sa grand-mère allemande qui l'élève dans une grande maison d'Oakwood Court compense un peu le complet désintérêt de ses parents : la mère, Helen, narcissique et écervelée, actrice à succès dans des comédies légères ; le père, George, un homme sans envergure qui vit dans l'ombre de sa femme. Ces deux-là n'ont su ni grandir ni aimer leur fille ; ils ne sauront pas davantage vieillir.
Ruth grandit, lit beaucoup comme les enfants seuls ; à Oakwood Court, la vie se dérègle peu à peu. Helen, toujours belle, mais vieillissante, vit dans le souvenir de ses succès au théâtre et finit par ne plus quitter son lit, se querellant avec une employée haute en couleur, Mrs Cutler. Helen fume, continue de jouer pour la galerie une comédie de plus en plus pathétique, boit du thé à longueur de journée. Mrs Cutler fait le thé, fume beaucoup elle aussi, tyrannise la maisonnée, empile mégots et vaisselle sale dans l'évier, nourrit le couple de conserves, tandis que George se réfugie sournoisement dans une liaison douillette avec une veuve qui, elle au moins, lui fait la cuisine et cherche à lui mettre le grappin dessus.
La belle Helen maigrit dangereusement, George grossit beaucoup trop.
Il n'y a que les romancières anglaises pour vous apprendre que la meilleure manière de retenir les hommes est de bien les nourrir.
C'est drôle, féroce, impitoyable.
Qui s'intéressera à Ruth ? Qui la regardera enfin ? elle s'émancipe un peu, essaie d'échapper au huis clos délétère du foyer familial, prend une chambre « à elle », fait des fiches sur Balzac (son sujet de thèse) et vit son premier rendez-vous de jeune fille amoureuse avec le beau Richard, un mufle parfait. Heureusement, elle a lu Eugénie Grandet : « Je suis trop laide, il ne s'intéressera jamais à moi. » Ou Phèdre : « Hippolyte est sensible et ne sent rien pour moi. »
Comme les héros balzaciens, Ruth part à Paris pour sa thèse. Elle s'achète une robe bleue, bien décidée à prendre un nouveau départ, et atterrit rue des Marronniers, dans la chambre de bonne d'un couple ami de ses parents, Humphrey et Rhoda Wilcox. L'accueil n'est pas très chaleureux. Là, pourtant, à Paris, elle connaîtra un début d'émancipation, une amitié (intéressée) et même l'amour terne et prudent d'un professeur à la Sorbonne rencontré à la bibliothèque. Duplessis a vingt-cinq ans de plus qu'elle, il n'a rien d'un séducteur. Mais c'est un homme marié, père de famille, un amant possible, ce qui ressemble quand même à un roman.
On le devine, il n'y aura pas de happy end. La comédie humaine fait triompher le narcissisme et le sens de l'intérêt bien compris.
C'est ainsi que Ruth Weiss, qui préférait les hommes, se retrouve spécialiste des femmes chez Balzac, universitaire et, on le devine, célibataire. Mais je laisse au lecteur découvrir la fin. C'est ainsi qu'Anita Brookner - morte en 2016, il n'y a pas si longtemps, et spécialiste, quant à elle, de Greuze et de la peinture française - est entrée en littérature, devenant l'une de ces merveilleuses romancières anglaises qu'il faut lire et relire.
* Dernier livre paru : Une façon d'aimer, Gallimard, 2023.
Marie Pourchet* Lire c'est savoir compter
L'année dernière et dans le cadre d'un exercice identique, donc fondé sur la passion des faits et de la statistique, je calculai le titre que j'avais le plus offert. Résultat, La Chenille qui fait des trous (Éric Carle), un récit aspirationnel pour les 2-3 ans impliquant une chenille, des fruits plus ou moins mûrs et la constance de la première à forer les seconds. À la fin, la chenille, gavée et tout en estime personnelle, s'envole en papillon et le 2-3 ans a toutes les cartes en mains pour devenir un champion.
Aujourd'hui, surprise, le même calcul appliqué aux dix-huit derniers mois, ne produisant pas du tout les mêmes résultats, m'apprend qu'en journalisme il ne faut jamais s'endormir sur des données. Ces dix-huit derniers mois j'ai offert neuf fois Wonder Landes d'Alexandre Labruffe contre une fois la chenille et trois fois le dernier Chloé Delaume. Je dispose pour le prouver de tickets de caisse de librairie indépendante - je les garde pour ma comptable, comme auteur je peux déduire mes achats livresques, soit dit pour les copains sous-informés. Donc, Wonder Landes, qu'est-ce ? Un roman du rocambolesque Alexandre Labruffe paru chez l'irréprochable Verticales en 2021 et, merveille, disponible en poche depuis peu pour 8, 70 euros. Ce qui permettra aux ménages un peu riches de s'offrir quand même le réjouissant dernier Delaume. Et j'assume cette débauche d'épithètes, cette généreuse publication ne m'ayant pas limitée sur le nombre de signes (supérieur à 1 000). Bref, pourquoi Wonder Landes ? Après avoir exploré avec génie le potentiel narratif insoupçonné de la station-service (Chroniques d'une station-service) et espionné celui de la Chine populaire (Un hiver à Wuhan), Labruffe investit... LA FAMILLE. La sienne, le pauvre. Explosive, sidérante, magnétique. Le gisement de produits combustibles Elf et la République communiste disposant de l'arme nucléaire, à côté des Labruffe, c'était Disney. Alexandre le joueur devient diablement sérieux dans ce wonder bouquin où l'on passe de l'effroi au rire, du vertige à la paix, au rythme cardiaque d'un texte qui transgresse tous les codes : syntaxe, formes, classiques de la famille. Ça se lit en moins de trois heures, autrement dit dans n'importe quel TGV vous ramenant vers le sud de la France entre le 24 et le 31 décembre 2023.
Voilà pour la science et les faits vérifiables. Pour les amateurs de Loto ou du tarot de Marseille, pas de panique, ce développement peut tout à fait se réduire, vous l'aurez remarqué, à une ésotérique série de nombres puis de chiffres : 2, 3, 9, 3, 9, 2, 4, 8, 3, 1, 0, 5, 4, 3, 5. De rien.
* Dernier livre paru : Western, Stock, 2023.
Jean-Baptiste Andrea* Joies et pesanteurs
Il y a quelques années, je découvris sur mes étagères le cycle des Thibault, de Roger Martin du Gard, hérité de mes parents. Le nom m'évoquait la IIIe République, les blouses à l'école et les coups de règle sur les doigts, les Français parlent aux Français, bref, un passé en noir et blanc. Je décidai de m'y plonger, prêt à abandonner à la moindre intuition de ringardise ou, pire, d'ennui. Ce cycle (originellement en huit volumes, souvent rassemblés en trois ou cinq au gré des rééditions) conte l'histoire de la famille éponyme à l'aube de, et durant, la Première Guerre mondiale. Publié entre 1922 et 1940, il permit à son auteur de décrocher le prix Nobel en 1937.
Après presque 2 000 pages, je dus me rendre à l'évidence : pas question de ringardise ou d'ennui chez Martin du Gard. Puisqu'il faut définir, il s'agit d'une fresque, d'un grand roman populaire, terme qui selon moi ne veut pas dire grand-chose, car quasiment tous les grands romans sont populaires.
La force de l'ouvrage tient à deux choses. L'évocation de la famille, d'abord : aimante et étouffante, comme toute bonne famille. Chacun y reconnaîtra ses propres joies et pesanteurs. Mais c'est surtout son côté intemporel qui marque, dans l'évocation par exemple des relations troubles et adolescentes entre l'un des héros et un ami proche. Le mot homosexualité n'est absolument jamais prononcé, et peut-être ne s'agit-il pas de cela, sauf qu'il s'agit de cela. Intemporalité, enfin et surtout, dans l'analyse des forces qui mènent à l'explosion de la Première Guerre mondiale, un véritable tour de force qui vaut bien des essais. On pourrait d'ailleurs reprocher au dernier tome des Thibault de virer au manifeste politique, mais impossible d'y rester insensible. C'est donc le livre que j'aimerais offrir, en espérant que sa taille ne découragera pas ceux qui le recevront. Un avertissement cependant : la lecture des Thibault risque d'induire chez le lecteur ou la lectrice un violent pacifisme et un gauchissement de ses opinions politiques. Elle provoquera dans tous les cas le grand plaisir de se baigner dans un ouvrage ample, servi par une langue superbe, qui n'oublie pas la fonction première de la littérature : raconter une histoire, la nôtre.
* Dernier livre paru : Veiller sur elle, L'Iconoclaste, 2023.
Dans un tunnel sans lumière
D'Olivier Guez, je ne connaissais que son Éloge de l'esquive, petit livre génial consacré aux meilleurs dribbleurs du monde. J'en avais retenu quelques figures de style aussi brillantes que ces footballeurs brésiliens. Quand, à l'été 2017, à la veille de mon départ en vacances, je surgis dans le bureau de mon confrère de Paris Match Gilles Martin-Chauffier pour soutirer à ce chroniqueur littéraire inspiré deux ou trois bouquins à glisser dans ma valise, il me tend, entre autres, le dernier opus de Guez. « Tiens, ça te plaira. Tu aimes les romans historiques. » Le titre, La Disparition de Josef Mengele, me laisse perplexe. Évidemment, il y a mieux qu'une histoire de nazi, même baptisé « l'ange de la mort », pour se détendre pendant ses congés. Va pour ce livre sur ce sale type devenu criminel de guerre. Je l'emporte donc au Japon. À peine assis dans l'avion, j'entre dans les premières pages comme on pénètre dans un tunnel sans lumière. Une nuit noire avec, pour personnage central, ce médecin devenu officier SS qui exerça à Auschwitz et dont Guez raconte la fuite entre l'Allemagne et l'Amérique du Sud, jusqu'à sa mort en 1979 sans avoir été jugé. On le suit dans l'Argentine de Perón bienveillante avec les tortionnaires de l'Allemagne hitlérienne. On le retrouve traqué au Paraguay puis au Brésil. Son errance ne connaîtra pas de répit... jusqu'à sa mort mystérieuse en 1979. On reste sans voix de constater que ce nazi fanatique a pu passer entre les mailles du filet plus de trente années durant. J'ai été happé par cette cavale glaçante. Impressionné par le combat singulier que Guez livre contre Mengele. Un combat que la communauté internationale n'aura pas vraiment mené. Passons. Ma sidération, elle, n'est toujours pas passée.
À mon retour à Paris, je parle à tout le monde de ce livre qui sortira quelques petites semaines plus tard, persuadé qu'il sera couronné par un des prix de l'automne. Ce sera le Renaudot. Je me souviens encore d'une interview de Guez dans laquelle il raconte les trois années de recherche qui ont précédé l'écriture : « Je vivais avec lui, avec ce personnage abject, d'une médiocrité abyssale. Je montais sur le ring. Je l'affrontais. Les six premiers mois, il m'arrivait de crier son nom la nuit. » Convaincu de la nécessité de le faire lire, je décide de l'offrir à mes amis et à ma famille. Le hasard des rencontres me conduira à faire la connaissance d'Olivier Guez, qui écrira dans Paris Match plusieurs articles sur le... foot.
Bruno Jeudy
La torpeur d'un été éternel
Souvent, je m'imagine à Vermilion Sands, longeant la mer de sable où dorment les raies volantes, à bord d'une décapotable conduite par une belle mutante à peau dorée. J'égrène dans ma tête les lieux implantés par J.G. Ballard sur ce rivage utopique - Lagoon West, Red Beach, Stellavista - et les noms de ses habitantes - Jane Ciraclydes, Aurora Day, Lunora Goalen... Et je me demande à quel heureux prochain j'offrirai la clé de ces songes. Moins fréquenté que la planète Mars façon Ray Bradbury, Vermilion Sands, station balnéaire hélas fictive, est un refuge idéal contre les vicissitudes de ce monde. Il se présente sous la forme d'un recueil de nouvelles qui nous parlent d'un lieu pris dans la torpeur d'un été éternel, dans un futur où « le travail est devenu la distraction ultime, et la distraction le travail ultime ». Restent l'amour et l'art. Alors un cultivateur de fleurs musicales - des choroflores - s'éprend d'une dame dont la voix met ses pensionnaires végétales en transe. Une sculptrice rusée se venge de ses critiques en leur laissant une œuvre hideuse vouée à croître indéfiniment. Une femme éprise de mythologie part en guerre contre les verséthiseurs, ces machines qui créent de la poésie... Ballard, lui, n'a pas besoin de machine pour attaquer ses nouvelles sur de sublimes invitations au voyage. « Tous les soirs de l'été, à Vermilion Sands, les poèmes insensés de ma belle voisine traversaient le désert depuis l'atelier n o 5, les Étoiles, jusqu'à ma villa, écheveaux brisés de rubans colorés qui se dénouaient dans le sable comme les fils d'une toile d'araignée mise en pièces. » Bien sûr, si Vermilion Sands est un paradis, il compte quelques serpents, comme ce milliardaire qui étend à l'infini sa résidence afin d'y errer, la nuit, à la recherche du fantôme de son épouse dont il a provoqué la mort. Et quelques lieux dangereux, telle cette « maison psychotropique » qui projette sur un jeune couple les drames vécus par ses habitants précédents. Mais ce qui domine, c'est l'impression de goûter à l'oisiveté des personnages et à leurs vacances sans retour. Une impression voulue par Ballard, qui a conçu Vermilion Sands comme une villégiature pour reposer son imaginaire de ses inspirations noires. Ce qui n'est pas rien de la part d'un auteur qui, adolescent, a survécu trois ans dans un camp de détention japonais en Chine. Puis Ballard est devenu cet écrivain dont les romans racontent comment des décors nouveaux produisent des comportements jamais vus. Tel Crash!, où des gens déshumanisés par la vie dans des espaces interurbains bétonnés explorent l'érotisme des accidents de voiture. Vermilion Sands représente le revers lumineux de cette œuvre sombre, un rêve sublime pour conjurer tous nos cauchemars.
Alexis Brocas
L'allure
J'ai offert N'oubliez pas que je joue à toutes les femmes que j'aime, convaincue de leur confier un trésor, de leur transmettre un peu de la force de Sonia Rykiel. Cela fait onze ans que je distribue ce petit livre de moins de 100 pages coécrit par la styliste et la journaliste Judith Perrignon. Si ça commence par l'annonce de son « P... de P » - la maladie de Parkinson -, c'est tout sauf un texte sur la maladie ou la mort ! Au contraire, ces pages racontent une vie de transformation : celle d'une petite fille rousse (deux défauts, selon la mère de Sonia Rykiel) en une femme flamboyante qui joue et se joue... de tout. Elle nous montre, à 20 ans comme à 50 ans et plus, un chemin féminin joyeux, conquérant et, disons-le, sexy. Elle ne donne pas de leçon, n'entend même pas montrer l'exemple. Surtout pas. D'abord, parce qu'elle ment. « Le vrai m'épuise », dit-elle. Alors elle oublie, trafique parfois les faits - et ces arrangements avec la vérité, voire avec la vie, sont bouleversants. « Sa tête est un tamis qui ne retient que ce qui l'arrange, l'or du temps », note Judith Perrignon. Les événements trop difficiles, elle les élude, « folle de peur » de ne pas faire face. Mais cette peur, Rykiel la magnifie. Sa mère ne la trouvait pas assez jolie, elle apprendra à ne s'en remettre qu'à elle-même pour déterminer si, face au miroir, « ça va ». « Elle croyait en l'allure plus qu'aux traits et elle régnait sur l'allure. » Quand elle se sépare de son mari, il lui faut enjamber la culpabilité : « Elle pouvait dire je m'en fous alors qu'elle ne s'en foutait pas. Elle savait le mal qu'elle causait, mais elle ne pouvait faire autrement que de foncer vers ce qu'elle voulait. Renoncer ressemblait à la mort. » Certaines phrases changent nos vies. Et puis quelle joie de lire : « Il fallait à l'histoire en marche des menteuses, des jouisseuses jamais coupables, des femmes fières qui savent que la séduction est un mystère de l'intelligence, qui savent que souvent les hommes crient ou plaisantent quand ils ne savent pas quoi dire... » La séduction est partout dans le livre, l'amour plus difficile à trouver. Les hommes devraient le lire : ils auraient moins peur « des fantasques, des terribles, des orageuses ».
Aurélie Marcireau
Un peu de voyeurisme
Federico Fellini avait une saine habitude. Dès son réveil, le réalisateur de La Strada consignait ses visions de la nuit. Pendant trente ans, il a ainsi répertorié ses songes sous forme de croquis annotés, lui qui fut à ses débuts dessinateur de presse. Une course contre la montre car la mémoire des rêves ne dure que quelques minutes et le maestro ne voulait pas perdre son « travail nocturne ». Publié en 2007, le fac-similé du Livre de mes rêves avec ses 440 illustrations a été, depuis, réédité à plusieurs reprises. Ne cachons pas le plaisir voyeuriste du lecteur qui pénètre dans ce « grand livre de l'âme » et s'immisce dans l'imaginaire du cinéaste à l'œuvre fantasmagorique. Offrir un tel livre, c'est aussi une invitation à tenir son journal de songes, forme de « cinéma des pauvres ». L'intense activité onirique de Fellini n'est cependant pas donnée à tous : cauchemars existentiels, descriptions satiriques du monde intellectuel ou fantasmes sexuels... L'amateur de 7e art y croisera Rossellini, Pasolini, Truffaut ou Mastroianni. On retrouve sa compagne, Giulietta Masina, et d'autres muses dont la plantureuse sirène de La Dolce Vita, Anita Ekberg. Le livre est peuplé de figures outrancières, de personnages de cirque et de femmes... beaucoup de femmes. Il s'y dessine chétif face à ces ogresses dénudées. C'est débridé, grivois, scatologique. Cela a parfois un goût douteux puis bascule dans des moments de grâce avec des paysages observés à travers la vitre d'un train ou un firmament étoilé admiré sous une tente depuis la Lune. Jamais le rêve n'est analysé. Nous sommes face au matériau brut. Plus on avance dans le livre, plus l'image se complexifie. D'une suite de croquis, on arrive à des pages à la construction savante, où le dessin n'est plus illustration mais fait corps avec le texte. Fellini rêve en BD avec des séquences en vignette et bulles dialoguées. Certaines images font tableaux, comme celle en couverture de l'ouvrage : une beauté fellinienne assise sur un nuage poussé par le souffle du cinéaste. Le réalisateur découpait régulièrement une feuille, pour l'offrir ou la publier. Seules quelques-unes ont été retrouvées. Il existe peut-être un volume dormant dans un coffre. Et l'on se prend à rêver que l'histoire n'est pas terminée.
Anne-Laure Walter
Paroles nues
Ce recueil est un cadeau pour les initiés « barbaresques ». Une façon de braver sa disparition, de se rendre à un autre rendez-vous avec Barbara : un tête-à-tête avec sa plume.
D'aucuns diront que sans sa voix, ses souffles, sa gestuelle, son habit noir et son piano-refuge, il ne peut exister de Barbara ainsi « morcelée ». Pourtant, la lecture de cette intégrale de textes nous donne à redécouvrir, en silence, les paroles nues de 150 de ses chansons. Les rares auteurs-compositeurs-interprètes de la chanson française ne seront jamais les marionnettes d'un art mineur : raturés, fredonnés, modifiés après une représentation ou malaxés par des nuits d'écriture, leurs mots n'attendent pas toujours une musique pour dire l'enfance, la guerre, l'inceste, l'amour, la solitude, les luttes... Chaque texte est précédé de la petite histoire de sa genèse.
Une petite cantate jaillit en quelques heures après la perte d'une amie, Nantes s'écrit en trois ans, deuil cornélien d'un père incestueux... Mais toujours l'écriture soulage ou répare. Si la longue dame brune se défendait d'être « une intellectuelle » et démentait être « une poète », ses chansons étaient des saillies brutes qui parlaient aux tripes et à la tête. L'écriture de ses chansons, instinctive et théâtrale lors de leur interprétation sur scène, à la lecture apparaît ciselée mais affranchie des codes strictement littéraires, au plus près des émotions. Une façon de la rencontrer à nouveau, dans l'intimité de la lecture.
Charlotte Langrand
Un instant de flottaison
« Parfois je me réveille la nuit et je me sens complètement perdu. Je flotte dans l'espace, comme dépossédé de mon corps. Dans ces moments-là, je m'interroge, la crainte au cœur : est-ce que cet endroit est dangereux ? Où suis-je exactement ? » Ainsi débute le livre de Yoshi Oida. Par une sensation que beaucoup d'entre nous ont déjà vécue. Et c'est sans doute la force de l'auteur : raconter son parcours atypique par le biais de questionnements auxquels nul ne peut échapper, consciemment ou pas. Lorsque Yoshi Oida débarque à Paris en 1968, il a une trentaine d'années et ne connaît rien du monde. Il est un acteur reconnu au Japon, formé aux techniques traditionnelles du nô. À l'invitation du directeur de l'Odéon Jean-Louis Barrault, il rejoint Peter Brook qui se lance alors dans son œuvre expérimentale avec des acteurs de tous les continents pour tenter de répondre à cette question : qu'est-ce que le théâtre ? Mais très vite, à travers une écriture épure, Yoshi Oida s'attaquera à l'impossible question : qu'est-ce que la vie ? Il raconte son incroyable parcours avec la troupe de Brook, leurs voyages expérimentaux en Iran, en Afrique et aux États-Unis. Lui, le solitaire, découvre « la joie de se perdre dans les autres ». Il explore la notion d'être un étranger ici ou ailleurs. Et puis il y a les autres, toutes ces cultures qui se confrontent, jouent ensemble sur scène et communiquent par un langage universel : celui du théâtre. Une histoire de rencontres, entre ceux qui jouent, ceux qui regardent. Et ce jeu scénique-là, Yoshi Oida en fait une métaphore de la vie ; une quête exploratoire dans laquelle chacun souhaite trouver sa juste place. Ces Mémoires d'acteur nous embarquent d'est en ouest, s'accommodent de l'inattendu, témoignent d'une période où l'expérimentation était au cœur de la création ; mais ils sont surtout intemporels par leur force philosophique. Yoshi Oida ne cesse de questionner ses choix, ceux de l'homme affranchi qu'il est devenu plutôt que ceux de l'artiste qu'il voudrait être. Une quête de soi fascinante.
Valérie Abrial

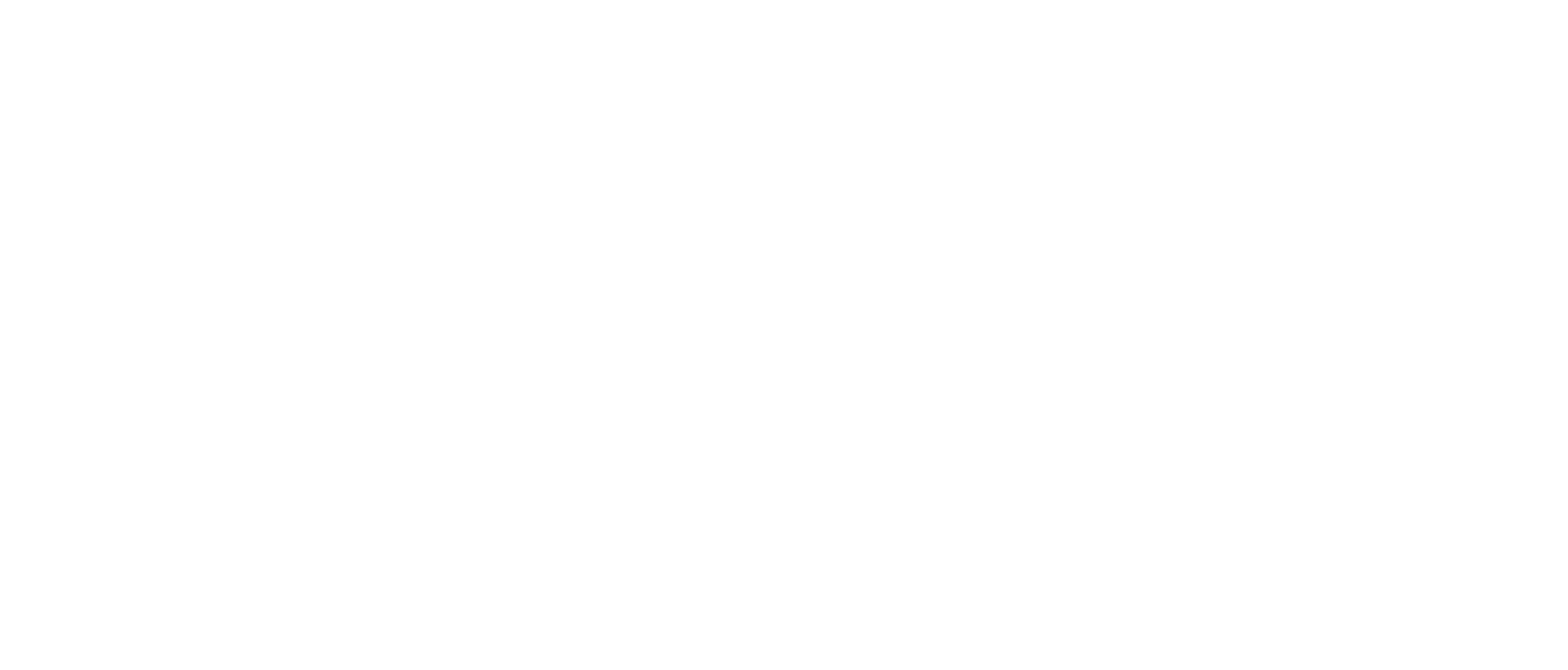
 Fraude aux prélèvements bancaires : pourquoi les données des clients français sont à la portée des escrocs
Fraude aux prélèvements bancaires : pourquoi les données des clients français sont à la portée des escrocs

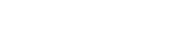
Sujets les + commentés