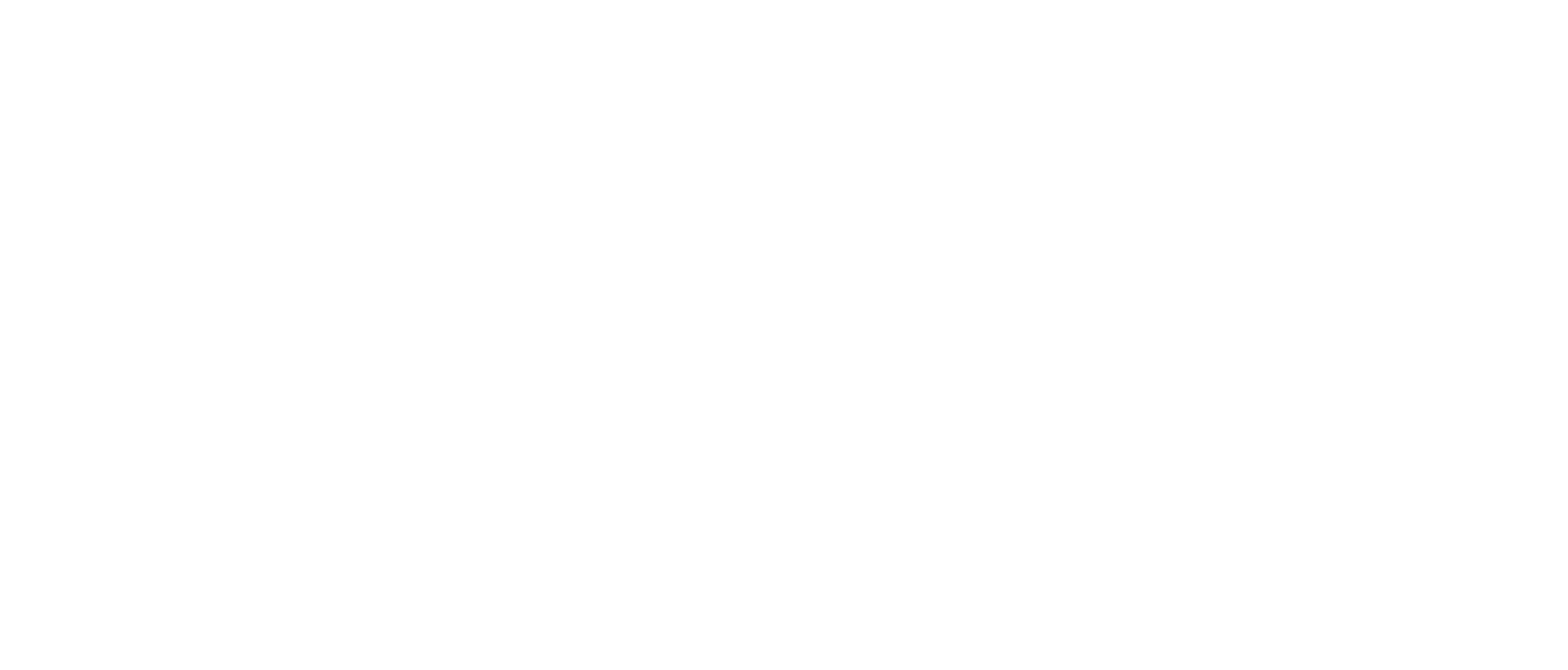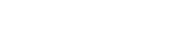« Le quoi qu'il en coûte, c'est fini », promettait Bruno Le Maire le 25 août 2021 aux universités d'été du MEDEF. Dans les travées de l'hippodrome de Longchamps, le ministre de l'Economie et des Finances, optimiste, voulait entrevoir la fin de la folle cavalcade de la dette publique, laquelle venait de bondir de +15% du PIB en 18 mois dans ces circonstances exceptionnelles de pandémie. Depuis, le Covid, à défaut de disparaître, a sérieusement reflué. Et avec lui le soutien de l'Etat à l'économie ? Pas vraiment.
- Lire aussi : Inflation : un nouveau ''quoi qu'il en coûte'' n'est pas justifié, juge le gouverneur de la Banque de France
Un année d'inflation plus tard, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal revendique une politique économique du « combien ça coûte » soucieuse que les aides aux ménages et aux entreprises « soient mieux ciblées ».
Même volume de dépenses
Dans les faits, le volume d'argent public décaissé demeure sensiblement identique. 80 milliards d'euros pour le « quoi qu'il en coûte » de 2020 et 2021 (fonds de solidarité, chômage partiel et exonération de charges), contre 100 milliards d'euros pour le bouclier tarifaire en 2021, 2022 et 2023 d'après Bercy.
S'ils sont plus stricts, les critères pour percevoir les aides anti-inflation n'en demeurent pas moins généreux. L'indemnité inflation de Jean Castex de fin 2021 a bénéficié aux 38 millions de Français qui gagnent moins de 2.000 euros net par mois. Quant au chèque carburant d'Elisabeth Borne, les 10 millions de Français les plus modestes qui roulent pour aller travailler devraient le percevoir dès janvier 2023.
Ce dernier dispositif remplace la ristourne à la pompe dont tous les automobilistes ont pu profiter en 2021. Le plafonnement des prix du gaz et de l'électricité est lui prolongé pour les petites entreprises et les ménages, mais l'augmentation de la facture énergétique ne se limitera plus qu'à 15% au lieu de 4% en 2023.
« Ces dispositifs ont l'avantage de limiter l'inflation mais ils ne sont pas vraiment ciblés. Initialement, le "quoi qu'il en coûte" devait être ciblé et limité dans le temps », pointe François Ecalle, ancien haut-fonctionnaire à la Cour des comptes, spécialiste des finances publiques qu'il décrypte sur son site de référence Fipeco.
2023 ne sera pas plus facile
Comme son ancien magistrat, la Cour des comptes se préoccupe d'un « quoi qu'il en coûte systématique et perpétuel » d'après les mots de son président Pierre Moscovici en juillet au Sénat. D'autant plus perpétuel que 2023 et 2024 devrait apporter leur lot de difficultés dans un contexte de transition énergétique structurellement inflationniste.
La Banque de France prévoit le pic d'inflation pour le premier semestre de l'année prochaine. « Cela risque d'être compliqué d'arrêter les aides maintenant, peut-être même de plus en plus compliqué car le problème de l'énergie va être durable et il faudra bien que quelqu'un paie la facture », juge François Ecalle.
Publiée en octobre et baptisée « Un capitalisme sous perfusion », une étude de l'université de Lille décrit bien cette tendance à faire évoluer de nombreux dispositifs d'aides aux entreprises présentés comme transitoires en mesures permanentes, à l'image du CICE converti en baisse de charges sociales. « Il est très dur de reprendre ce que l'on donne. Dans notre étude, on parle d'effet d'accoutumance. Une fois que les entreprises ont intégré des dispositifs dans leurs projections, cela crée un choc de les retirer », explique Laurent Charbonnier.
Un capitalisme sous perfusion
Le professeur d'économie et co-auteur de l'étude juge toutefois « pertinent et raisonnable d'un point de vue macroéconomique que l'Etat intervienne face à des chocs d'une violence inouïe comme la crise des subprimes ou le Covid ». Nombre d'économistes louent les vertus du « quoi qu'il en coûte » pour protéger le tissu économique et le pouvoir d'achat à condition que ce soutien soit temporaire. Ça n'est pas le sens de l'histoire française.
Les chercheurs de la faculté d'économie de Lille estiment que les aides publiques qui irriguent les entreprises ont explosé, passant de 30 milliards d'euros dans les années 1990 à environ 160 milliards d'euros en 2019, avant même la pandémie. Le « capitalisme sous perfusion » décrit le fonctionnement d'une économie française biberonnée aux aides à l'investissement, aux subventions et aux exonérations sociales et fiscales pour mieux « masquer la perte de compétitivité réelle de l'économie française », selon Laurent Charbonnier. Une vieille habitude dont le « quoi qu'il en coûte » est l'émanation la plus récente. La défense du pouvoir d'achat remplit aussi sa fonction de soutien à l'économie en préservant la consommation.
Spécificité française
« Le mouvement d'intervention des Etats dans l'économie en période de crise est commun à tous les pays de l'UE et de l'OCDE. Mais dans les autres pays cela reste temporaire », observe François Ecalle. L'expert des finances publiques y voit un « problème culturel » spécifique de la France, acquise à l'idée que les deniers publics paient tout. Et de citer en exemple la révolte des Gilets Jaunes que le gouvernement a réglé « en payant » dix milliards d'euros, posant selon lui les jalons du « quoi qu'il en coûte ».
Le « quoi qu'il en coûte » est profondément inscrit dans les mœurs politiques et sociales, instillant un peu plus l'idée d'un « Etat nounou » tenu d'amortir tous les chocs. Et même de les anticiper. « Est-ce que nous avons moins de tolérance et plus d'aversion pour le risque ? Peut-être que l'état d'esprit des sociétés changent », analyse l'économiste Laurent Charbonnier. Face à l'inflation, le gouvernement encore traumatisé par la crise des Gilets Jaunes continue pour l'instant de dégainer ses aides avant même que la moindre protestation ne s'élève. Au risque de provoquer une surenchère dans les revendications sociales quand les difficultés s'amplifieront.