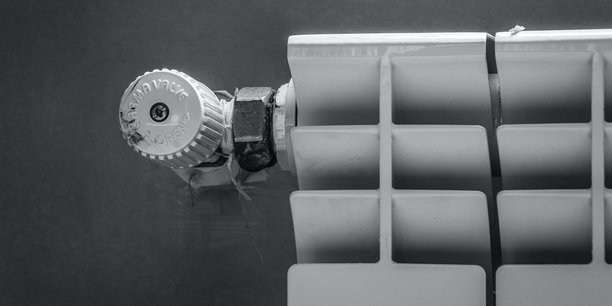
La fronde allemande, provoquée en ce moment par la volonté du gouvernement d'interdire l'achat de nouvelles chaudières à gaz dès 2024, n'a pas refroidi les pouvoirs publics français. Trois ministères viennent de lancer une concertation jusqu'au 28 juillet sur la décarbonation du bâtiment, responsable de 18 % des émissions de gaz à effet de serre. L'une des mesures consiste à envisager la fin progressive des chaudières à gaz, dont les ventes sont déjà en fort déclin, pour les remplacer par des pompes à chaleur électriques (PAC), réputées trois fois plus efficaces. Un sujet pendant très longtemps tabou jusqu'à ce que, fin mai, la Première ministre évoque l'interdiction, devant le Conseil national de la transition écologique, une instance composée d'associations, d'élus, d'entreprises et de parlementaires.
Si aucune échéance n'a été communiquée publiquement, Elisabeth Borne a fait part, auprès d'organisations patronales le 23 mai, de 2026 comme une « échéance possible et potentiellement souhaitable ». Une date-butoir qui apparaît aussi dans plusieurs documents de travail.
« Plus tôt on anticipe, plus on a du temps du côté de l'offre, des filières industrielles, des filières de service pour permettre ces changements pour les ménages et la prise de conscience et ouvrir des optionnalités d'accélération, comme la prime à la casse pour les véhicules thermiques », a justifié devant le Sénat, le 6 juin, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, auditionnée par la commission d'enquête sur la rénovation énergétique du parc privé et des copropriétés.
Ce dossier est extrêmement sensible alors que 40% des Français, et même la moitié des occupants de maison individuelle, se chauffent actuellement au gaz, soit 12 millions de foyers équipés d'une chaudière de ce type et environ 500.000 renouvellements par an. Sans surprise, la filière gazière s'oppose vivement à toute interdiction. Mais elle n'est pas la seule. Artisans et associations de consommateurs et de locataires se joignent aussi à cette levée de boucliers. Pouvoir d'achat fragilisé, hausse des dépenses publiques, délais intenables, infaisabilité technique, inefficacité sur le plan climatique... Les critiques se multiplient. Etat des lieux.
-
Le pouvoir d'achat mis à mal ?
« Une PAC coûte en moyenne 15.000 euros, contre 4 à 5.000 euros pour une chaudière à gaz. Il y a donc 10.000 euros d'écart », alerte le magazine Que Choisir. Les PAC bénéficient toutefois aujourd'hui d'aides publiques beaucoup plus conséquentes que les chaudières à haute performance énergétique. De quoi réduire cet écart substantiel. « Pour les ménages très précaires, il y a effectivement des aides significatives via les Certificats d'économies d'énergie (CEE) et Ma Prime Renov'. Mais pour les ménages de la classe moyenne les aides diminuent », pointe Jean-Charles Colas Roy, président de Coénove, qui rassemble les acteurs de la filière gaz dans le bâtiment. « Il y a soit un sujet de pouvoir d'achat, soit un sujet de dépenses publiques pour accompagner massivement dans la durée les classes populaires et moyennes », estime cet ex-député (LREM) de l'Isère, responsable du programme Transition écologique du président-candidat Macron.
« Ce sont des effets d'annonces qui n'ont pas été mesurés sérieusement. Après avoir interdit les chaudières au fioul, on veut interdire les chaudières au gaz, c'est se moquer du monde ! », réagit Eddie Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement (CNL). « Dans le parc social, des locataires disposent de chaudières au gaz individuelles. Comment va-t-on prendre ce coût en charge ? » pointe-t-il encore.
Outre l'investissement initial, la question des dépenses liées à l'entretien est également soulevée. « Le gouvernement a offert des PAC pour un euro aux ménages modestes et très modestes. Mais aujourd'hui, certains n'ont pas les moyens de faire les réparations nécessaires. Le Syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique (Synasav) vient de lancer une alerte », explique Elisabeth Chesnais. Le parc français compterait ainsi des « PAC orphelines » dont le fonctionnement est loin d'être optimal.
Jean-Charles Colas Roy met également en garde contre une recrudescence de l'éco-délinquance, « ces démarchages agressifs d'entreprises qui se nourrissent d'interdictions pour parfois arnaquer nos concitoyens ». « En créant une explosion du marché de la pompe à la chaleur, des professionnels qui ne sont pas réellement formés risquent de s'y engouffrer, avec le risque de travaux qui ne soient pas de bonne qualité, avec des malfaçons voire de la non-conformité », alerte, à son tour, Nicolas Moulin, président de Primes énergie.
Par ailleurs, une enquête publiée par UFC Que Choisir à l'automne 2021 avait démontré que les aides avaient fait augmenter le prix des matériels subventionnés. Aujourd'hui, à la différence des chaudières à gaz pour lesquelles les primes sont tombées, en moyenne, de 950 à 250 euros en un an, les particuliers peuvent recevoir des chèques de 5.000 euros pour une pompe à chaleur, mais il reste toujours 6 à 7.000 euros de reste à charge. Une somme loin d'être négligeable.
-
Des délais intenables ?
L'alerte a été sonnée par le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) dès le 24 mai. « On ne peut pas dire qu'en 2026, on supprime la chaudière à gaz et qu'on forme 200.000 chauffagistes à la pompe à chaleur. Ce calendrier n'est pas tenable », a fait savoir Jean-Christophe Repon, le vice-président de l'Union des entreprises de proximité (U2P), reçu et informé la veille par la Première ministre Elisabeth Borne.
« Ce n'est pas le même métier. Il va falloir accélérer les formations », appuie Alric Marc, le président d'Eficia. En jeu : 180.000 personnes en France, dont 150.000 opérateurs de terrain, estime, de son côté, Pierre Maillard, PDG d'Hellio. « Nous avons certes des certifications RGE [reconnu garant de l'environnement, Ndlr] mais tout un secteur d'auditeurs et de préconisateurs reste à développer », poursuit-il.
-
Des blocages techniques
Changer une chaudière au gaz par un autre équipement n'est pas non plus aussi simple qu'il n'y paraît. « Ce ne sont pas les mêmes solutions que l'on soit sur un territoire rural, au Nord ou au Sud de la France », concède au palais du Luxembourg la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. « 90% des logements de demain sont déjà là. Essayons d'être intelligents ensemble. Ce sont des solutions complexes à traiter au cas par cas », affirme le président de la CAPEB.
Dans l'immobilier collectif, en cas d'installation d'une pompe à chaleur dans un immeuble, il faut à la fois un accord de la copropriété et une déclaration préalable de travaux. « Cela nécessite en effet de mettre des bouches d'aération en façade de même que les appartements n'ont pas nécessairement les évacuations d'air disponibles », abonde le président d'Eficia. Dans les pavillons, « c'est techniquement moins compliqué entre les accès extérieurs, les caves et les garages », assure le patron d'Hellio.
-
Des PAC fabriquées massivement en Asie
« Alors que les chaudières sont majoritairement produites en France et en Europe, une grande majorité des composants des PAC électriques provient d'Asie », alerte encore Coénove. « La combustion est un savoir-faire franco-européen. La fabrication de 90% des composants d'une chaudière à gaz est maîtrisée sur le Vieux Continent, tandis que le concept de la thermodynamique à l'œuvre dans les pompes à chaleur est historiquement maîtrisé en Asie. Si on instaure une interdiction trop rapidement, cela va favoriser les industriels asiatiques » prévient son président.
Pour éviter une perte de souveraineté industrielle, Jean-Charles Colas-Roy préconise de « laisser le temps aux industriels franco-européens de s'adapter pour aller vers la PAC hybride ». Un dispositif, encore très coûteux aujourd'hui, qui permet au chauffage à gaz de prendre le relais lorsque le système électrique est très sollicité, lors des vagues de froid notamment.
-
L'efficacité climatique questionnée
L'autre grand argument brandi par la filière gazière, c'est le risque que cette mesure, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ne soit pas efficace. « L'électrification trop rapide du parc de chauffage fait aussi peser un risque sur la soutenabilité des réseaux électriques en hiver. Les pouvoirs publics ne doivent pas sous-estimer le rôle du gaz dans la gestion de la pointe énergétique, et conserver une vision équilibrée du mix énergétique », écrit France Gaz dans un communiqué.
Autrement dit « une électrification à outrance du bâtiment », comme le redoute Jean-Charles Colas Roy, pourrait conduire la France à importer davantage d'électricité de ses pays voisins (et donc potentiellement produite à partir de gaz ou de charbon) ou à faire fonctionner davantage ses propres centrales à gaz pour produire l'électricité suffisante. « Si l'électrification massive n'est pas en phase avec le rythme de production d'électricité nucléaire et renouvelable, nous aurons des émissions additionnelles, plutôt qu'une réduction. Électrifier trop vite, ce n'est pas toujours décarboner », avait averti Laurence Poirier-Dietz, la directrice générale de GRDF, en avril dernier.
Même l'association négaWatt, très attachée à la décarbonation du bâtiment, n'est « pas favorable à une interdiction à court terme des chaudières à gaz ». « Nous ne sommes pas opposés aux pompes à chaleur électriques, mais la priorité est de mettre en place les conditions financières, techniques et d'accompagnement permettant de massifier la rénovation thermique performante des bâtiments. Le reste est secondaire pour l'instant », explique son président Stéphane Chatelin. « Nous comptons sur un développement assez fort des PAC. Dans notre scénario, elles pourraient chauffer la moitié du parc bâti en 2050, mais il faut que cela se fasse dans des logements rénovés », poursuit-il.
Installer des PAC avant des travaux d'efficacité énergétique, pourrait conduire à les surdimensionner, « ne serait-ce que pour obtenir la même température », confirme le président de la CAPEB. « Si on remplace toutes les chaudières à gaz et au fioul d'ici 2030 par des PAC dans les logements classés F et G, c'est-à-dire les plus consommateurs en énergie, cela pourrait représenter un appel de puissance supplémentaire pour le système électrique de 8 à 10 gigawatts lors de la pointe de l'hiver », précise Stéphane Chatelin.
« On ne fait pas moins 55% d'émissions de CO2 sans changement de chauffage dans les bâtiments », affirme, pour sa part, Thomas Veyrenc, le directeur exécutif du pôle stratégie, prospective et évaluation de RTE. Selon lui, le gain en termes de décarbonation est clair, tout en reconnaissant « un point de vigilance sur la pointe de consommation l'hiver ». « En face, il faut être capable de mettre les moyens de production au bon moment », ajoute-t-il. Des analyses sont en cours et seront rendues à l'automne prochain. « Il faut qu'il y ait un planning en concertation avec RTE », soutient Alric Marc, président d'Eficia.
-
Quid du gaz vert ?
La filière gazière demande donc au gouvernement de ne « pas confondre l'appareil et le combustible ». « Ce n'est pas la chaudière qu'il faut bannir mais le gaz qu'il faut verdir », insiste Jean-Charles Colas Roy. « Il y a un enjeu de cohabitation entre le biogaz et l'utilisation de l'électricité », a reconnu Xavier Piechaczyk, le président de RTE, lors d'une conférence de presse ce mercredi. « Il ne faut pas faire du tout-électrique. Ce n'est pas dans notre intérêt collectif », a admis Agnès Pannier-Runacher, au Sénat.
Concrètement, les professionnels de la molécule plaident pour que les quelque 6 millions de foyers disposant encore de chaudières d'ancienne génération puissent s'équiper d'une chaudière à Très haute performance énergétique (THPE). Selon GRDF, ce type de chaudière individuelle à condensation permettrait de réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre, par rapport aux chaudières classiques peu performantes. Toutefois, dans ses calculs, le gestionnaire ne prend en compte que la phase d'utilisation de l'appareil et non toutes les phases de son cycle de vie, comprenant notamment sa fabrication.
Au-delà du potentiel de décarbonation lié à l'efficacité énergétique des équipements, la filière vante sa capacité à se verdir en remplaçant progressivement le gaz naturel, par du biométhane, de l'hydrogène et des gaz de synthèse. Alors que le gaz naturel émet 227 grammes de CO2 par kilowattheure, le biométhane n'en émet que 44 grammes, souligne la directrice générale de GRDF. Aujourd'hui, les gaz verts ne représentent que 2% de la consommation globale de gaz en France. Toutefois, les professionnels du secteur affirment qu'il est tout à fait possible d'atteindre les 20% à l'horizon 2030. Mais ce gisement pourrait être mis à mal par l'accumulation actuelle des projets de méthaniseurs en liste d'attente.
« Il est tout à fait pertinent de compter sur une augmentation du gaz renouvelable. Mais la grande question c'est comment on utilise ces gaz verts ? Quels usages sont prioritaires ? Nous pensons qu'il faut davantage réserver le biogaz pour les mobilités lourdes », glisse le président de l'association négaWatt.
Autant de débats qui devront être tranchés pour définir la prochaine feuille de route énergétique de la France, attendue à l'automne prochain. « Qui imagine des camions venir livrer, plusieurs fois par semaine au pic de l'hiver, des granulés de bois dans les villes ? », ironise un professionnel.


 « Quand nous mettrons le pied sur l'accélérateur, nous serons difficiles à égaler » (Joelle Pineau, directrice de la recherche en IA chez Meta)
« Quand nous mettrons le pied sur l'accélérateur, nous serons difficiles à égaler » (Joelle Pineau, directrice de la recherche en IA chez Meta)


Sujets les + commentés