Rappelons-nous, avant l'éclatement de la bulle financière. Ce n'était pas les bonus des banquiers qui excitaient les foules. La société était traversée par une sourde révolte face à deux décennies de stagnation des salaires et à l'explosion des inégalités. Dans son dernier livre (*), Robert Reich nous rappelle, avec beaucoup d'à-propos à l'heure où la montée des populismes inquiète les démocraties, que ce sont paradoxalement ces maux qui sont à l'origine de la crise et qu'il convient de vite s'y attaquer pour sortir de l'ornière. « Sans réduction des inégalités, pas de sortie de crise ! », proclame l'ancien secrétaire d'État au Travail sous Clinton, un message qui s'adresse aux États-Unis mais qui résonne aussi de plus en plus fort en Europe. Pourtant, le diagnostic de la crise apparaît aujourd'hui comme une évidence : c'est la faute « d'un Américain trop dépensier et pas assez épargnant ». L'explication de Robert Reich est tout autre : la crise n'est ni financière ni bancaire; elle est sociale. Le problème, selon lui, est que les Américains achètent trop peu. Une thèse osée, alors que l'on ne cesse de répéter que l'Amérique vit au-dessus de ses moyens, entraînant des déséquilibres de toutes natures et un endettement sans limites. Mais il persiste et signe, c'est bien la stagnation voire la régressiondes salaires de la classe moyenne qui sont le frein à la croissance. Le remède consiste alors à donner davantage de pouvoir d'achat. Loin donc du tonitruant « augmenter les salaires, la dernière bêtise à faire » lancé récemment par Jean-Claude Trichet, président de la BCE.Mais Robert Reich plaide surtout pour une meilleure distribution des revenus. Il aurait pu fonder son plaidoyer sur des principes moraux. Il est en effet injuste que 1 % des Américains les plus riches concentrent 23 % du revenu national (comme en 1928 !) contre seulement 10 % pendant les années 1950-1970. Mais l'auteur préfère défendre un argument purement économique : une bonne redistribution des richesses est une condition préalable à la croissance. Il appelle, en appui de sa démonstration, Marriner Eccles, l'un des pères du New Deal et président de la Fed de 1934 à 1948. « La production de masse doit s'accompagner d'une consommation de masse et cette consommation de masse implique une distribution des richesses produites », expliquait-il. C'est ce qu'avait compris avant l'heure le constructeur automobile Henry Ford qui n'hésita pas à tripler le salaire moyen de ses ouvriers pour qu'ils puissent s'acheter des Ford T. Ce principe fonda la prospérité de l'Amérique de l'après-guerre, mais depuis les années 1980, la mondialisation et le progrès technique ont progressivement chassé l'ouvrier bien payé au profit de l'employé peu rémunéré. Le problème n'est donc pas tant l'emploi (qui a progressé) que les salaires (qui ont baissé). Une nouvelle division du travail est apparue entre des services à haute valeur ajoutée (finance, technologies de pointe, design), très bien rémunérés et réservés à une élite, et des services de proximité (bâtiment, restauration, santé...), certes abondants mais assurés par une main d'oeuvre bon marché, souvent issue de l'immigration. Mécaniquement, les écarts ne peuvent que croître. Or, les riches, aussi riches soient-ils, constituent une base trop étroite pour relancer l'économie. Parallèlement, la classe moyenne a gardé les mêmes aspirations. Pour combler sa perte de pouvoir d'achat, elle a eu recours tour à tour au travail des femmes, aux heures supplémentaires et, enfin, au crédit. En ce sens, la stagnation des salaires explique la bulle. Mais toutes ces bouées ont disparu avec la crise. Pour la première fois depuis soixante ans, l'Américain doit se serrer la ceinture. Ce qui risque de créer des remous, surtout quand une richesse clinquante continue de s'étaler dans les médias. L'équité, « ce qui est juste », notion fondatrice de l'Amérique, s'est également évaporée. D'où l'urgence d'agir pour éviter la confrontation. Robert Reich propose un « nouveau New Deal » pour les classes moyennes avec, au coeur du dispositif, une refonte complète de la fiscalité. Il propose de relever le taux marginal d'imposition du travail et du capital à 55 % - ce qui paraît raisonnable sachant que ce taux était de 70 % entre 1936 et 1980 - et de créer un impôt « négatif » pour tous les revenus inférieurs à 50.000 dollars, financé en partie par une taxe carbone. L'intérêt du propos est cependant ailleurs : il pose clairement le débat de la résolution de la crise sur un terrain politique, et non plus technique. Il s'agit de rééquilibrer les rapports de force. Un enjeu de débat majeur pour les États-Unis comme pour les pays européens. (*) « Le Jour d'après », par Robert Reich, Éditions Vuibert.L'analyse
Crise financière ? Non, crise sociale !
-
Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.

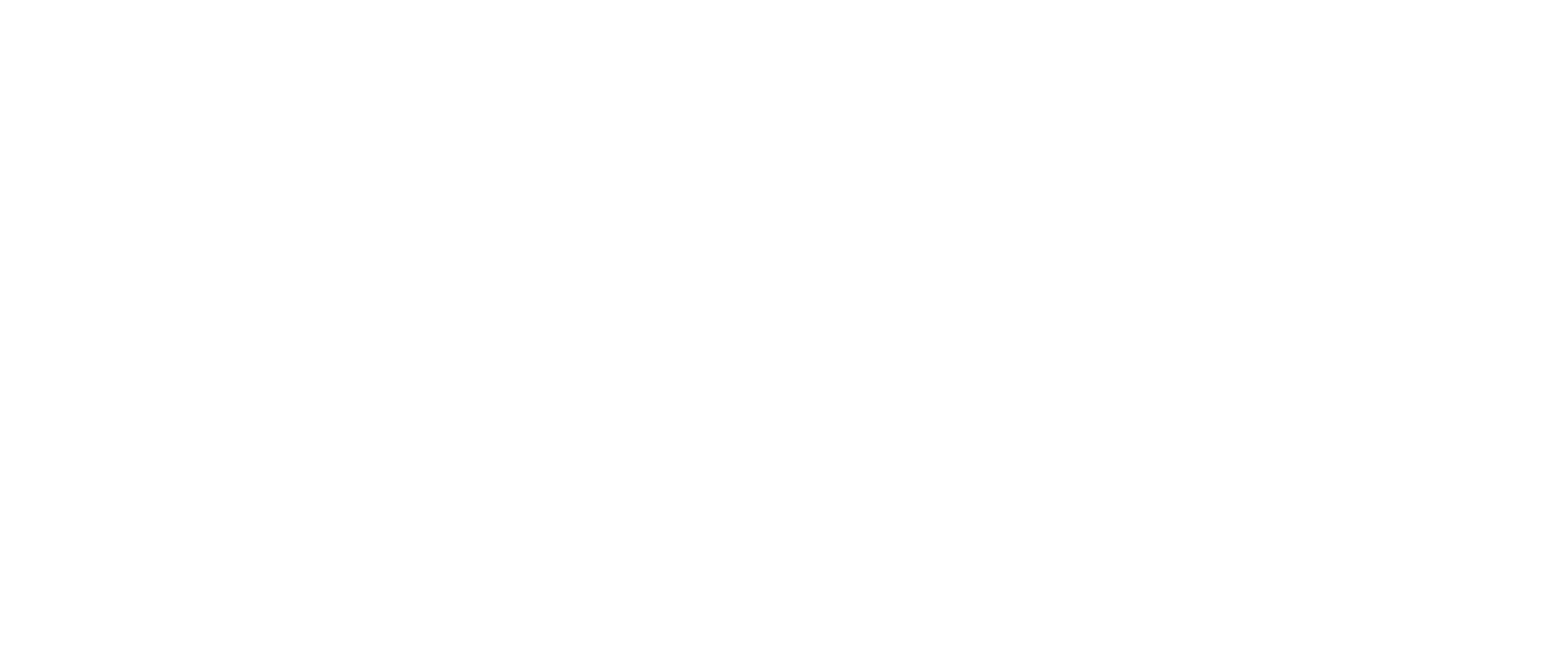


Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !