
L'anti-biopic
Daaaaaalí !, de Quentin Dupieux, avec Anaïs Demoustier, Jonathan Cohen , Édouard Baer, Gilles Lellouche, Pio Marmaï... 1 h 18. Sortie mercredi.
Note : 3/4
Rien d'étonnant à voir Quentin Dupieux, cinéaste expert en non-sens, affranchi des règles et amateur d'abstraction, se lancer dans un film sur le peintre Dalí, chantre du surréalisme, qui a fait de son propre personnage son chef-d'œuvre. Rien d'étonnant non plus à ce que ce biopic échappe à toutes les règles du biopic : sans aucune chronologie ni dissection psychologique, ce film très visuel, avec gags et situations aussi loufoques que son inspirateur, ambitionne d'entrer dans la folie de Dalí sans chercher à analyser le personnage. Pour ce faire, le réalisateur de Yannick, du Daim et de Mandibules a choisi une situation de départ très ouverte, pour pouvoir naviguer à l'aise dans tous les scénarios : une jeune journaliste (parfaite Anaïs Demoustier) cherche à rencontrer Dalí pour faire un documentaire sur lui, mais le projet sera bien entendu perturbé par d'innombrables péripéties surréalistes, condamnant toute tentative de capturer l'artiste. Insaisissable, Dalí l'est d'autant plus qu'il est interprété tour à tour par six comédiens (Édouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaï, Gilles Lellouche...), se délectant tous à donner leur interprétation du maître, de son génie et de sa mégalomanie. Jeu avec le temps, dédales narratifs, comique de répétition, gags visuels, mise en image de son tableau Fontaine nécrophilique... Le film est celui d'un cousin pas si lointain qui joue dans la même catégorie que son sujet. C.L.
Quand la belle craint la bête
La Bête, de Bertrand Bonello, avec Léa Seydoux, George MacKay, Guslagie Malanda. 2 h 26. Sortie mercredi.
Note : 3/4
Trois époques différentes, - 1910, 2014, 2044 -, trois visages pour une même femme : Gabrielle Monnier, blonde solitaire et terrifiée, qui remonte le temps tel un passe-muraille. Chômeuse en 2044, elle est condamnée à accepter un métier dénué de sens dans un monde régi par l'intelligence artificielle (IA) où les émotions humaines, créatrices de souffrances inutiles, doivent être supprimées. Des robots manœuvrés par l'IA, que l'on croirait surgis d'un film de David Cronenberg, la plongent dans un bain noir et visqueux pour mieux la renvoyer, par la pensée, dans ses vies antérieures : elle pourra « nettoyer son ADN » de ses idées noires et sentimentales qui la poursuivent dans le temps. En 1910, elle se retrouve, en corset et chapeaux à plumes, dans son ancienne peau de musicienne mariée et frustrée, et en 2014, devant l'œil des caméras, dans ses habits d'actrice solitaire et fauchée. Mais Gabrielle va surtout revivre ses amours ratées avec Louis, l'homme de ses vies, présent dans chacune de ses trois existences, tantôt amoureux transi, tantôt virilement violent. Leur amour frustré et fatal ne sera jamais ni consommé, ni heureux.
Sommes-nous condamnés à rejouer le même scénario que dans nos vies antérieures ? Faut-il bannir la colère, l'amour et la peur pour vivre heureux ? Avec ce 10e long-métrage, La Bête, le réalisateur Bertrand Bonello prouve qu'il est plus que jamais le cinéaste des périodes de mutation : ses personnages, esclaves de leur époque, apparaissent comme des pantins impuissants à se libérer des rôles sociaux auxquels ils sont assignés. Le quinquagénaire se balade ainsi dans le temps, allant du film littéraire en costumes à la science-fiction en passant par le récit contemporain façon thriller angoissant, avec un seul but : cerner la « bête », cette peur d'aimer que Gabrielle s'attend à voir surgir à tout moment, déjà responsable de ses ratages amoureux antérieurs. « La peur de mon personnage se traduit de façons différentes selon les époques, détaille Léa Seydoux. En 1910, sa peur d'aimer est intériorisée, contenue ; en 2014, elle explose violemment, et en 2044, elle est annihilée. »
Bertrand Bonello s'est inspiré d'un court roman de Henry James, La Bête dans la jungle, dans lequel c'est l'homme qui passe à côté de la femme de sa vie, obnubilé par cette « bête » qui l'empêche de vivre son existence. Le réalisateur de L'Apollonide (2011), de Saint Laurent (2014) et de Nocturama (2016) a inversé les personnages pour donner le rôle-titre à Léa Seydoux, qu'il retrouve ici pour la troisième fois. « Avec Bertrand, nous nous connaissons bien, poursuit l'actrice. Cela fonctionne entre nous car nous avons des obsessions similaires : comme moi, Bertrand est très romantique et il est travaillé par la question du sentiment amoureux. Le cinéma nous permet d'explorer cette nature humaine. »
Le film, hybride et complexe dans sa forme, rappelle David Lynch, avec ses constants allers-retours temporels, ses dédales narratifs et ses symboles beaux-bizarres qui traversent le temps : pigeons de mauvais augure, médiums désorientés et poupées figées. Mais, loin de s'arrêter à un exercice de style, le propos du film, compréhensible, ne perd pas son spectateur. Il questionne même les métiers du cinéma : comment jouer sur des fonds verts sans partenaires ? Où est la limite entre actrice et mannequin ? Avant de réserver une surprise futuriste au générique, dont nous ne dévoilerons rien...
De ce choc entre romanesque et intelligence artificielle, les affects sont les premières victimes : dans un avenir pas si lointain à la terrifiante froideur, où l'on ne s'autorise à ressentir quelque chose que dans des night-clubs passéistes, les jolies poupées sans affect sont devenues réelles (parfaite Guslagie Malanda, déjà vue dans Saint Omer). À la manière d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry (2004), les humains qui le souhaitent ont accepté de ne plus rien ressentir, surtout les traumas de la rupture amoureuse : exit le chagrin de la perte ou du souvenir, bienvenue dans un monde clinique et sans sensations. Ces boucles de récits entremêlés, angoissées et cérébrales, seraient glaçantes si elles n'étaient pas contrebalancées par le jeu des deux fascinants acteurs principaux : le caméléon George MacKay (qui a repris le rôle prévu pour Gaspard Ulliel), aussi élégant en amoureux chic et transi qu'angoissant en « masculiniste » haïssant les femmes ; et l'instinct brut de l'organique Léa Seydoux, qui vibre et épate dans son aisance à transfigurer le feu et la glace, quelle que soit l'époque. C.L.
Les damnés de la frontière
Green Border, d'Agnieszka Holland, avec Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Behi Djanati Atai. 2 h 32. Sortie mercredi.
Note : 4/4
Une famille syrienne se croit chanceuse de passer par la Biélorussie afin de rallier la Suède sans visa, via la Pologne. Elle se découvre maudite aux portes d'un pays paradoxal, membre de l'Union européenne mais gangrené par l'extrême droite. De part et d'autre de la frontière, dans une forêt marécageuse, des militaires aux méthodes violentes les pourchassent et les maltraitent sans vergogne, sans explication. Les rares humanitaires présents manquent de moyens, de coordination. Ce tableau extrêmement sombre et renseigné de la situation avérée des migrants et demandeurs d'asile dans l'est de l'Europe, Agnieszka Holland le reconstitue en noir et blanc, poussant progressivement le vérisme aux confins de la terreur, de l'horreur, de la guerre.
Ce faisant, elle entrelace ces destins brisés à ceux de citoyens polonais qui vivent près de ces zones grises où l'Europe perd sa dignité, où la Biélorussie agit dans le plus grand cynisme. Ainsi, une psychologue aisée tente de venir en aide aux parias terrorisés, qui frôlent sa maison isolée en « zone interdite »... mais doit alors se mettre elle-même en danger La solitude de chaque personnage est ici documentée au gré de situations inspirées de faits réels. Cela nous ramène, bien sûr, à notre responsabilité face au discours ambiant qui prône la fermeture et cultive le racisme plutôt que l'entraide et l'humanité. Ce film poignant, captivant, maîtrisé, sans fioriture, écrit au cordeau et travaillé par la nécessité est un succès en Pologne où, sans surprise, il agace l'extrême droite. A.C.
Le conte est beau
Le Royaume de Kensuké, de Neil Boyle et Kirk Hendry, avec les voix de Cillian Murphy et Sally Hawkins dans la VO. 1 h 24. Sortie mercredi.
Note : 3/4
En 1999, le Britannique Michael Morpurgo mettait les jeunes lecteurs et leurs aînés à ses pieds en glissant dans leurs mains Le Royaume de Kensuké, roman d'aventures inspiré de Robinson Crusoé. Vingt-cinq ans plus tard, le livre aimé et primé s'offre une nouvelle peau dans un film d'animation taillé pour petits et grands. À travers un style 2D artisanal à tomber, l'histoire de Michael se déploie sous nos yeux souvent émerveillés. Rescapé d'une tempête avec sa chienne Stella, le garçon de 11 ans se retrouve échoué sur une île déserte. Hostile et sombre aux premiers abords, le cadre se révèle sous sa plus belle lumière dès l'arrivée d'un certain Kensuké. En plus de l'aider à survivre, cet ancien soldat ayant élu domicile au milieu des orangsoutans va apprendre à Michael le respect de la nature, le sens du partage et de la vie. Fable optimiste sublimée par une esthétique lui conférant une dimension féerique, le film, rythmé, émeut et marque les esprits. M.F.

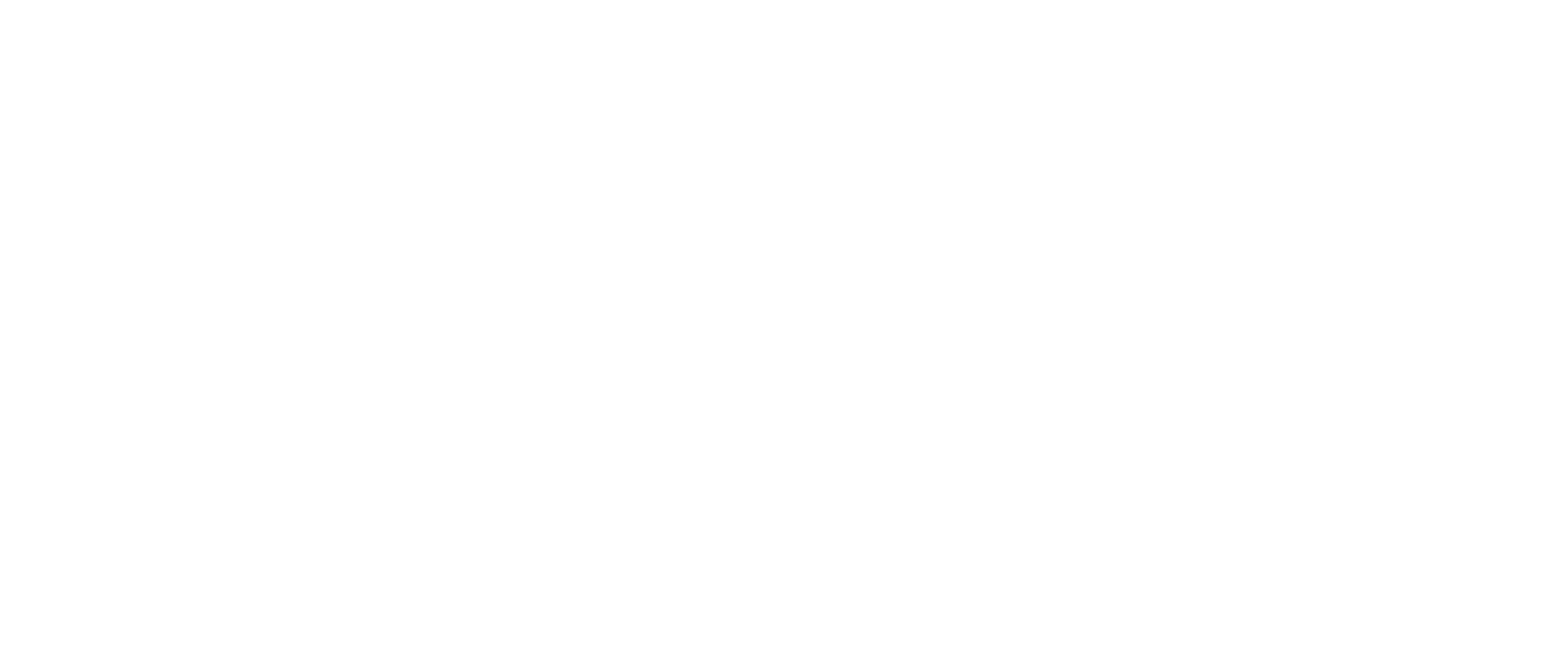
 Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français
Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français

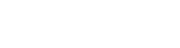
Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !