
Le sujet a animé des débats houleux ces dernières semaines : le parc nucléaire d'EDF peut-il s'adapter au réchauffement climatique, et notamment à la multiplication des sècheresses qu'il implique ? Dans un rapport publié en mars, la Cour des comptes pointait des ajustements nécessaires face aux changements de températures de l'air et de l'eau à venir, ou encore aux étiages (la baisse de débit des cours d'eau) sévères.
Car pour être refroidis en permanence, les réacteurs prélèvent de l'eau et la rejettent plus chaude. Un processus qui a posé problème l'été dernier, alors que la Garonne risquait de dépasser les seuils de température autorisés pour ne pas nuire à la reproduction des poissons et éviter la prolifération des algues, poussant EDF à demander une dérogation afin que les centrales de Golfech et du Blayais puissent malgré tout continuer de produire de l'électricité.
Une baisse d'1,5% de la production d'ici à 2050
Pour déminer le terrain, et alors qu'une bataille de chiffres fait rage côté politiques sur la consommation d'eau du nucléaire, EDF a convoqué les journalistes à son siège parisien, mardi après-midi. Au menu : une « masterclass » de 3 heures concernant l'impact du changement climatique sur ses installations, dont la question du réchauffement des fleuves et rivières. « Nous y travaillons depuis 1990, et nous avons réalisé une première étude sur le débit et la température des cours d'eau dès 1997 », a souligné Sylvie Parey, ingénieure chercheure à la direction R&D du groupe.
Résultat des modélisations : depuis 2000, le parc atomique a vu sa production baisser de 0,3% en moyenne du fait du climat, c'est-à-dire pour respecter les niveaux réglementaires de température d'eau rejetée dans les milieux naturels. Un pourcentage qui devrait néanmoins grimper à 1,5% d'ici à 2050, selon l'électricien. « Avec un parc identique, cela représente 5 térawattheures (TWh) sur une production totale de 400 TWh », a précisé Cécile Laugier, directrice environnement et prospective de la division production nucléaire d'EDF.
Même s'il s'agit d'une multiplication par 5, ces résultats sont « assez rassurants » et « n'enlèvent rien à la rentabilité économique », affirme-t-on en interne. Surtout, EDF prépare ses centrales à consommer moins d'eau, a fait valoir le groupe mardi. En effet, dès 2003, l'énergéticien a déployé un plan « grand chaud » pour « veiller à la juste consommation d'eau », notamment. Côté investissements, le coût estimé de cette adaptation reste « modeste », selon la Cour des comptes, « de l'ordre du milliard d'euros pour la période passée et d'environ 600 millions d'euros pour les quinze prochaines années ».
Vers une modification des normes de réchauffement des cours d'eau ?
Par ailleurs, des discussions sont en cours pour revoir les normes d'échauffement des fleuves et des rivières dans lesquels les réacteurs s'alimentent. En juillet 2022, l'inspecteur en chef de l'Autorité de sûreté du nucléaire (ASN), Christophe Quintin, affirmait déjà dans un entretien à La Tribune que « la canicule devrait nous pousser à repenser les seuils de température des cours d'eau en vigueur ».
« Pour la première fois depuis 2003, les pouvoirs publics ont utilisé un régime exceptionnel prévu pour autoriser la production d'électricité , en dépit de l'échauffement des cours d'eau, en raison de la tension sur le réseau électrique. [...] C'est un signal important, qui nous conduit à réinterroger le cadre réglementaire, en se demandant dans quelle mesure il devra s'adapter aux grandes tendances d'évolution », a précisé Cécile Laugier.
Et pour cause, les « études canoniques datant des années 1970 » ayant servi à établir ces normes ne prennent pas en compte le changement climatique, qui « bouscule les installations et les écosystèmes », affirme-t-on chez EDF. « Il faut qu'on réfléchisse avec les pouvoirs publics et les spécialistes de l'écologie à comment mieux le prendre en compte », poursuit-on en interne. Néanmoins, pour l'heure, l'électricien n'a pas fait de demande formelle de relèvement de ces seuils.
La question des tours aéroréfrigérantes
Une autre option pourrait être étudiée : celle d'installer des tours aéroréfrigérantes dans les huit réacteurs situés en bord de fleuve ou de rivière qui n'en disposent pas aujourd'hui. En effet, toutes les centrales ne sont pas logées à la même enseigne. Car leur sensibilité au climat dépend fortement de leur système de refroidissement. En France, les 30 qui fonctionnent en « circuit fermé », c'est-à-dire dotées d'une tour aéroréfrigérante, s'avèrent en effet moins concernées par les limites de rejets thermiques, puisque l'eau prélevée est faible (de 2 à 4 mètres cube par seconde) et s'évapore en partie via la tour, plutôt que d'être rejetée à la source. À l'inverse l'inverse, pour les 8 en « circuit ouvert » (sans tour), comme au Blayais, le volume d'eau prélevé est important - autour de 50 mètres cubes par seconde - et revient en quasi-totalité à la source avec une température plus chaude, sans passer par des tours d'évaporation. Ce sont donc celles-ci qui risquent d'avoir des rejets thermiques trop importants.
Mais multiplier les tours de refroidissement dans les installations existantes impliquerait d'engager des « modifications substantielles », qui sont pour l'heure « très difficiles à envisager », assure-t-on chez EDF. « Il y a la question des coûts, mais aussi du remaniement très profond de l'ensemble de la conception des centrales, qui conduirait probablement à l'immobiliser pendant assez longtemps », note Cécile Laugier.
Innover pour consommer moins d'eau
D'autant qu'un « paradoxe » existe, poursuit-elle : les réacteurs pourvus d'une tour aéroréfrigérante consomment in fine davantage d'eau que les autres. En effet, même s'ils prélèvent moins d'eau que les huit qui ne disposent pas de cette fameuse tour, avec 10 litres par kWh contre 170 litres le cas échéant, 77% seulement de cette eau est restituée au milieu naturel, quand les centrales en « circuit ouvert » en rejettent 100%. Et pour cause, l'eau s'évapore en partie via la tour, plutôt que d'être rejetée à la source.
Au-delà de la question des rejets thermiques trop importants, le groupe travaille donc également à « améliorer la performance des systèmes de refroidissement », afin qu'ils consomment moins d'eau. Et s'apprête à tester « d'ici à la fin de l'année » à Bugey une innovation du Massachussets Institute of Technologie (MIT), baptisée « Infinite cooling ». Développée par les ingénieurs Maher Damak et Kripa Varanasi, celle-ci permet de recycler une partie de la vapeur d'eau des centrales nucléaires qui représentent 12 % des prélèvements nets d'eau douce en France sur la période 2010-2019.
Choix des sites des futurs EPR
Enfin, pour ce qui est des six futurs réacteurs, dont Emmanuel Macron a annoncé la commande, EDF devra tenir compte de ces problématiques dans le choix des sites. Par ailleurs, le recours à un fonctionnement en circuit fermé, donc avec tour aéroréfrigérante, est devenu obligatoire depuis 2021 pour les éventuelles nouvelles installations nucléaires en bord de rivière ou de fleuve.
« La modification du parc, la localisation des tranches actuelles qui resteraient en service et le choix des sites d'implantation des nouvelles installations sont autant de paramètres qui influeront sur la disponibilité du parc lors des phases de canicule ou de sécheresse », fait ainsi valoir RTE dans ses scénarios Futurs Energétiques 2050.
Reste que la sélection sera surtout guidée par l'implantation dans les sites du parc existant. « Il y aura une préférence pour le bord de mer, mais EDF va privilégier les lieux où il y a déjà des centrales, pour des questions de coûts et d'acceptabilité », affirmait il y a quelques mois Tristan Kamin.
Au-delà de l'atome, la question de l'adaptation au réchauffement climatique porte sur le système électrique dans son ensemble. Et pour cause, toutes les installations seront concernées, des barrages aux panneaux solaires, en passant par les éoliennes. « Chaque infrastructure a des seuils de tolérance technique. Si on veut exclure une technologie au motif qu'elle est sensible au modèle climatique, autant exclure tout le modèle électrique », glissait l'an dernier Tristan Kamin. D'autant que la plus grosse vulnérabilité concernera les périodes froides, où la demande est forte, combinées à un manque de vent. Et pour cause, « le développement des énergies renouvelables variables apporte une sensibilité accrue du système aux aléas météorologiques (vent, rayonnement, température...) », prévient RTE dans son étude Futurs Energétiques 2050. Et d'affirmer que « la question des périodes sans vent devient en particulier centrale dans l'analyse des besoins de flexibilité du système ». Mais aussi, paradoxalement, celle des périodes caniculaires pour ce qui est des panneaux solaires, puisqu'au-delà d'une température extérieure de 25°C, leur rendement commence à chuter, à raison de 0,5% par degré. Se posera également la question de l'adaptation des centrales hydroélectriques, qui s'avèreront cruciales pour gérer les pointes de demande dans un mix énergétique composé de moyens de production de plus en plus sensibles à la météo.Des enjeux qui dépassent la seule question du nucléaire

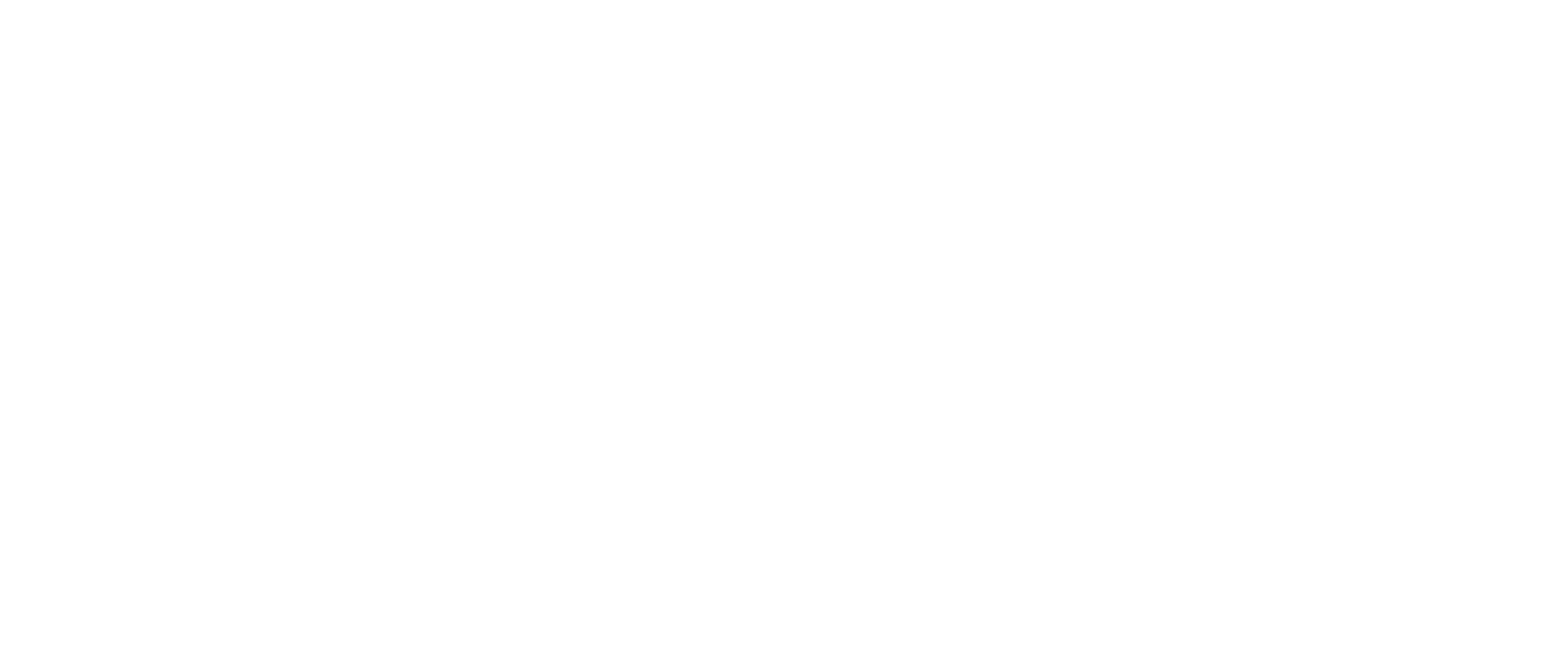

 Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français
Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français

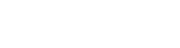
Sujets les + commentés