Les derniers mois furent, pour lui, un calvaire. « Pas un jour, avouait-il, pas une heure sans souffrance. » Il parlait pudiquement de cette chose innommable qui le dévorait, sans user pour cela du moindre adjectif. Juste avec l'air légèrement étonné de celui qui « n'avait jusque-là jamais pris un cachet d'aspirine ». Pas loin de croire, en provincial méfiant qu'il n'avait jamais cessé d'être, que « toutes ces pilules et ces drogues bizarres », que ses médecins s'épuisaient à faire prendre à ce patient capricieux, le rendaient en fait plus malade que sa maladie. A l'extrême limite de son existence, François Mitterrand s'était mis à ressembler de façon étonnante à son grand-père maternel, auprès de qui il avait passé les plus belles années de sa première enfance, à Touvent, sur les bords de la Charente. Décharné comme un pied de ces vignes cognaçaises qu'il aimait tant, courbé sur sa canne, les yeux délavés par la douleur mais toujours vifs et mobiles. Plus effrayé par la déchéance physique qu'il subissait que par l'approche inéluctable de sa fin. « Désormais, je compte en jours », disait-il à la mi-décembre. Prisonnier, aussi, de ce personnage qu'il s'était forgé, au fil du temps, comme on enfile une armure protectrice. Obsédé par la mort depuis toujours, François Mitterrand avait choisi, orgueilleusement, de faire croire qu'il avait apprivoisé l'idée. Comme si cet amoureux fou de la vie, de ses couleurs et de ses odeurs, de ses passions et de ses combats, pouvait en imaginer sans une indicible horreur l'achèvement. Mais sa fierté était d'avoir réussi à en persuader chacun. Et même, parfois, à force, lui-même. Toutefois, l'armure avait encore des failles. Et il s'en voulait beaucoup d'avoir, quelques semaines avant la fin de son mandat, cédé à l'envie enfantine d'être rassuré en tentant « d'en savoir plus ». Il s'en était allé, un soir, consulter chez lui le vieux Jean Guitton, réputé entretenir avec l'Eternel des rapports cordiaux. L'écrivain ne lui avait rien confié « que de très banal ». Mais n'avait pu, ensuite, résister au méchant plaisir de raconter, à sa façon, la visite présidentielle à la presse qui en fit ses choux gras. Le chef de l'Etat en fut blessé et, réaction normale, en fit un bon mot : « Tout philosophe et bon chrétien que se croit ce monsieur, il a été simplement ravi de constater qu'un homme plus jeune allait probablement rejoindre avant lui la béatitude céleste qui devrait pourtant, en principe, être son but premier ». Pressé d'en finir, non, François Mitterrand ne l'était pas. Lui qui avait trouvé « incroyablement bref » le temps passé à l'Elysée avait d'ailleurs gentiment averti son successeur, lors de la passation de pouvoirs, qu'il risquait de regretter, au cas où il réaliserait son imprudente promesse, la limita- tion du mandat présidentiel à sept ans non renouvelable. « Il faut déjà deux ou trois ans pour mettre les réformes en train, apprendre à déjouer les pièges, maîtriser les rapports internatio-naux. Ensuite, tout le monde s'intéresse déjà à votre successeur, et vous n'avez plus prise sur rien. » Ses années à la tête de l'Etat ont été, pour celui qui, dès la réforme constitutionnelle de 1962, s'était juré d'y accéder, les meilleures et les plus pleines de sa vie. Il avait la conviction profonde de les avoir « méritées », ne serait-ce que par ses vingt-trois ans d'opposition, de reconstruction opiniâtre de la gauche et sa certitude d'avoir « eu raison », devant les Français, face aux donneurs de leçons de son propre camp. De ses deux septennats, François Mitterrand ne voulait retenir que le meilleur. L'avancée des droits sociaux, des libertés, de la construction européenne, la réduction de l'inflation, la consolidation économique. Et, jusqu'au bout, il s'est rebiffé contre ceux qui osaient encore lui parler creusement des inégalités ou réformes de structures - fiscales notamment - différées. « Vous sous-estimez les résistances, inouïes, de tous. De l'administration, mais aussi des ministres, des syndicats, des patrons. Et même des Français. Les Français parlent tout le temps de la néces-sité des réformes, et en fait ils détestent cela. » Né à la politique sous la IIIe République, formé sous la IVe, l'ancien président était resté, profondément, un homme du passé, ancré dans le terroir national, et projetant sur la réalité de son pays des idées forgées entre les deux guerres. En même temps, passionnante complexité du personnage, peu d'hommes politiques se seront autant que lui intéressés à la recherche, aux techniques de pointe, à la modernité sous toutes ses formes. Il a voulu, une fois passée l'ébullition « nécessaire » de 1991 et 1992, faire entrer la France dans le futur en ménageant l'idée qu'il se faisait de son passé et des capacités au changement limitées de ses concitoyens. « L'Histoire sera avec moi plus juste que les journalistes ne l'ont été. Et les Français, eux, m'auront compris, j'en suis certain. » Mais, « un peu plus de cinq mille jours, on croit d'abord que c'est l'éternité. En fait, ils passent comme la vie, toujours trop vite ». Quelque chose, déjà, était mort en François Mitterrand le jour où il a franchi pour la dernière fois le portail de l'Elysée. L'envie de vivre, peut-être. A ceux de ses vrais amis qui l'interrogeaient sur ce qu'il ressentait, dans sa dernière retraite transformée en thébaïde, il ne cherchait même plus à donner le change : « Je me sens bien inutile », confessait-il, avec une pointe d'amertume. Et c'était bel et bien pour se replonger, durant trois petits jours arrachés à la grisaille, dans le bain de cette Histoire qui lui manquait tant, qu'il s'était rendu en septembre dernier à Aspen, aux Etats-Unis, contre l'avis de ses médecins. « Bush y tient tellement », jurait-il alors à ceux qui s'inquiétaient de sa lassitude. En fait, c'était lui qui tenait à occuper, une dernière fois, sa place. Son discours fut éblouissant. Il ne s'effondra qu'au retour à Paris. La volonté peut beaucoup. Elle ne peut pas tout. Ni réduire des métastases osseuses, ni même « changer la vie », alors que l'on dispose, en théorie, de tous les pouvoirs. Mais cela, il le savait aussi. Ressasser le passé agaçait le politique professionnel qu'il est resté jusqu'à son dernier souffle. Mal habile à parler de sentiments, grimaçant de douleur à chaque pas de la promenade qu'il s'infligeait chaque jour, pour prouver - à qui encore ? - la prééminence de l'esprit sur le corps, François Mitterrand retrouvait le verbe aigu, le regard malicieux et l'analyse percutante dès que la conversation revenait à son sujet de prédilection : l'actualité. En plein milieu des grèves, il avouait ainsi avoir été « stupéfait » de la maladresse d'Alain Juppé, pourtant, selon lui, « un des hommes politiques les plus brillants qu'il m'ait été donné de rencontrer ». Tout comme il reconnaissait, un brin vexé, avoir été « surpris » que les Français aient voté Chirac en mai. « Pourtant, ils l'avaient déjà vu à l'oeuvre. » Il est vrai, ajoutait-il très vite, pour expliquer son erreur de pronostic, que Balladur lui avait facilité les choses en donnant l'impression « qu'il se sentait déjà élu ». Dns ce pays, aimait-il à dire, « on nourrit toujours une certaine affection pour les hommes tenaces, obstinés, qui, couverts de cicatrices, remettent cent fois l'ouvrage sur le métier. C'était sans doute le tour de Chirac. Comme ce fut le mien en 1981 ». Au chevet du lit où François Mitterrand s'est éteint hier, deux manuscrits. L'un, terminé, qui retrace son parcours personnel de l'avant-guerre à la Libération. Il y a jeté ses dernières forces, sachant, ironique, que « ce livre posthume fera un tabac ». L'autre, bien avancé, sur les relations franco -allemandes et l'édification européenne, restera inachevé. Il le craignait. « Je redoute que mes successeurs ne défassent ce que nous avons eu tant de mal à construire. C'est pourtant la seule chance de la France de demeurer un grand pays. » François Mitterrand rageait d'être ainsi hors circuit, alors, disait-il, « qu'il reste tant à faire et que je n'ai pas pu achever ma tâche ». Et, regardant derrière lui cinquante-cinq années de vie engagée, avait-il, cet homme qui se voyait mourir, un seul regret à confesser ? « Aucun. Tout n'a pas été parfait dans ma vie. Qui pourrait d'ailleurs s'en vanter ? Mais tout ce que j'ai fait, je peux en être fier. Je veux dire, en tant qu'homme. Je ne me suis jamais agenouillé devant rien ni personne ». KATHLEEN EVIN
François Mitterrand : « En fait, les Français détestent les réformes »
-
Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.

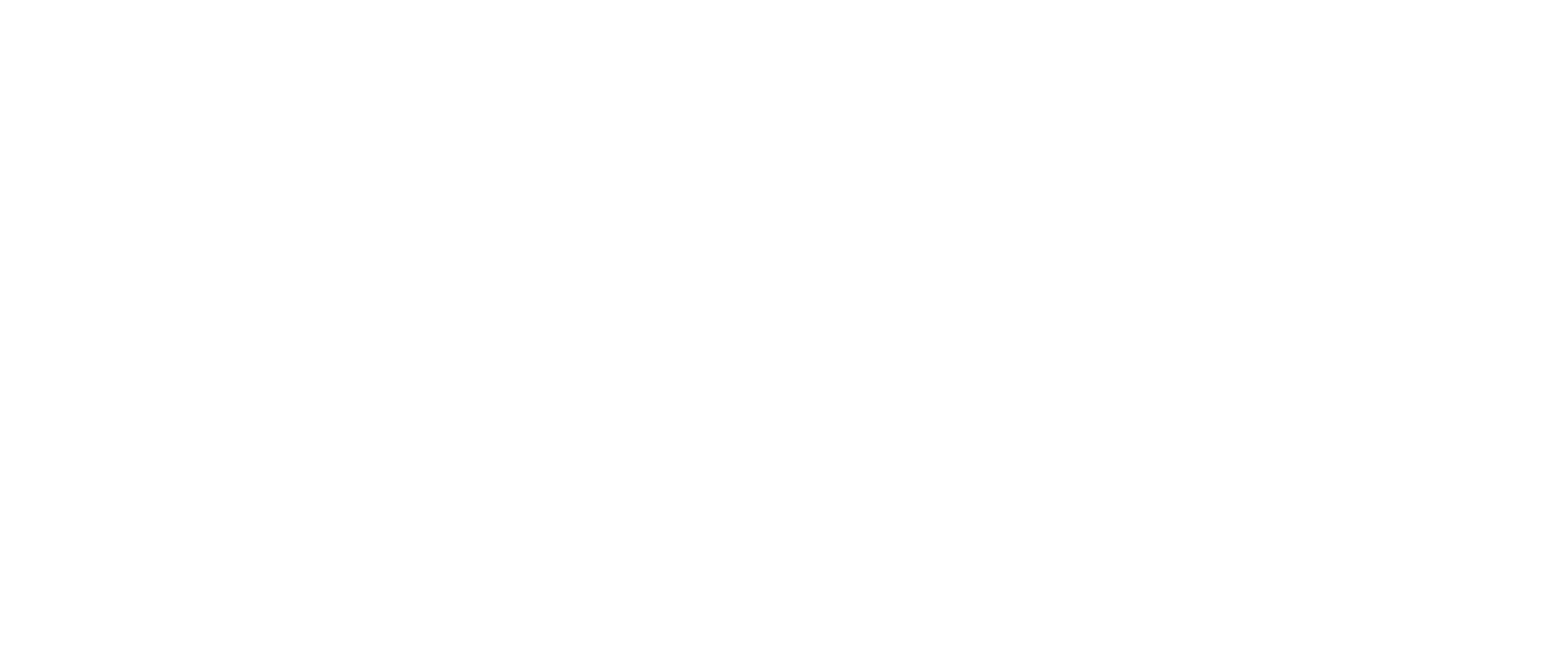


Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !