L'histoire est éloquente. Le 10 mars dernier, la Commission de la transparence, chargée en France d'évaluer l'intérêt médical des nouveaux médicaments, rend un avis médiocre sur le Multaq, un médicament de Sanofi-Aventis contre les troubles cardiaques. Un coup de massue par le labo français, qui menace de remettre en cause la commercialisation du Multaq, présenté comme un futur « blockbuster » (médicament à plus de 1 milliard d'euros de ventes). Trois mois plus tard, le 15 juin, coup de théâtre. À l'issue de son audition de la commission, le Multaq obtient un avis favorable au remboursement. Si l'on en croit les proches du dossier, il ne fait aujourd'hui plus guère de doute que le Multaq obtiendra un prix « satisfaisant » en France. Peut-être même comparable à celui du Royaume-Uni, où les prix sont libres : 2,25 livres par jour de traitement (2,70 euros), espèrent les analystes d'Oddo. Une victoire en forme de symbole pour le premier groupe pharmaceutique tricolore. « Notre objectif est de commercialiser Multaq d'ici à la fin de l'année », confirment les dirigeants de Sanofi. Cet épisode pose question. Un grand laboratoire obtient-il nécessairement un prix de vente attrayant de la part des autorités ? De l'efficacité médicale ou du poids économique, quel argument emporte la décision ? En France, la fixation du prix d'un médicament mêle arguments scientifiques et médicaux, considérations économiques et réflexions politiques. Un cocktail unique en Europe, qui fait l'intérêt, mais aussi la complexité du système. Quand un laboratoire a obtenu une autorisation de mise sur le marché, il soumet son dossier auprès de la Commission de la transparence et de sa trentaine d'experts (médecins, pharmaciens et spécialistes de la santé). « C'est l'intérêt purement médical du produit qui prime », explique Gilles Bouvenot, le président de la Commission. En cas d'avis favorable, la Commission fixe le taux de remboursement et le niveau d'ASMR (amélioration du service médical rendu). Pour le Multaq, l'ASMR a été jugé inexistant (niveau 5) malgré un taux de remboursement accordé de 65 %. Cet avis peut être discuté lors d'une audition - ce qu'a fait Sanofi le 2 juin - avant avis final. Les évolutions sont plus fréquentes qu'il n'y paraît. « Nous modifions notre avis dans 25 % des cas », indique Gilles Bouvenot. Ce dernier n'a qu'une valeur consultative pour la seconde instance, le Comité économique des produits de santé (CEPS). Dépendant du ministère de la Santé, il est composé de représentants de l'assurance-maladie mais aussi du ministère de l'Industrie et de la Recherche. Sa mission : fixer le prix définitif du produit selon des considérations « médico-économiques ». « Plus l'indication - et donc la population éligible au traitement - est large, plus le prix accordé est susceptible d'être faible », explique Vincent Genet, consultant au cabinet Alcimed. Ce n'est cependant pas le seul critère. « Pour de gros produits, certains labos consentent à des baisses de prix d'autres traitements ou à des déremboursements. Tout le monde y gagne : c'est économiquement intéressant pour les autorités de santé, et permet au groupe de lancer sa nouvelle molécule », détaille Alain Gilbert, directeur associé du cabinet de conseil Bionest. Entre aussi en ligne de compte la présence hexagonale de l'industriel. « Reporter de cinq à sept ans la fermeture d'un centre de recherche peut jouer », confirme un expert. « Nous avons davantage envie de parvenir à un accord avec une entreprise qui travaille beaucoup sur le sol français », admet Noël Renaudin, président du CEPS, qui ajoute : « Il y a toujours une marge de manoeuvre. Le juste prix, c'est celui sur lequel l'État et l'entreprise se mettent d'accord, sous le regard des concurrents et, le cas échéant, sous le contrôle du juge. » La balance ne penche pas toujours du même côté. Jacques Servier, 89 ans, patron des laboratoires éponymes, en sait quelque chose. Son groupe a beau être numéro deux français derrière Sanofi (3,6 milliards d'euros de ventes), son dernier antidépresseur, Valdoxan, a obtenu dans l'Hexagone « le prix le plus bas de tous les pays d'Europe », déplore-t-il. Impossible, pourtant, de perdre de vue la loi du marché. « Nous avons accepté, quelque peu contraints, les prix européens [fondés sur ceux du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne, Ndlr] », indique Noël Renaudin. Sinon, la machine peut s'emballer. Au Royaume-Uni, les autorités de santé (NICE), connues pour leur sévérité, ont refusé de rembourser l'anticancéreux Avastin, de Roche, qui peut coûter près de 20.000 euros par an pour un traitement. « Le labo a menacé de quitter le pays, en arguant qu'il ne représentait que 3 % du marché mondial... Les autorités britanniques ont dû aller leur parler pour les rassurer », raconte Alain Gilbert. Le discours des labos évolue aussi. Pour un traitement au coût facial très important, ils mettent en avant les économies engendrées pour le système de soins (hospitalisations, soins à domicile...) et plus seulement la supériorité par rapport aux concurrents. Au CEPS, Noël Renaudin se veut pourtant ferme : « Le discours des entreprises qui consiste à dire que leurs produits font faire des économies à la Sécurité sociale est presque toujours faux », assure-t-il. Et pourtant. À efficacité égale, un traitement présentant un plus grand confort d'administration, ou moins d'effets secondaires, peut avoir une valeur pour le patient - donc pour le fabricant. Ainsi, le Multaq est censé éviter aux malades les effets gênants de l'amiodarone et réduire le risque d'hospitalisation. « Il n'apporte pas de progrès thérapeutique, mais peut être utile à certains malades », se justifie Gilles Bouvenot. Sanofi devrait donc être entendu. « Ils vont faire jouer tous les aspects pharmaco-économiques. C'est l'un des plus grands laboratoires mondiaux, il y aura nécessairement des arbitrages secrets : déremboursement de produits, baisses de prix... », estime Alain Gilbert. De quoi assurer aux deux parties une issue satisfaisante. « La relation entre les autorités de santé et les laboratoires est comme celle d'un couple fusionnel : l'un ne peut pas vivre sans l'autre ! » conclut Vincent Genet. Audrey Tonnelie
Médicaments : dans les coulisses de la négociation des prix
-
Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.

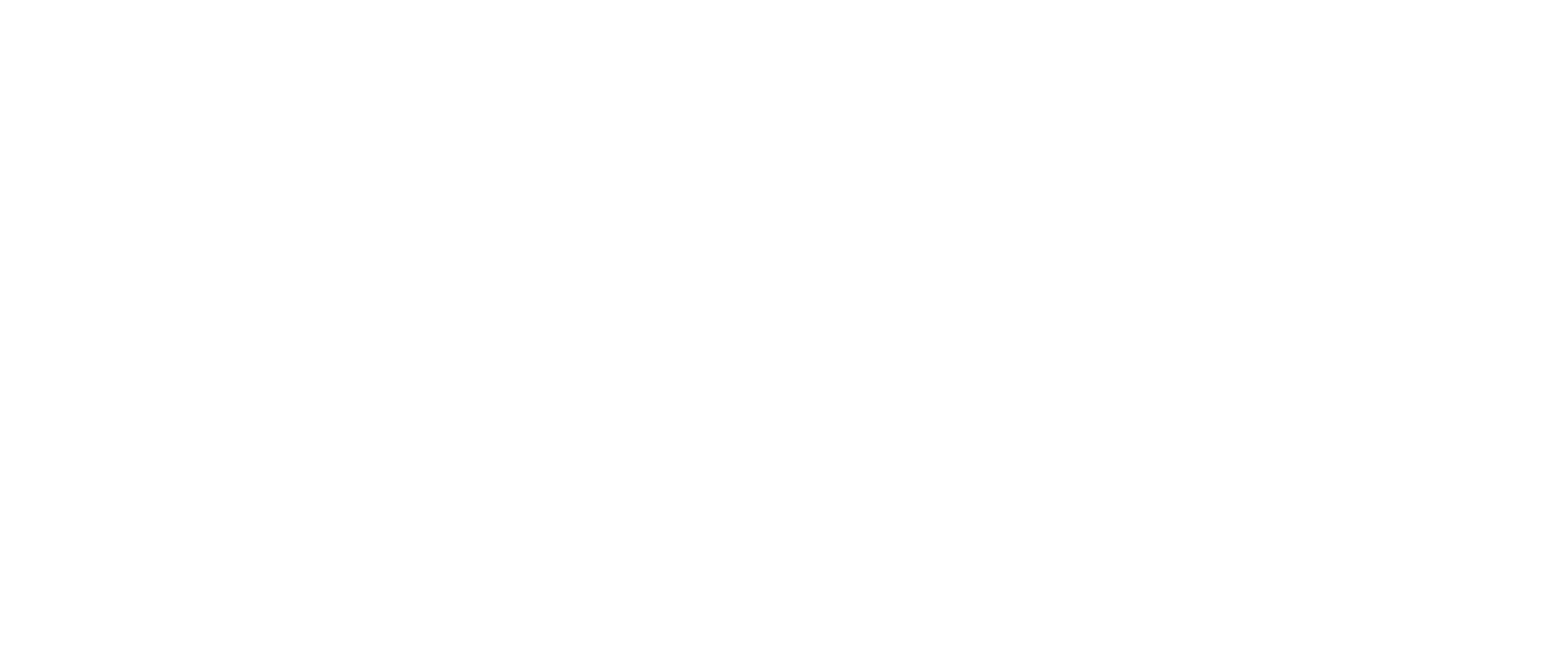


Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !