Passée, présente, à venir, la crise est une étiquette si grosse qu'elle éblouit ceux qui la regardent et cache tout ce qu'elle recouvre. Ne cédons pas à l'hystérie de ceux pour qui la crise est l'apocalypse bienvenue qui met fin au marché, à l'entreprise, au capitalisme. Car il se pourrait bien que tout le contraire soit vrai.Fin du marché, fin des marchés financiers ? C'est tout le contraire. Les États ont consenti, sous le nom de relance ou de sauvetage, des concours considérables à leurs systèmes bancaires et à leurs économies, dont on a redécouvert à l'occasion que les unes et les autres demeuraient étroitement dépendantes des Nations. Et ils se sont endettés selon les modalités de rigueur depuis trente ans : sur les marchés internationaux, par l'intermédiaire des banques et de leurs services dédiés. Nécessité a fait loi, et c'est avec une unanimité et une rapidité étonnantes que les fameux critères de Maastricht ont été jetés aux orties, pourtant l'alpha et l'oméga de l'ordre européen depuis vingt ans ! Le résultat ne fait pas de doute ; nous assistons à une prise de pouvoir sans précédent des investisseurs internationaux, des gérants de capitaux et des banques. Et les banquiers peuvent sourire en entendant le déferlement de démagogie de rigueur au sujet des bonus, des paradis fiscaux ou des hedge funds ; ceux qui tiennent la dette tiennent l'État. Selon le mot en vigueur, Goldman Sachs est devenu Government Sachs ? de fait, l'une des puissances mondiales avec lesquelles il faut compter. Le résultat paradoxal de la faillite bancaire américaine est le renforcement inouï du pouvoir des banques.Mise en cause de l'entreprise et du capitalisme ? Analyser la traversée de la crise de la plupart des grandes entreprises, notamment en France, est éloquent. Non seulement les entreprises privées s'en tirent beaucoup mieux que les États surendettés ou faillis, non seulement beaucoup ont passé le cap avec constance et résolution, mais beaucoup ont fait preuve à cette occasion d'une intelligence de leurs marchés, de leurs clients et des situations particulières des uns et des autres de loin supérieure à celle des politiques et des dirigeants d'organisations internationales, oscillant en permanence entre la rage de n'y pouvoir rien et l'obligation de crier plus fort que la tempête. C'est un autre paradoxe ; la solidité financière de maintes entreprises est désormais meilleure que celle de beaucoup d'États. Non sans raison. Les bévues à l'origine de la crise, des facilités données aux banques pour financer l'acquisition de logements par des ménages qui n'avaient aucune chance de les payer à la confusion de l'agence bancaire et de la salle des marchés autorisée par l'abolition du Glass-Steagall Act (par l'administration Clinton, en 1999), sont le fait de l'État fédéral américain, pas des entreprises. De futurs effets de ruine sont à attendre de l'inflation de l'assistance en Europe, sommée d'assurer l'ordre que les frontières n'assurent plus. Et la vérité dérangeante est que maintes entreprises entretiennent un rapport avec le réel plus étroit que les élus, les administrations et les autorités de régulation. La proximité avec ici et maintenant, comment les hommes vivent, ce qu'ils désirent et ce qu'ils veulent, a déserté des pseudo démocraties ravagées par la pensée correcte, le conformisme des débats et la censure des opinions ; l'entreprise qui vit de ses clients est obligée de les entendre, de les connaître et de les comprendre. Les choix décentralisés du marché contre la planification centralisée des sachants et des bien-pensants ; vieux débat toujours renaissant !Interrogation enfin sur le régime économique futur, au nom du retour redouté ou salué du politique. Mais qui croit que l'État était parti, avec plus de 50 % d'argent public dans l'économie ? La question est celle du rapport entre des sociétés humaines singulières et des marchés mondiaux décloisonnés, des acteurs bancaires qui ne connaissent aucune limite à leurs engagements et à leurs opérations et le rêve planétaire de l'idéologie libre-échangiste, développementaliste et universaliste ? le rêve d'un monde unique d'hommes uniques dans un système unique. Poser cette question, c'est découvrir que les sociétés humaines ne sont pas libres quand la banque l'est ? et que libéralisme de la finance et démocratie divorcent. C'est s'interroger sur la maladie de l'action occidentale et ses leçons trop bien suivies par des pays comme la Chine, dont l'accession à la puissance et l'appétit de ressources sont l'arrière-plan durable de la crise. Et c'est découvrir que les limites, les frontières et les séparations sont le sujet politique qui vient. La crise est crise du trop peu de liberté des acteurs économiques à s'organiser comme ils le veulent, hors de la Bourse et de la conformité, crise de l'incapacité de tant de dirigeants à penser autrement qu'en prix de marché et ROE, crise de notre difficulté à penser hors des normes, de l'uniforme et de la méthode, qui ne donnent jamais le sens. La crise est aussi le fait du rêve apocalyptique d'un monde banalisé par les prix, la règle et le contrat ; l'insurrection de l'écart et de la différence est devant nous. n (*) Hervé Juvin publie le 15 septembre le rapport « Bienvenue dans la crise du monde - Nouveaux paradigmes de la croissance II ».point de vue HervÉ Juvin Président d'Eurogroup Institute (*)
Après la crise ? rien de nouveau !
-
Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.

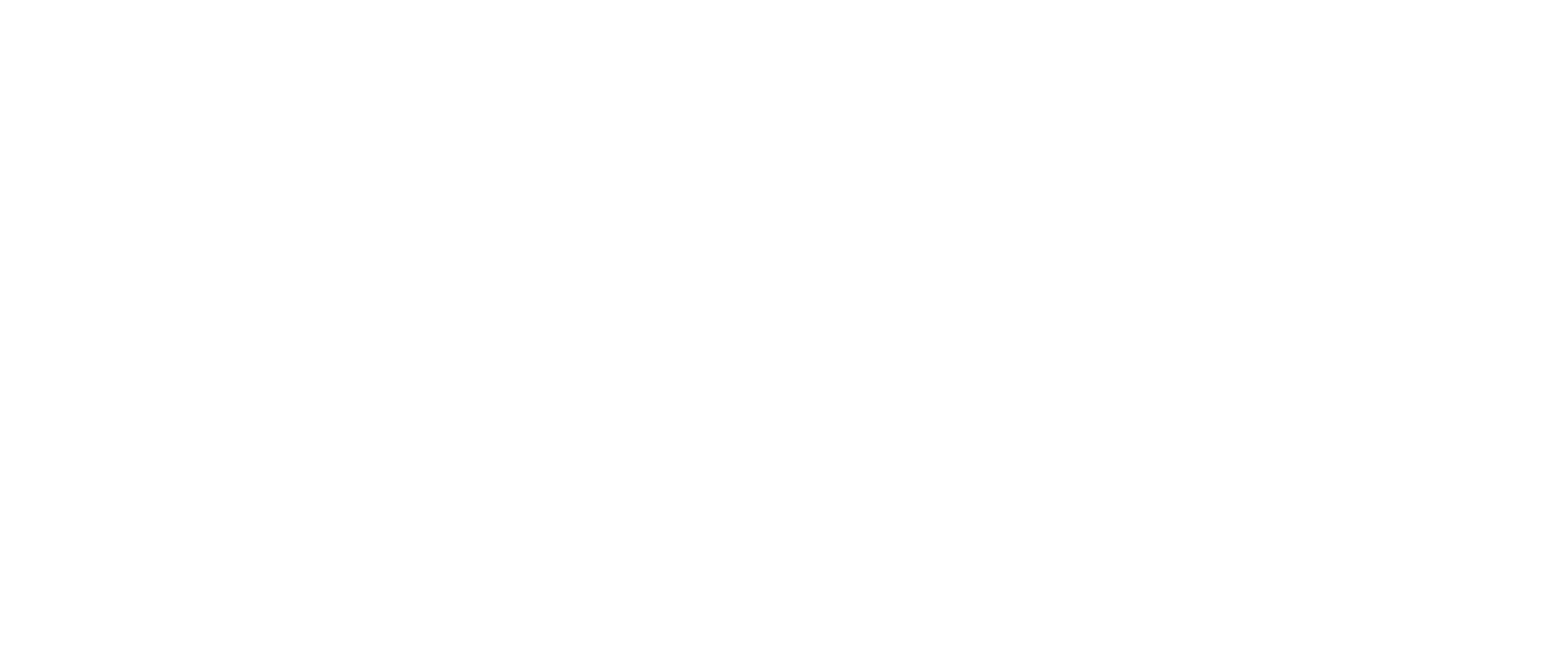


Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !