Nicolas Sarkozy souhaite que d'ici à 2012 les hôpitaux publics ne soient plus déficitaires. Est-ce tenable ?Jean-Marie Le Guen : Non, mais c'est un indicateur fictif : le budget des hôpitaux est aujourd'hui contraint. L'enveloppe globale dont ils bénéficient, et donc le déficit qu'ils peuvent générer, n'est pas liée à leur gestion économique. Les tarifications des missions d'intérêt général sont forfaitisées. Elles n'évoluent pas en fonction des coûts réels, mais en fonction des décisions budgétaires. Par ailleurs les capacités d'ajustement de l'hôpital public sont quasiment nulles puisque les emplois et le coût des produits de soins sont indépendants du pouvoir des prescripteurs et des managers. Il faut considérer les dépenses des hôpitaux de façon globale, en intégrant public et privé. L'un comme l'autre dépendant de la situation de la médecine ambulatoire. Si cette dernière prenait en charge davantage de malades et désengorgeait la structure hospitalière, tout irait beaucoup mieux. Jean-Loup Durousset : Le président de la République a posé une bonne question, mais il n'a pas apporté de réponse. C'est un peu dommage. Les pertes d'exploitation de l'hôpital public atteignent 800 millions d'euros. L'État, propriétaire de ces établissements, qui ne sont pas tous déficitaires, demande à l'assurance-maladie de combler les déficits d'exploitation. Cela a des conséquences dramatiques. D'abord pour les établissements qui marchent bien, puisque l'argent utilisé pour combler les déficits, c'est autant de ressources en moins pour eux. Deuxième point : est-ce à l'assurance-maladie de financer les déficits ? Quand un hôpital privé perd de l'argent, ce sont ses actionnaires qui mettent au pot. Pourquoi l'État n'en ferait-il pas autant ? Troisième point : les hôpitaux privés se sont restructurés. Pas par plaisir mais sous la pression économique. Cinq cents établissements privés ont disparu. Cela a été salutaire : aujourd'hui, on est plus beau qu'on ne l'était hier. Cela n'a pas été le cas pour l'hôpital public, sous prétexte, entre autres, d'assurer le maintien d'une présence sur l'ensemble du territoire. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement supprimer des hôpitaux, mais il faut redéfinir les objectifs qui leur sont assignés. Ce débat n'a pas eu lieu. C'est regrettable. J.-M. L. G. : Nous ne soignons pas exactement les mêmes pathologies que le privé. Et pas exactement les mêmes malades. Il y a, sur ce point, des différences y compris entre hôpitaux publics. À l'AP, nous soignons 700 à 800 différents types de pathologies. Dans les CHU, c'est 500 et les cliniques privées tournent aux alentours de 80. L'organisation du processus de soins n'est pas le même. C'est vrai que de nombreux hôpitaux privés utilisent de façon plus efficace leur bloc opératoire ou leurs appareils de radiologie, mais cela s'explique facilement. Pour atteindre cet objectif, il faut avoir certaines compétences et sans doute un attrait qui sont moins répandus dans le public. Mais je suis favorable à un autre modèle économique : la délégation de service public. Avec des frontières mouvantes. Certains actes jugés aujourd'hui très innovants pourront très bien, demain, parce que devenus plus banals, être assumés de façon plus importante par le secteur privé. C'est le cas de la maternité, de la chirurgie ambulatoire de réparation, de la prothèse de hanche, etc. Dès lors qu'une forme d'industrialisation est possible, je ne suis pas choqué qu'on confie davantage d'actes au privé à travers une délégation de service public. J.-L. D. : Il y a un millier d'établissements publics dont la palette d'activités, notamment en chirurgie, est inférieure à celle des cliniques privées. J.-M. L. G. : Je suis d'accord, mais vous m'accorderez que le gros du déficit n'est pas chez eux mais dans les gros CHU. J.-L. D. : Il y a sans doute aussi trop de CHU. Une trentaine suffirait. J.-M. L. G. : Je suis d'accord. J.-L. D. : Dans les années 1980, les cliniques privées ont fortement développé la chirurgie ambulatoire pour opérer les gens dans la journée. On a pour cela regroupé des services de chirurgie. Cela nous permet dans une même journée de soigner un malade qui vient pour une arthroscopie du genou, un malade qui vient se faire soigner et un autre atteint de cataracte. Cela nous a permis d'optimiser les coûts en dégageant des gains de productivité. Cela nous a permis de financer les pathologies plus lourdes. L'hôpital public peine à mettre cette stratégie en oeuvre. Et ce qui est fait aujourd'hui - le regroupement au sein des services, une activité ambulatoire - ne génère aucun gain de productivité. Mieux vaudrait par exemple pour l'AP-HP créer un centre de chirurgie ambulatoire où l'on pourrait tout traiter.J.-M. L. G. : C'est exact et très intéressant. La médecine hospitalo-universitaire française a longtemps été réticente à la chirurgie ambulatoire. Cette réalité a été contournée par le secteur privé qui a vu dans la chirurgie ambulatoire une réponse mieux adaptée à la demande des patients. Cela correspondait aussi à une époque où il y avait une cassure entre l'intendance et les soins, qui depuis les années 2000 n'est plus de mise. Aujourd'hui, on va dans votre sens et même encore plus loin. Pour traiter un cancer par exemple, dans les centres intégrés, nous mettons autour des patients tous les professionnels nécessaires au traitement de son cancer mais aussi des pathologies qui y sont associées. [...] Ce qui manque aujourd'hui ce sont ce qu'on pourrait appeler des polycliniques. Des lieux qui pourraient recevoir les patients 18 heures sur 24 heures. Le public est le plus mal placé pour proposer cela. Les médecins pourraient s'organiser pour le faire mais c'est compliqué pour eux. Alors les assurances privées ? Elles peuvent y contribuer. Mais les mieux placés sont sans aucun doute les hôpitaux privés. Je n'exclus pas des partenariats public-privé sur le sujet non plus. J.-L. D. : Nous ne sommes fermés à rien. Le principe du privé, c'est d'être innovant. Rassembler dans des maisons médicales plusieurs spécialistes ou plusieurs médecins de la même spécialité, c'est une idée à laquelle nous souscrivons depuis longtemps. On a aussi des réponses à apporter en termes de proximité. On pourrait par exemple imaginer des permanences circulantes en zone rurale. Cela pourrait notamment s'appliquer pour les opérations de cataracte, qui pourraient être réalisées le lundi dans telle ville, le mardi dans une autre, etc. J.-M. L. G. : Mais qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui ? La réglementation ? J.-L. D. : Oui en partie. J.-M. L. G. : Je suis, moi, pour une très grande déréglementation et pour une contractualisation. Les formes d'organisation des professions devraient être largement déréglementées.Vos camarades au PS sont d'accord avec vous sur ce point ?J.-M. L. G. : Oui... Ce n'est pas un sujet que nous abordons souvent, mais je n'ai aucun doute sur le fait que je serai suivi.
jean-marie le guen face à Jean-Loup duroussetLe président du...
-
Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.

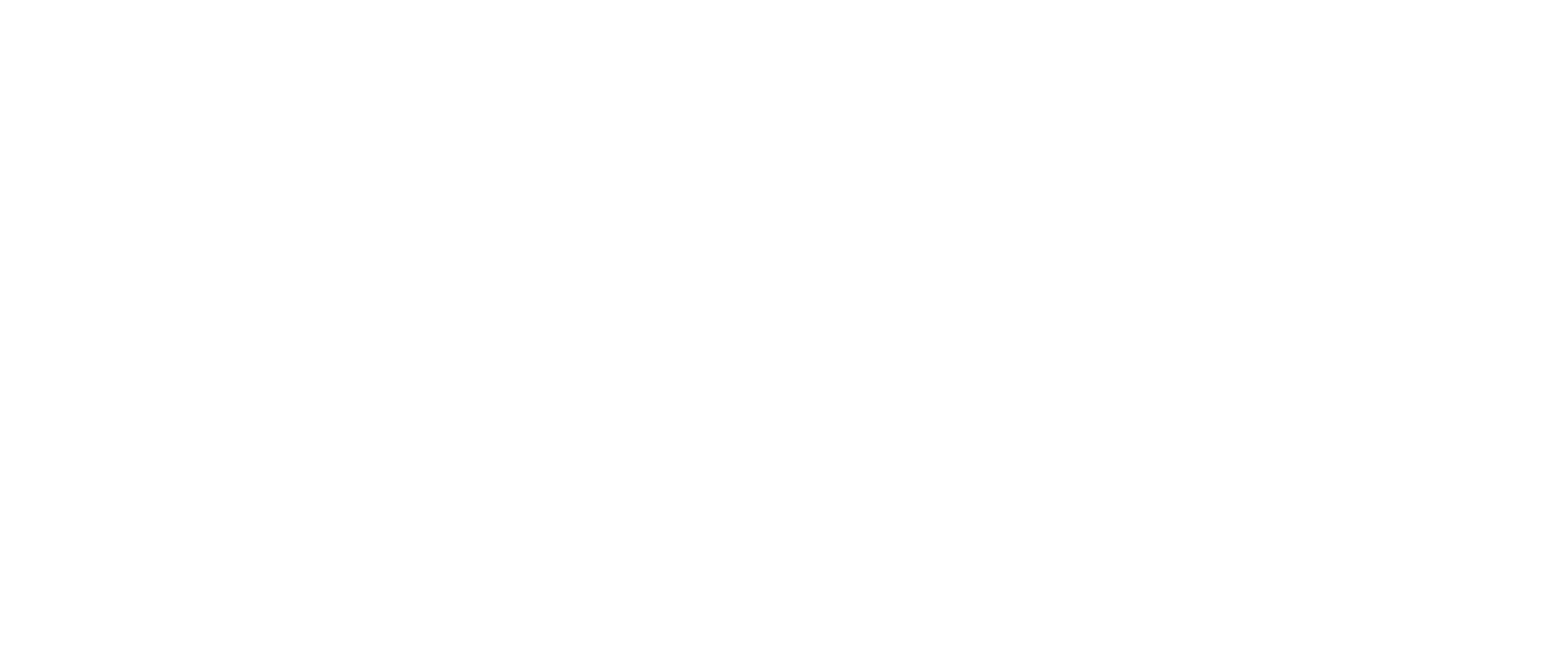


Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !