
Flamme incandescente, flegme olympien... Nikos est l'incarnation de cette phrase de Coubertin : « L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. » Un combat qu'il a dû mener depuis sa naissance pour survivre. Journaliste à 20 ans, il fait ses preuves en présentant le JT de 20 heures sur la chaîne grecque Alter et enchaîne les postes de correspondant à la radio et pour la presse écrite françaises. Jusqu'à l'appel de TF1 au début des années 2000 qui bousculera sa vie professionnelle. De l'information à l'animation : il n'était pas préparé à ce tourbillon médiatique. Si Nikos ne fait pas de vagues depuis plus de deux décennies dans la lucarne, c'est parce qu'il est passé au travers de la notoriété soudaine, avec comme seul objectif ne pas perdre de vue l'enfant de 6 ans qu'il a été, fils d'immigrés grecs qui n'ont jamais vécu dans la tragédie. La découverte de la photographie est sa meilleure thérapie pour s'échapper de cette lumière oppressante. Comme la chouette, son oiseau fétiche, son regard tourne à 180 degrés pour chasser l'âme en solitaire. Alors un tête-à-tête sur le Vieux-Port de Marseille à quelques heures de l'arrivée de la flamme olympique, c'est un peu comme être dans les secrets des dieux...
LA TRIBUNE DIMANCHE - À qui avez-vous envie de déclarer votre flamme ?
NIKOS ALIAGAS - À la photographie, parce qu'elle a été comme une thérapie pour moi. Elle m'a aidé à trouver une cohérence, à m'aligner avec moi-même derrière l'objectif. Ce n'est pas naturel d'être la plupart du temps sous les feux de la rampe de la télévision, il faut donc garder la bonne distance. Comme pour une photo : si tu es trop près, tu ne vois rien ; si tu es trop loin, tu ne vois rien non plus.
Aujourd'hui, vous êtes en accord avec vous-même ?
Disons que je ne suis probablement pas devenu quelqu'un que je n'aurais pas voulu être. Mais pour ça, j'ai dû et je dois beaucoup travailler sur moi-même. Même encore maintenant, à 55 ans.
Qu'est-ce qui vous émeut ?
Le regard de mes enfants quand ils me disent « je t'aime » avant d'aller à l'école. Ce regard me nourrit tellement que j'ai l'impression d'avoir des ailes qui poussent.
Vous avez beaucoup photographié les mains de votre père. Que vous évoquaient-elles ?
Seules les mains disent la vérité. Elles montrent ce que nous sommes au-delà du masque social. Mon père avait celles de l'artisan, d'un tailleur qui a quitté son pays en 1964 pour trouver une vie meilleure en France. Les mains du labeur.
Vous n'avez manqué de rien ?
J'ai grandi dans un petit appartement sans jamais me sentir pauvre, car il y avait beaucoup d'amour et de culture. Mes parents ne se sont jamais plaints. J'ai la chance d'avoir hérité de cette force de caractère. Peut-être parce que j'ai dû me battre depuis le premier jour.
Physiquement ?
Je suis né avec des problèmes de santé. On m'a opéré sept jours après ma naissance et j'ai dû m'accrocher à la vie pour survivre. Mais c'est vers l'âge de 6 ans que j'ai passé le cap de cette « douleur ».
Quel a été le déclic ?
Monter sur scène pour lire un poème le jour de la fête nationale grecque. Une fois que j'ai pris le micro, les gens se sont arrêtés de parler pour m'écouter. J'ai compris à cet instant précis que je pouvais maîtriser mes propres peurs, mes doutes et mes bobos avec un micro à la main. Je décidais enfin de ne plus être cet enfant fragile qui ne pouvait pas courir aussi vite que ses camarades à cause de son opération.
À l'école, vous vous sentiez stigmatisé ?
C'est arrivé, comme pour beaucoup d'enfants d'immigrés de l'époque. À la maison, on parlait surtout grec. J'ai découvert le français à l'école maternelle, dans le 10ᵉ arrondissement de Paris. Au début, je ne comprenais pas bien la langue. Et j'étais pétrifié au point de ne pas oser demander d'aller aux toilettes. Pour l'anecdote, cette école maternelle est maintenant mon bureau de vote. [Rires.] Mais de manière générale, je n'ai jamais accepté d'être un souffre-douleur, même quand je devais entendre des vannes pas très élégantes sur les Grecs. Je savais qui j'étais et ça ne me touchait pas.
Nikos en 2000 et Nikos en 2024, quel changement physique !
J'avais grossi à cette époque-là, car je menais une vie plus décousue. Je voyageais énormément entre Paris et Athènes et je mangeais mal et tard. Depuis la naissance d'Andréas, il y a bientôt sept ans, je me suis calé sur le rythme des enfants. Je ne bois quasiment que de l'eau, j'ai arrêté les déjeuners de boulot et je nage quarante minutes tous les jours.
La mère de vos enfants doit aussi y être pour quelque chose...
Sûrement. Elle reste aussi dans l'ombre nécessaire à notre équilibre, loin des projecteurs de mon travail. J'ai beaucoup de gratitude et d'admiration à son égard, au-delà de ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Il faut garder précieusement un espace intime pour sa famille.
Que vous dit Nikos dans le miroir ?
« Tu as fait ce que tu as pu, ça va. » [Silence.] Vous avez entendu le chardonneret en train de chanter dans l'arbre ? C'est l'oiseau que mon grand-père m'a appris à reconnaître dans les champs d'oliviers, quand il me lisait Homère l'été en Grèce. Alors que je grignote avec vous une tarte au citron sur le Vieux-Port de Marseille, mon père et mon grand-père me font des signes...
On vous sent très nostalgique.
J'ai hérité de la nostalgie de mon père et du retour impossible dans sa patrie de naissance. Ça s'appelle le « nostos », un mot homérique de L'Odyssée qui exprime cet état de manque permanent. Je suis pourtant né en France, mais j'ai toujours ressenti la possibilité d'un ailleurs. La France me manque quand je suis en Grèce et inversement. Quand j'entends parler grec, c'est la mémoire amniotique qui me provoque une émotion forte. Elle me relie au ventre de ma mère. C'est une des raisons pour laquelle je tenais absolument à rendre hommage à mes parents, il y a quelques jours, en portant la flamme olympique dans leur ville d'origine, à Missolonghi. Ville qui fut rasée par l'Empire ottoman il y a presque deux cents ans. Et je voulais aussi transmettre la flamme à mon pote d'enfance, Kosta. Comme pour célébrer une amitié de cinquante ans.
C'est comment, le dimanche de Nikos ?
Toujours simple. Sport avec les enfants, déjeuner avec ma sœur ou ma mère qui prépare ses spanakopitas de dingue. Ne vous attendez surtout pas à ce que je vous dise que je cuisine toute la matinée, car j'ai la flemme. [Rires.] Un lendemain de prime, le maximum que je puisse faire, c'est des œufs durs.
En grand lecteur, il dévore les livres sans modération. Surtout le dernier de Philippe Sollers, La Deuxième Vie, et Le Murmure de Christian Bobin. « C'est intéressant, le rapport qu'ils avaient à la mort, parce qu'ils souffraient physiquement. » Quand il est question d'un bon coup de fourchette, c'est chez Les Diamantaires qu'il emmène sa famille pour déguster des plats gréco-arméniens « C'est un rituel que je partageais déjà avec mes parents. » * Les Diamantaires, 60, rue La Fayette (Paris 9ᵉ).Coups de cœur
Son site photo, ouvert à partir de demain : nikosaliagasphotos.com

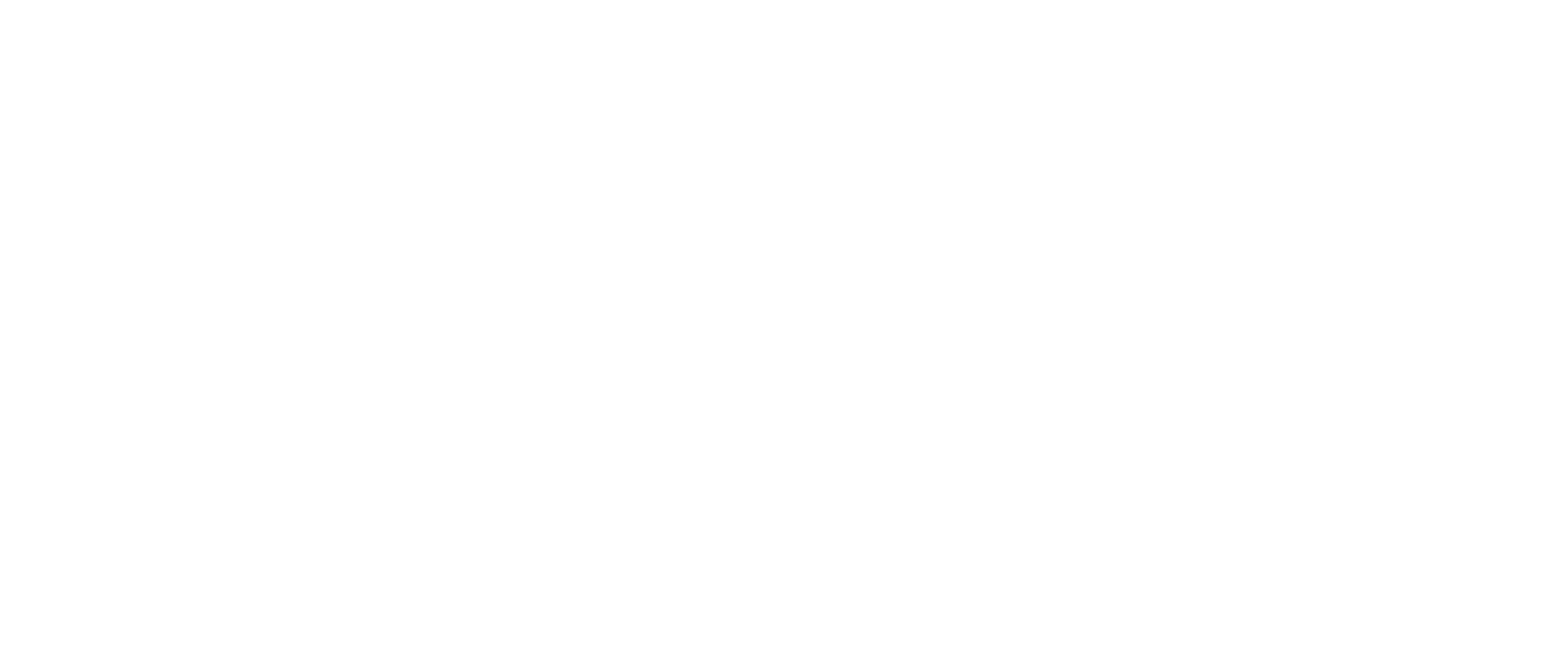
 Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français
Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français

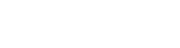
Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !