
Comment s'éteint une étoile
Rudolf Noureev raconté par celui qui fut son médecin et ami et qui l'accompagna pendant les dix dernières années de sa vie. Un très beau témoignage.
À la fin de sa vie, réfugié dans son sombre et somptueux appartement parisien, alors que le sida grignotait ses dernières forces, Rudolf Noureev, pour traverser la nuit, regardait en boucle sur de vieilles cassettes VHS les chorégraphies des ballets avec Margot Fonteyn qui avaient fait naître sa gloire trente ans auparavant. Ainsi parfois meurent, dans la mélancolie, les fauves et les archanges.
Cette histoire est l'une des plus belles parmi les nombreuses, tristes souvent, joyeuses aussi parfois, qui traversent le beau livre de Michel Canesi Le Crépuscule d'un dieu. Médecin, homosexuel - il ne s'en cache pas sans en faire jamais un quelconque étendard -, Canesi accompagna nombre de patients aux moments les plus terribles de la pandémie, lorsque celle-ci ne s'accompagnait que d'ignorance et de peur, avant l'arrivée des trithérapies.
Faune sublime
Passionné de danse, il rencontra Noureev alors que celui-ci venait d'être nommé à la tête du Ballet de l'Opéra de Paris. Il aurait pu n'être qu'un des nombreux amants de passage du danseur, qui en faisait grande consommation. Ce ne fut pas le cas. Il fut doublement mieux et plus. Son médecin d'abord, tout au long des dix dernières années de la vie de la star - car c'en était une, mondiale même, à la fois personnage viscontien et faune sublime tel que la danse n'en avait pas connu depuis Nijinski. Et aussi, et surtout, l'ami - bienveillant et attentif, notamment à ne pas pouvoir être confondu avec la foule exaspérante de ses admirateurs - de celui qui, sans doute parce qu'il savait qu'il mourrait jeune, fut vivant avec une intensité fulgurante.
Passent en ces pages Maurice Béjart, Sylvie Guillem, Jack Lang, Jackie Kennedy, Colum McCann. Du beau monde, mais ce qui reste, c'est la solitude. Courageux, fidèle, excessif, le Noureev de Canesi est loin de l'étoile capricieuse que la mémoire collective a voulu retenir. Son ami nous le rend. (Olivier Mony)
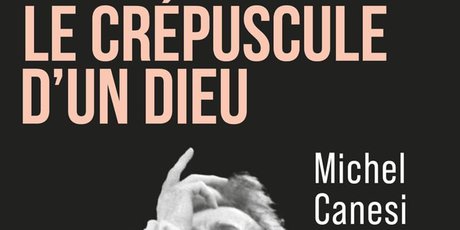
Le crépuscule d'un dieu, Michel Canesi, Plon, 256 pages, 22 euros. (Crédits : © LTD / Plon)
D'Artagnan, Emma Bovary, Julien Sorel et nous...
Christophe Hardy sort nos personnages préférés de leurs mausolées de papier.
Ouf ! On le sait à présent, notre tendresse pour Julien Sorel est tout à fait justifiée. En revanche, non, Emma Bovary n'était pas vraiment lui (Flaubert) ! Et, oui, d'Artagnan a existé mais ne ressemblait pas tout à fait à celui de Dumas. En redonnant vie, voire des vies, à cinq de nos icônes de papier, l'écrivain Christophe Hardy les rend... plus romanesques encore ! Prenez le panache de d'Artagnan. Quand des peuples n'en finissent pas d'inventer des super-héros dotés de supersuperpouvoirs, nous, nous continuons à glorifier ce mousquetaire qui nourrit « une attitude très française de se rêver, de se projeter en héros invincible, rebelle et justicier, non sans une certaine vanité ou une dose de naïveté qui perpétue l'esprit de l'enfance ». Le Gascon montant à Paris pour intégrer le corps des mousquetaires dirigé par le comte de Tréville a existé : il s'appelait Charles de Batz de Castelmore. Sa vie a été romancée par un autre mousquetaire de trente ans son cadet, Gatien de Courtilz de Sandras, qui rédigea Les Mémoires de M. d'Artagnan, dont Dumas s'empara pour en faire une autre fiction. Sans doute fallait-il au moins une vie et deux romanciers pour façonner le destin d'un tel héros...
« Transfuge de classe »
Julien Sorel, symbole de l'ambition, est-il, lui, un héros ou un antihéros ? Le jeune homme au destin brisé de Stendhal est surtout l'incarnation de ceux qui se révoltent contre les époques dénuées de souffle. « Que faire de son audace, de son héroïsme, en un temps qui ne le valorise pas, ne le valorise plus ? En un autre, plus faste pour la bravoure, le héros du Rouge et le Noir aurait conquis ses titres de gloire sur les champs de bataille. Son temps est autre. Il doit composer avec lui », écrit Christophe Hardy. Voilà pourquoi Julien Sorel, qu'on l'aime ou le déteste, nous touche aussi fort. « Transfuge de classe », comme on dit aujourd'hui. Mais, contrairement à « ceux qui écrivent aujourd'hui leur honte ou le malaise ressenti à avoir abandonné leur milieu d'origine, [Sorel] est surtout celui qui use du mépris comme d'une arme et le retourne contre les autres ». En sortant de leurs mausolées les héros de nos grands romans, Christophe Hardy nous offre un voyage réjouissant au cœur de notre imaginaire collectif. (Aurélie Marcireau)
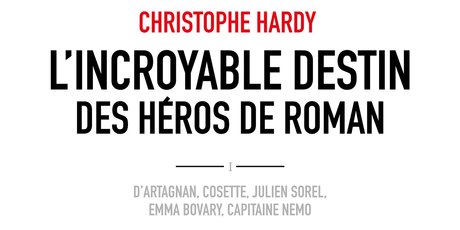
L'incroyable destin des héros de roman, Christophe Hardy, Novice, 352 pages, 19,90 euros. (© LTD / Novice)
L'Atlantide adolescente
Mensonges et trahisons chez les collégiennes du San Francisco des années 1980.
Nous sommes en 1983, à San Francisco, dans le quartier huppé de Sea Cliff, avant l'arrivée des grandes fortunes de la Silicon Valley. Une narratrice de 13 ans, Eulabee, nous présente ses trois meilleures copines, avec lesquelles elle défie les marées, monte de cruels canulars téléphoniques, et parle de tout. Mais cette belle amitié vole en éclats dès les premières pages quand, un jour, un homme en voiture leur demande l'heure - enfin, c'est la version de la narratrice. Pour les autres, il s'est exhibé et leur a fait des avances. Or les autres, c'est surtout Maria Fabiola, que les garçons surnomment « Maria fabuleuse » : fabuleusement belle, en effet, et fabuleusement mythomane... Pour n'avoir pas voulu confirmer l'exhibition, voilà Eulabee ostracisée. Puis Maria Fabiola disparaît. Et réapparaît avec une histoire d'enlèvement rocambolesque qui ressemble à l'intrigue d'un classique de Stevenson, et un contrat d'exclusivité pour la télévision...

Vendela Vida. (© LTD / Lily Peper)
Avec une telle intrigue, Dompter les vagues aurait pu donner lieu à un roman clinquant, convenu, ou édifiant - quand la folie des médias rencontre le mal-être adolescent -, mais c'est tout le contraire. Comme Pagnol ou Dickens, Vendela Vida sait faire parler la très jeune fille qu'elle était autrefois. Elle décrit avec une grande sensibilité ces adolescentes parfois tentées de laisser courir leur langue pour le plaisir de se déclarer sœurs adoptives, ou d'écrire de fausses cartes de vœux pour semer la zizanie parmi leurs profs.
Épilogue sidérant
Et on suit avec bonheur son Eulabee dans le San Francisco d'il y a quarante ans, qu'il s'agisse du foyer équilibré formé par ses parents, de la galerie magique de son père antiquaire, du collège pour jeunes filles Spragg et de son prof de littérature idiot, de la communauté des expatriés suédois ou des soirées pendant lesquelles des garçons plus âgés la font boire et des expériences qui s'ensuivent. Plus loin, il y aura un nouveau retournement de situation, un grand coup de suspense, et surtout un épilogue sidérant : la vérité sur Maria Fabiola. L'ensemble nous dit que l'adolescence est une Atlantide, et que c'est particulièrement vrai quand on a grandi à San Francisco, méconnaissable depuis que les hautes technologies l'ont élu pour capitale. Pour le reste, guérit-on jamais de cet âge-là ? Peut-être faut-il attendre la cinquantaine pour le savoir. (Alexis Brocas)
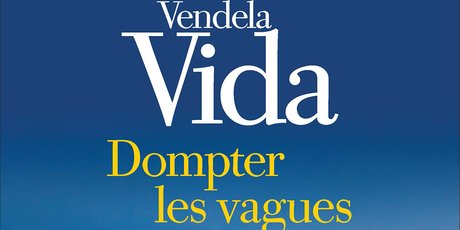
Dompter les vagues, Vendela Vida, traduit de l'anglais (États-Unis) par Marguerite Capelle, Albin Michel, 290 pages, 21,90 euros. (© LTD / Albin Michel)
Le livre à relire
La Bonne Moitié de Romain Gary
Il en va de l'histoire comme des paysages : plus on s'en éloigne, moins on en discerne les nuances et les détails. Heureusement, toute une littérature est là pour nous les rappeler. Telle La Bonne Moitié, pièce oubliée de Romain Gary sur l'après-guerre et l'épuration, ressortie par Folio, qui fouaille sans pitié dans nos ambiguïtés nationales - autant dire là où ça fait mal. D'autant plus mal qu'elle est l'œuvre d'un homme on ne peut plus clair dans ses engagements, membre des Forces françaises libres dès 1940. Mais Gary était aussi cet écrivain capable de porter tous les masques, celui de l'ami, celui de l'ennemi, et de les fondre soudain dans un tour de magie pour nous montrer le visage de la France occupée, à moins qu'il ne s'agisse de celui de l'humanité de toujours.
Nous voilà donc après guerre, auprès d'une bande d'adolescents - des enfants de résistants dont les parents ont été massacrés par les Allemands. Leur guide, Vanderputte, cherche à les faire passer en Espagne pour fuir une Gestapo qui n'existe plus. Un héros devenu fou ? Plutôt une grinçante allégorie. Car bientôt on apprend que, pour survivre, ce vieil homme terrifié a servi les nazis autant que la Résistance. Lui assure que le compte est positif : « Pour une vingtaine que j'ai livrés, j'en ai sauvé trente! » Ses protégés hésitent : faut-il le gracier au nom de sa bonne moitié ? Ou bien le fusilier, entièrement ou partiellement ? Bref, comment juger de la créature humaine dont la guerre vient de révéler la nature hautement composite ? Sacré Romain Gary... Sa pièce n'est pas parfaite : comme Flaubert, le roman sied mieux à son génie. Mais sa façon sarcastique de rallier les explications inventées pour penser la collaboration sans se salir l'esprit force l'admiration. « C'est l'histoire qui veut ça ! C'est toujours elle qui me cherche ! » plaide Vanderputte avant d'invoquer la fameuse camaraderie : « J'avais des frères, des frères... des deux cotés. Les plus beaux jours de ma vie. » Gary, bien sûr, n'y croit pas : pour lui, l'ambiguïté est câblée dans la nature humaine même, et ses adolescents qui se veulent juges l'apprendront à leurs dépens. (Alexis Brocas)
La Bonne Moitié, de Romain Gary, Folio, 240 pages, 8,90 euros.

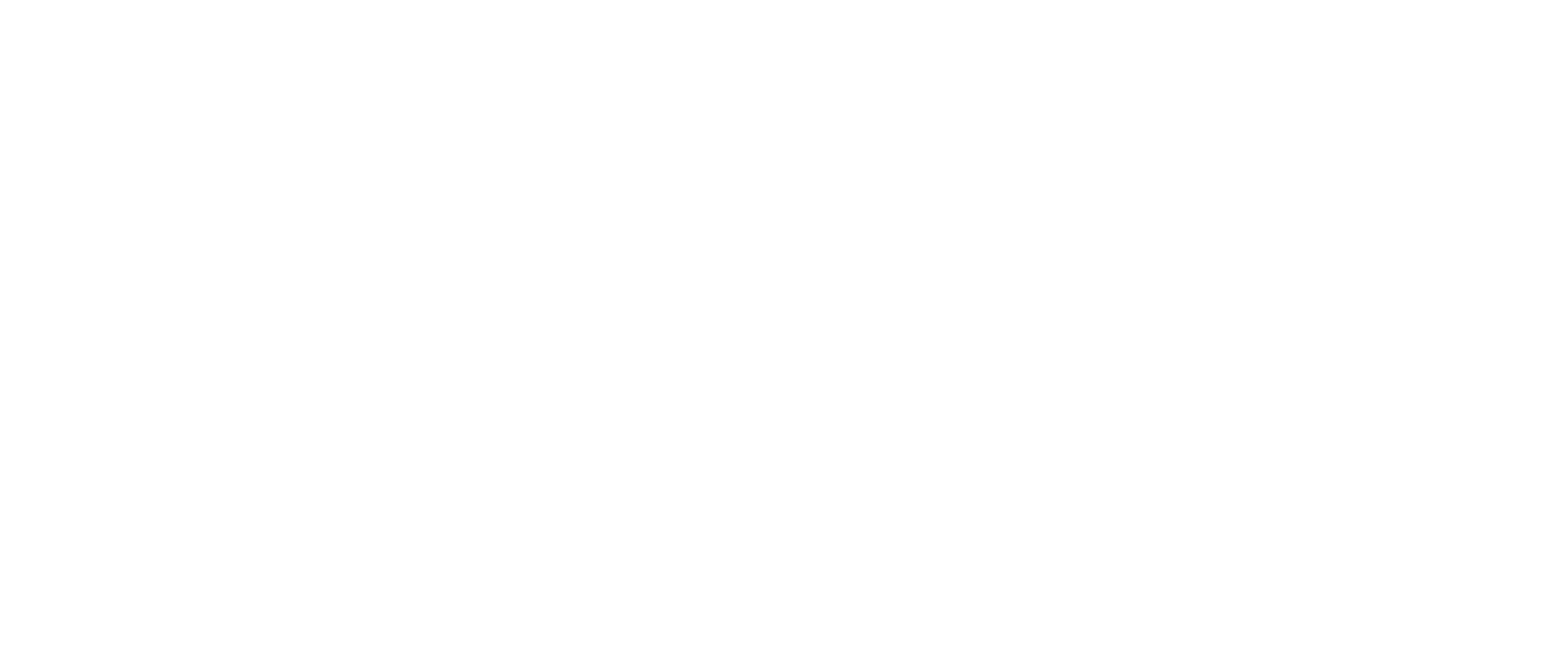
 Dissolution : la France est attaquée sur les marchés financiers
Dissolution : la France est attaquée sur les marchés financiers

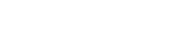
Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !