
La Suisse est un pays neutre, dit-on ; pas totalement. Le MEG, le musée d'Ethnographie de Genève, est loin de l'être. Ce jeune musée perturbe par les questions qu'il pose, qu'il se pose. Exposer des œuvres issues de pays colonisés, exploités, volés, sans le raconter, est-ce être fossoyeur de l'Histoire ? Rendre des œuvres, mais à quelles conditions ? Qui étaient les Suisses (Genevois) « honorables » qui ont déshonoré la condition humaine, participant directement ou indirectement au colonialisme, donc à l'esclavage, donc en étant racistes ? Ces questions articulent l'exposition qui célèbre les 10 ans de ce musée libre et courageux.
Pourquoi une exposition consacrée à « Genève dans le monde colonial » alors que la confédération, née en 1291, n'a jamais été un empire, n'a jamais eu de colonies, comme c'est étrange. Sauf que, du XVIe au XIXe siècle, hommes d'a aires et banques ont (grandement) bénéficié de la traite négrière. Des banques suisses ont possédé jusqu'à un tiers des actions de la Compagnie des Indes, société française qui disposait d'un monopole dans le commerce d'esclaves en Afrique de l'Ouest. Des maisons de négoce suisses ont financé ou commercé avec des entreprises esclavagistes. Le si délicieux chocolat a rapporté gros grâce au commerce de la fève et de ceux qui la ramassaient. Nombre d'affairistes suisses et missionnaires ont rapporté des objets venus du monde entier. Ces derniers composent la collection du MEG.
Ces chefs-d'œuvre n'ont pas été créés pour faire joli
Le musée a proposé à des artistes contemporains d'appuyer là où ça fait mal. Le Camerounais Blick Bassy, par exemple, présente une collection de casques-calebasses « décoloniaux » dont un de « nettoyage mental ». Le porter chasserait toute idée néocolonialiste. Ce musée municipal ose présenter une carte de la ville indiquant ce qui se cache derrière certaines plaques de rue honorant les Suisses « respectables ». On découvre que le Genevois Henry Dunant, cofondateur en 1864 de la Croix-Rouge, travailla pour la Compagnie genevoise des colonies suisses, posséda des terres en Algérie et eut un projet de colonisation de la Palestine. « Pourquoi tu tousses ? » demandait Fernand Raynaud dans un sketch.
Le MEG et sa façade, composée de losanges en écho à ceux utilisés dans la vannerie philippine, détonne dans ce quartier branché de Genève qui ne manque pas de ressembler à un quartier... d'affaires. Pas très loin, dans la vieille ville, d'autres histoires de cultures des bouts du monde se tapissent dans les sous-sols d'un bel immeuble tranquille : le musée Barbier-Mueller.
Le vieux Genève se cramponne à une des collines de la ville depuis le XIIe siècle. Il
regorge de passages discrets, de rues pavées impeccables, de fontaines murmurantes, d'hôtels particuliers discrets et d'immeubles bien rangés. De l'un d'entre eux s'échappent d'étranges forces, celles des esprits. Les œuvres de la collection Barbier-Mueller (une des plus importantes au monde) hypnotisent par leur beauté, fascinent par la modernité de leur ligne et par leur force. Ces chefs-d'œuvre n'ont pas été créés par des artisans-créateurs pour faire joli mais pour charmer des forces invisibles, pour caresser les forces des esprits afin de leur demander de petits services comme leur assurer la protection des ancêtres ou celle de toutes sortes de dieux, maîtres d'innombrables croyances. Jean Paul Barbier-Mueller les connaissait toutes.
Le riche collectionneur était un voyageur cultivé. Le collectionneur et sa femme, Monique, sont morts. Au-delà de leur passage terrestre, le musée transmet leur flamme et perpétue leur intérêt pour les arts en général. En correspondance avec la collection sont exposées en ce moment des œuvres en verre du Genevois John Armleder, ami de la famille. En écho aux questions soulevées par le MEG se pose celle de l'acquisition des trésors du musée. Pas de troc, pas de vol, mais des milliers d'objets achetés par la famille dans des galeries et des ventes aux enchères. Ouf !

Fondation de l'Hermitage, à Lausanne. (Crédits © LTD / MATHILDA OLMI)
Tous les chemins (de fer) conduisent à Lausanne. Partir en train de Genève. Longer, côté suisse, le plus grand lac d'Europe occidentale. Admirer l'autre rive, les Alpes viriles françaises qui trempent leurs pieds dans l'eau fraîche du lac. Arriver à la gare de Lausanne. Embarquer immédiatement pour trois musées construits en lisière de quai. Concept habile et efficace. Rendre la culture accessible au plus grand nombre, la cité vaudoise est sur la bonne voie pour y parvenir. En bout de gare, trois musées ultra-frais « se font des becs » (« s'embrassent » en Suisse). Musée de la photo (Photo Élysée), musée du design (Mudac), musée des beaux-arts (MCBA) sont rassemblés sous le nom de Plateforme 10. Pour voir Lausanne à Lausanne, le plus court chemin est le MCBA. Les créateurs suisses les plus illustres, de Félix Vallotton à Ferdinand Hodler, y font salles communes.
Une pièce fait chavirer le visiteur
Le surréalisme ayant 100 ans, Plateforme 10 souffle les bougies. À croquer : des photos de l'« autoportraitiseuse » Cindy Sherman ou celles du pionnier surréaliste Man Ray, des meubles et objets inutilisables (chaises, vases), les cygnes de Salvador Dalí dont les reflets dans l'eau sont des éléphants. Tout est alléchant et plutôt joyeux. Suivre les
rails depuis la gare et connaître l'extase.
Grimper au-delà de la cathédrale, arriver dans la campagne, très vite. Depuis une magnifique demeure du XIXe siècle aux murs rosés, contempler le lac, les montagnes, les toits de Lausanne et se sentir comme à la maison. Entrer dans la Fondation de l'Hermitage et avoir l'impression que les propriétaires se sont absentés en laissant quelques œuvres pour mots d'excuse. En l'occurrence, des tableaux de Nicolas de Staël, vus à Paris, mais présentés autrement. Au cœur de la demeure, une pièce fait chavirer le visiteur. Elle résume, honore la dernière année du maître, 1955. Face à face, une nature morte avec pinceaux, une femme bleue enrobée de rouge, et là, sur le mur qui empêche la vue sur le lac et ses mouettes joyeuses, d'autres mouettes, grises, noires, celles peintes par de Staël avant qu'il ne prenne son envol en se suicidant. Pour cette salle-là, il y a « le feu au lac ». L'exposition se termine bientôt. Jean-Luc Godard, Suisse des bords du lac, disait : « Le cinéma fabrique des souvenirs » ; ces musées-là aussi. À suivre...
Musée d'Ethnographie de Genève Musée Barbier-Mueller Plateforme 10 Fondation de l'HermitageÀ visiter
67, boulevard Carl-Vogt, 1205 Genève
Exposition « Genève dans le monde colonial » jusqu'au 5 janvier 2025
10, rue Jean-Calvin, 1204 Genève
Exposition « Transparents - John Armleder & le musée Barbier-Mueller », jusqu'au 5 janvier 2025
MCBA, Mudac, Photo Élysée
16-17, place de la Gare, 1003 Lausanne
2, route du Signal, 1018 Lausanne
Exposition Nicolas de Staël jusqu'au 9 juin

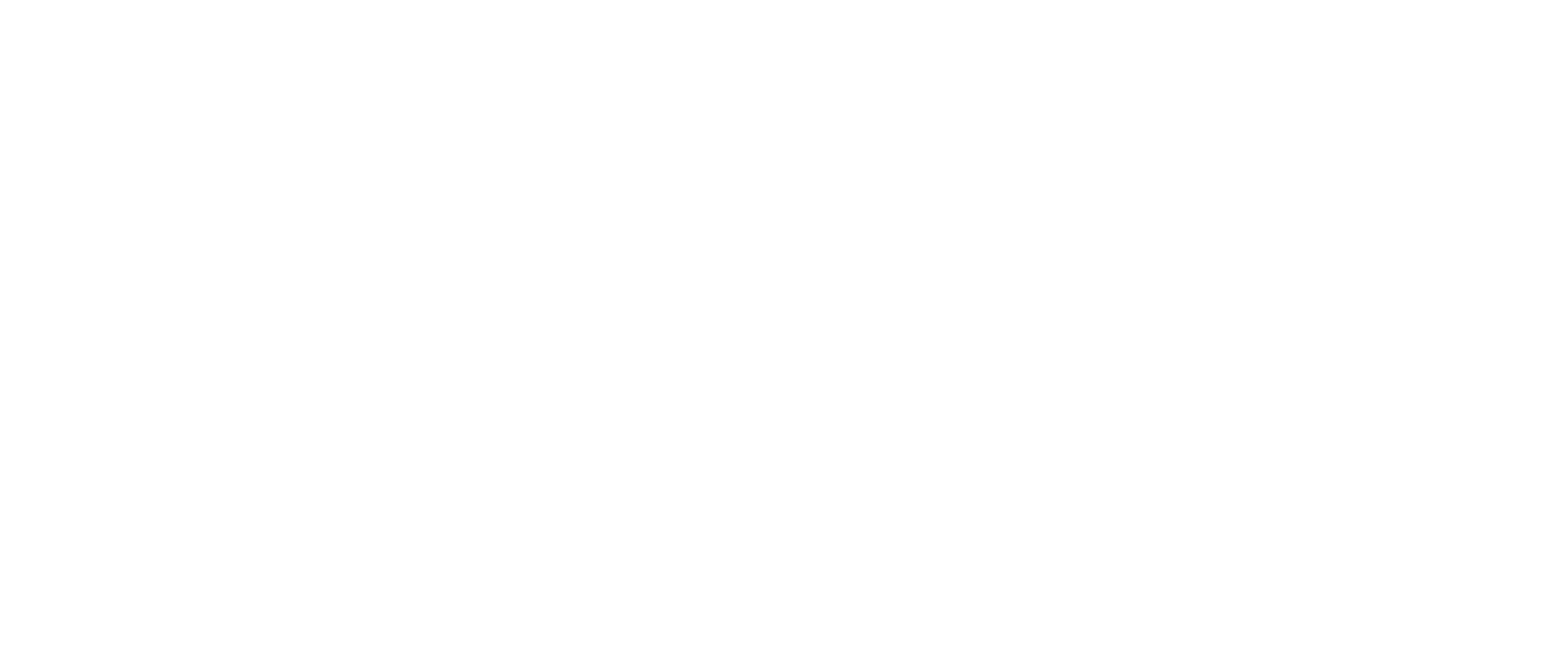
 Dissolution : la France est attaquée sur les marchés financiers
Dissolution : la France est attaquée sur les marchés financiers

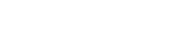
Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !