A priori, rien ne distingue Bay Street, à Toronto, de Wall Street. Mêmes canyons d'immeubles de verre, mêmes moquettes épaisses au QG des institutions bancaires, mêmes collections d'art dans les salons. Pourtant, les banquiers canadiens affichent leur différence. Même au plus fort de la crise financière, ils n'ont cessé de prospérer ! Et, à mesure que les banques américaines et européennes s'enfonçaient, les institutions canadiennes prenaient la tête des capitalisations boursières. Sur les dix plus grandes banques nord-américaines, on trouve aujourd'hui 40 % de maisons canadiennes. Fait inédit également, les banquiers canadiens ont vu leurs rivaux new-yorkais débarquer, penauds, pour leur demander de l'aide ! Pour l'heure, Bay Street se contente d'embaucher des professionnels de Wall Street par équipes entières? Tout cela aurait de quoi enivrer le Canada, d'autant qu'en octobre dernier le Forum économique mondial a qualifié son système bancaire de « plus sûr au monde » et que Paul Volcker, ancien président de la Réserve fédérale américaine et actuel conseiller de Barack Obama, l'a déclaré « modèle à suivre ». Eh bien non : les hommes de Toronto restent humbles. « C'est le pays des banquiers ?plats? », plaisante Louis Vachon, le PDG de la Banque Nationale du Canada, un établissement privé de Montréal. Prononcé « platts » au Québec, l'adjectif signifie ennuyeux. À Bay Street, on dit plutôt « conservative », pour illustrer cette volonté de « conserver » ce qu'on a. Soit, mais d'où vient cette mentalité ? Vues de Paris, les différences culturelles entre Canada et États-Unis semblent en effet bien minces. Canadiens et Américains partagent une même histoire, celle d'un pays conquis par des émigrants venus y chercher fortune, et prêts à prendre tous les risques? « Nous n'avons pas d'ego », explique en riant Ed Clark, le PDG de Toronto Dominion, l'une des principales banques du pays. Ce serait donc cela, la clé du succès ?En fait, le contexte dans lequel les banques canadiennes évoluent est bien différent de celui du voisin américain. La réglementation, fondée sur des principes acceptés par tous, y est appliquée par une seule autorité, tandis qu'aux États-Unis elle est fragmentée en plusieurs entités, rendant la surveillance plus difficile. En outre, les lois bancaires y sont révisées tous les cinq ans, histoire d'être toujours en phase avec les innovations. Enfin, le régulateur canadien a prestement adopté les normes de Bâle II, faisant passer à 7 % le montant du Tier 1, les fonds propres requis au titre des risques encourus. Mieux, les banques vont au-delà, affichant des ratios de près de 10 %, loin devant la moyenne de 7,5 % aux États-Unis et de 3,3 % en Europe. « Il semble qu'il y ait une culture antirisque au sein du gouvernement, dans les banques et parmi les usagers », confirme Craig Alexander, économiste à la Toronto Dominion. On ne déplore ici aucune faillite dans le sillage de la crise ? à peine quelques pertes. Et si les banques canadiennes ont dû elles aussi affronter des attaques en Bourse, elles ont levé des fonds sans wdifficultés pour les contrer. Et, évidemment, elles n'ont pas demandé l'aide de l'État. Pour comprendre leurs performances, il faut aussi se pencher sur leur business model. À l'inverse des banques américaines, les établissements canadiens ont toujours eu le droit d'opérer dans plusieurs provinces. De quoi diversifier les risques. Au fil des années et des fusions, une poignée de banques très solides a émergé, alors qu'il en existe encore 7.000 aux États-Unis. Enfin, elles ont toujours associé banque de détail et investissement, et se sont ainsi appuyées sur les dépôts pour les opérations de marché, au lieu de devoir faire appel au « shadow banking » ? de l'argent injecté par les marchés de capitaux, en direct ou via de grands fonds ? comme devaient le faire les institutions de Wall Street. Un avantage évident en période de crise financière.Mais, au-delà de ce paysage, il faut ? une fois de plus ? revenir à la culture pour comprendre le succès canadien. Ici, les conditions d'octroi de prêts sont draconiennes : soit l'emprunteur dispose d'un apport de 20 % minimum, soit il lui faut assurer son emprunt. Résultat : alors qu'aux États-Unis les subprimes représentaient 25 % des nouveaux crédits en 2006, le pourcentage n'était que de 5 % au Canada. De plus, les contribuables canadiens ne peuvent déduire fiscalement les intérêts de leurs emprunts. De quoi les inciter à rembourser au plus vite. D'ailleurs, les banquiers canadiens ne pratiquent ni l'allongement des mensualités ni les taux ajustables (très bas au départ mais qui montent d'un coup ensuite). Dans ces conditions, on pourrait penser que le nombre de propriétaires est moins élevé au Canada qu'aux États-Unis. Eh bien non : le taux est identique, environ 68,5 % ? sans doute parce que le marché immobilier y est resté plus abordable. « Last but not least », la titrisation est rare au Canada. « Nous gardons les prêts dans nos livres, ce qui nous incite à faire attention », relève ainsi Ed Clark. Mais ce n'est pas tout : « Dès 2005, j'ai refusé les produits structurés, même notés AAA, poursuit le PDG de Toronto Dominion. Pour la simple raison que je ne les comprenais pas. Certains espéraient que quelqu'un, dans la banque, saurait ce qu'étaient ces produits, moi pas? » Cette décision lui a bien sûr valu l'ire de ses actionnaires, à l'affût de meilleurs rendements. Mais sans « ego », la pression est plus facile à supporter? D'autant que les actionnaires, canadiens ou étrangers, ont certes du poids, mais ne peuvent détenir plus de 10 % du capital d'une banque du pays. « Penser au rendement à court terme est vain, insiste pour sa part Gordon Nixon, le PDG de la Royal Bank of Canada. Nous l'expliquons à nos actionnaires. » Moralité, « nous n'avons pas besoin d'un effet de levier aussi fort qu'ailleurs », poursuit-il. Pour chaque dollar de fonds propres, les banquiers canadiens n'en empruntent que 20 pour leurs opérations, contre plus de 40 en moyenne pour les banques américaines, et même 60 pour certaines banques européennes avant la crise ! L'aversion au risque de l'État, associée à celle des banques et des consommateurs, a donc bien créé un cercle vertueux dans le pays. Le constat est évident, mais l'origine de cette prudence généralisée ne l'est toujours pas. On sait que les Canadiens veulent éviter d'apparaître aussi arrogants que leurs voisins américains, mais cela ne peut suffire. Certains hasardent d'autres explications : « J'avais l'habitude de dire que cela venait de nos racines écossaises mais, avec la débâcle des banques en Écosse, je n'ose plus ! » plaisante ainsi Gordon Nixon. Il faut donc explorer plus avant. « Pendant la révolution américaine, ceux qui voulaient rester fidèles à l'Angleterre se sont réfugiés au Canada », remarque Laurence Booth, professeur de finance à l'université de Toronto. De quoi créer un socle conservateur ? au sens propre du terme ? dans le pays. Mais quid des francophones ? « Du fait de leurs traditions catholiques, ils se sont parfaitement adaptés à ce conservatisme », déclare le Pr Desmond Morton, de l'université McGill, à Montréal. Pour conclure : « Si les Canadiens veulent prendre des risques, ils peuvent aisément le faire? en allant à Wall Street ! » n Pour l'heure, Bay Street se contente d'embaucher des professionnels de Wall Street par équipes entières?
Canada
-
Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.

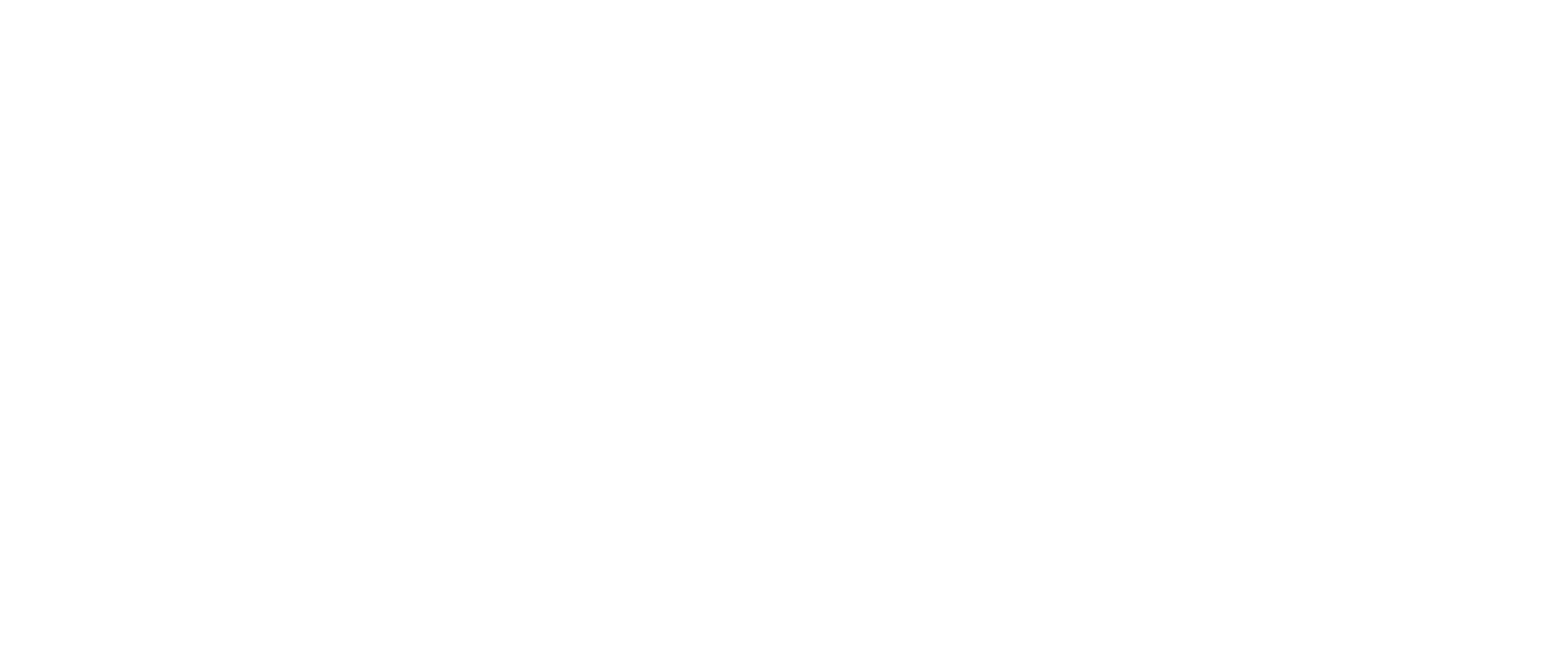


Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !