« De tous les modèles d'organisation bancaire, le pire est celui que nous avons actuellement ». Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mervyn King, ne pouvait pas être plus clair lors d'un récent discours à New York : les régulateurs, de Washington à Bâle, entendent bien, à défaut de présenter un projet global pour le système financier, s'attaquer à tout ce qui a dérapé au sein du secteur bancaire, dont « la taille, la concentration et le profil de risque se sont accrus de façon extraordinaire ». En ligne de mire, les banques d'investissement dont le modèle économique va devoir s'adapter à un double défi : la fin d'un cycle économique et la mise en oeuvre de nouvelles régulations que l'on commence à prendre au sérieux.Jusqu'ici, le trading, notamment pour compte propre, concentrait l'essentiel du chiffre d'affaires (jusqu'à 80 %) et des profits (jusqu'à 90 %) des banques d'investissement. La crise de 2007 a bien évidemment semé le doute, rapidement balayé par les profits record de 2009, qui ont pu laisser croire au retour du « business as usual ». En réalité, ces résultats sont vite apparus comme exceptionnels, avec des revenus de trading artificiellement gonflés par des taux proches de zéro, les plans de sauvetage en cascade et un niveau élevé d'émissions. L'année 2010 se présente sous un jour bien moins favorable, avec un chiffre d'affaires qui sera globalement en recul de 10 % à 15 % dans la banque d'investissement, selon les estimations d'Oliver Wyman-Morgan Stanley. « C'est un retour aux réalités », observe un banquier d'affaires. Et cette réalité, c'est une nouvelle ère économique à croissance faible, une vision que Bill Gross, le célèbre gérant de Pimpco, a popularisé sous le terme de « new normal ». Pour les banques, ce nouveau cycle se traduit par une baisse des revenus et une augmentation des coûts, comme en témoignent les résultats des neuf premiers mois. Les nouvelles régulations mises en place (et on n'a pas pris encore toute la mesure de la réforme en cours sur les produits dérivés de gré à gré) coûtent, grosso modo, un tiers de la rentabilité sur fonds propres (ROE) « d'avant-crise ». La pression se fera donc sur les activités les plus gourmandes en capitaux (trading pour compte propre) et sur les rémunérations (45 % des coûts). En ce sens, la gesticulation des politiques pour plafonner les bonus est finalement un fier service rendu à l'industrie.Du côté des revenus, en termes de métiers, la révolution silencieuse est également en marche. La banque d'investissement est par nature une activité cyclique. Il n'est donc pas étonnant d'observer une forte élasticité entre produit net bancaire et activité économique, dans un sens comme dans l'autre. Mais, les temps ont changé, et le modèle économique doit intégrer « le new normal » et non plus le « business as usual ». Comme le constate l'étude d'Oliver Wyman, ce sont les produits structurés - un segment de marché sur lequel les banques françaises rayonnent - qui ont le plus souffert de la crise, avec une chute des deux tiers du chiffre d'affaires depuis 2006. C'est le segment de marché le plus rémunérateur de l'industrie. Le début d'un nouveau cycle n'est jamais favorable aux produits complexes mais personne ne parie sur un nouvel engouement des investisseurs pour la titrisation ou les produits dérivés complexes. L'origination, le coeur de métier historique de la banque d'investissement (conseil, émission sur les marchés primaires), tire son épingle du jeu mais reste et restera marginale. Les grandes banques d'investissement laissent progressivement ces métiers historiques, à fort contenu humain, aux « boutiques » spécialisées, qui prospèrent à nouveau à Wall Street. C'est le « flow business » - c'est-à-dire les activités de marché et de dérivés - déjà dominant qui devient aujourd'hui prédominant, comme si le monde avait de plus en plus besoin de couvertures pour faire face à la volatilité de tous les marchés. C'est une activité fortement automatisée, sur des produits relativement simples (portant sur différents sous-jacents), à faibles marges et à forts volumes. Dans ce « business », l'avantage comparatif est donc déterminant et la prime est donnée aux acteurs qui disposent des plus grosses plates-formes informatiques. Une course à la taille est engagée entre les cinq ou six mastodontes, comme la Deustche Bank, UBS ou Bank America Merrill pour s'imposer sur le marché. Toutes ont vocation à devenir ce qu'Oliver Wyman dénomme, les « flow monsters ». Sans que le régulateur y trouve, pour l'instant, à redire.Par Éric Benhamou Éditorialiste à « La Tribune »
De la banque d'affaires au « flow monster »
-
Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.

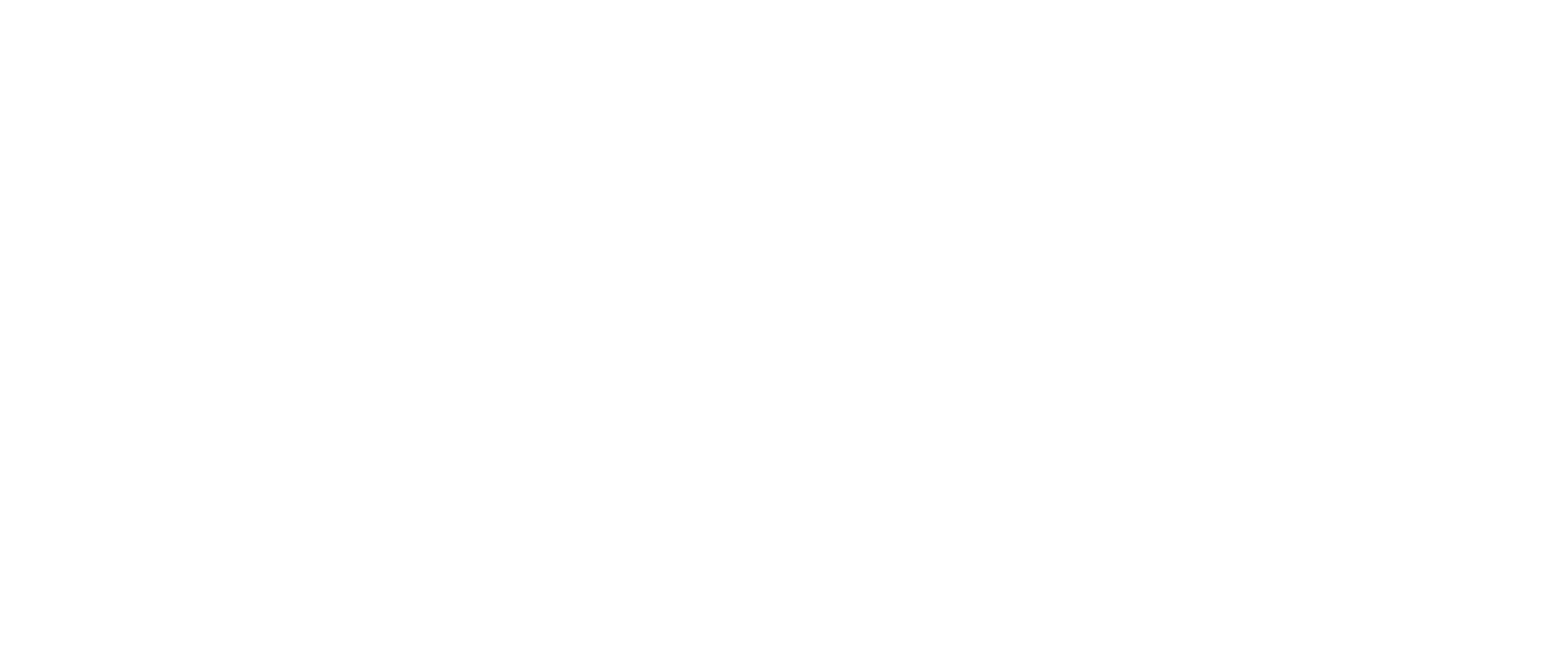


Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !