
À Marseille, tout le monde connaît l'imposante muraille de pierres aux reflets jaune et rose du fort Saint-Nicolas. Sortie du fond des âges, cette gigantesque étoile à plusieurs branches déploie ses remparts escarpés en surplomb du Vieux-Port, en plein centre de Marseille, à côté du palais du Pharo, au carrefour des 1er et 7e arrondissements. Pourtant, avant le 4 mai, date de son ouverture au public pour la première fois en trois cent soixante ans, personne ne savait dire au juste ce qui se passait dedans ! Depuis sa construction ordonnée par Louis XIV en 1660, le fort Saint-Nicolas était de tout temps resté militaire, destiné à surveiller la côte contre d'éventuels envahisseurs... mais aussi Marseille et ses habitants ! Inaccessible au commun, le site a longtemps caché une prison ainsi qu'une branche du service de santé des armées qui menait là, entre autres, des expérimentations sur des animaux...
À partir de ce printemps, le fort démarre une tout autre vie : celle d'un site patrimonial vivant, ouvert à tous, proposant aussi bien des visites guidées aux touristes de passage que des spectacles aux Marseillais, concerts, théâtre déambulé, soirées électro... Et pour les plus jeunes, un escape game sur l'histoire du fort. Il prévoit aussi de recevoir chaque année plusieurs artistes en résidence pour alimenter ses contenus. Ces jours-ci, on y croise le photographe tunisien Bachir Tayachi et l'écrivaine Valérie Manteau, chargée, elle, de fouiller et de révéler l'histoire du fort au gré de témoignages, démarche qu'elle restitue déjà sur un podcast écoutable en visitant le lieu, « L'île aux chiens ». Il dévoile l'histoire méconnue de la prison du fort Saint-Nicolas qui, sous contrôle de Vichy et des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, a compté Jean Giono et Jean Zay au rang de ses prisonniers, ainsi que le poète anarchiste Voline, le futur président tunisien Habib Bourguiba...

Mathilde Dewavrin, architecte et performeuse, anime des ateliers pour faire découvrir le monument. (Crédits: © LTD / Jean-Charles Verchère/Citadelle de Marseille)
7000 Marseillais impliqués dans les travaux
C'est en 2010 que l'armée, qui n'en trouvait plus l'usage, a cédé le fort à Marseille. Sous la forme d'un bail emphytéotique de quarante ans signé en 2021, la municipalité choisit alors d'en confier l'exploitation au Groupe SOS. Cette association à but non lucratif, fondée en 1984 et devenue depuis l'un des hérauts de l'économie sociale et solidaire en Europe, fédère à ce jour plus de 700 établissements à vocation sociale (crèches, hôpitaux, Ehpad...). Elle revendique 22 000 salariés et, chaque année, près de 2 millions de personnes concernées par ses actions génératrices de contrats, de formations, et donc de lutte contre l'exclusion.
« C'est à Marseille, non loin du fort, à l'époque où nous nous appelions encore SOS Drogue International, que nous avons monté notre premier centre d'accompagnement pour toxicomanes, le Csapa La Corniche, qui existe toujours », rappelle Jean-Marc Borello, président et fondateur du Groupe SOS, proche de Macron et roi de la fête le 29 avril dernier, jour de l'inauguration officielle de la Citadelle. « Depuis vingt ans, précise-t-il, ce sont deux associations du Groupe SOS, Acta Vista et Bao Formation, qui œuvrent à la rénovation du fort... » Au fil des chantiers de réinsertion organisés depuis 2002 avec d'anciens détenus, précaires ou migrants, au moins 7 000 Marseillais auraient été impliqués dans les travaux de réhabilitation du fort. Acteur crucial, sinon chevaleresque, de cette renaissance en faveur du patrimoine, le Groupe SOS en restera l'opérateur clé dans les années à venir : il s'engage à poursuivre sa rénovation et associe sa branche SOS Culture à l'animation culturelle du fort.

L'aménagement des jardins du site, qui s'achèvera en 2025. (Crédits: © LTD / Jean-Charles Verchère/Citadelle de Marseille)
Riche de 5 hectares dont un quart de jardins plantés d'essences méditerranéennes et une majorité de surfaces extérieures minérales (remparts, terrasses, cours intérieures, moulin, poudrière), le lieu affiche d'ores et déjà une programmation éclectique au-delà des spectacles ponctuels. D'un côté il offre à des artistes associés ou résidents de venir penser son héritage et sa mémoire collective, de l'autre il met l'accent sur les arts numériques et immersifs : ces jours-ci, il publie sur son site en ligne un « appel à manifestation d'intérêt » pour trouver les futurs résidents de son « quartier de l'innovation ». « La Citadelle veut tisser un lien entre patrimoine et arts immersifs, explique Mathilde Rubinstein, directrice déléguée de la Citadelle. Le numérique est un outil pratique au vu des contraintes d'un site pour l'heure limité en espaces abrités. C'est aussi une façon souple et actuelle d'apporter un regard neuf sur l'histoire de France qui se lit dans celle du fort : la Révolution, les guerres jusqu'à 1939-1945, la Résistance, les décolonisations. Et bien sûr le patrimoine militaire, le rôle de l'armée qui contribue à faire société. »
LA TRIBUNE DIMANCHE - La Citadelle de Marseille est présentée comme un « tiers-lieu ». Qu'entendez-vous par là ? MATHILDE RUBINSTEIN - Je ne pense pas qu'il existe une définition générique précise du tiers-lieu. Ici, la référence va au tiers-lieu patrimonial et s'appuie sur deux réalités. D'abord celle d'un équipement partagé par plusieurs acteurs associatifs différents sur un même territoire, dans une logique participative afin d'accueillir du public, des initiatives, des entreprises. L'autre réalité induite, c'est l'économie mixte, cruciale car dans notre cas elle reposera principalement sur les ressources propres, billetterie, visites guidées, location d'espaces à des événements privés ou publics. La Citadelle ne pourra pas se contenter du soutien de la puissance publique. Notre gros défi, maintenant, c'est l'argent. Générer, en ressources propres, 40 % d'un budget estimé à 2 millions d'euros par an, c'est beaucoup. Nous devons développer notre propre exploitation afin de dégager des marges et de poursuivre les travaux de rénovation. Sur un lieu qui présente encore beaucoup de contraintes... Oui, il y a un problème d'accessibilité, notamment pour les personnes atteintes de handicap moteur. Idéalement, il faudrait trouver un mécène pour nous procurer deux ou trois voiturettes adaptées, avec un moteur assez puissant pour les aider à grimper et à circuler dans le fort. Pour l'heure, le fort a deux accès et deux sorties de secours, c'est peu pour 5 hectares, ça pose des questions de sécurité et limite notre jauge, pour le moment, à 500 personnes. Mais on aimerait pouvoir monter rapidement à 1 500. Après, les gens entrent et sortent ; sur les deux premières journées de portes ouvertes, nous avons eu 9 000 personnes, c'est pas mal. Nous espérons plus de 200 000 visiteurs la première année. Acta Vista emploie 400 personnes à l'année afin de poursuivre la restauration du fort. L'équipe de la Citadelle, qui gère son fonctionnement est plus restreinte... C'est sûr. Notre équipe de permanents compte 15 personnes, à laquelle s'ajoutent des chantiers d'insertion que nous organisons avec Acta Vista. Ils déploient des groupes de six personnes associées à l'entretien et à la surveillance des jardins, au ménage, à la sécurité. Ce personnel prestataire est formé et il travaille aux horaires d'ouverture au public afin de ne pas être invisibilisé. Le lieu est également présenté comme un « centre historique d'interprétation ». C'est ce vers quoi nous tendons avec les résidences artistiques et le quartier de l'innovation. L'objectif est de travailler à la collecte de mémoire et à la mise en récit du site. À terme, l'idée serait d'obtenir de l'État, sur le modèle de la chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, le label Centre culturel de rencontre, qui associe site patrimonial et programme de création.« Le gros défi, c'est l'argent », Mathilde Rubinstein, directrice déléguée de la citadelle de Marseille

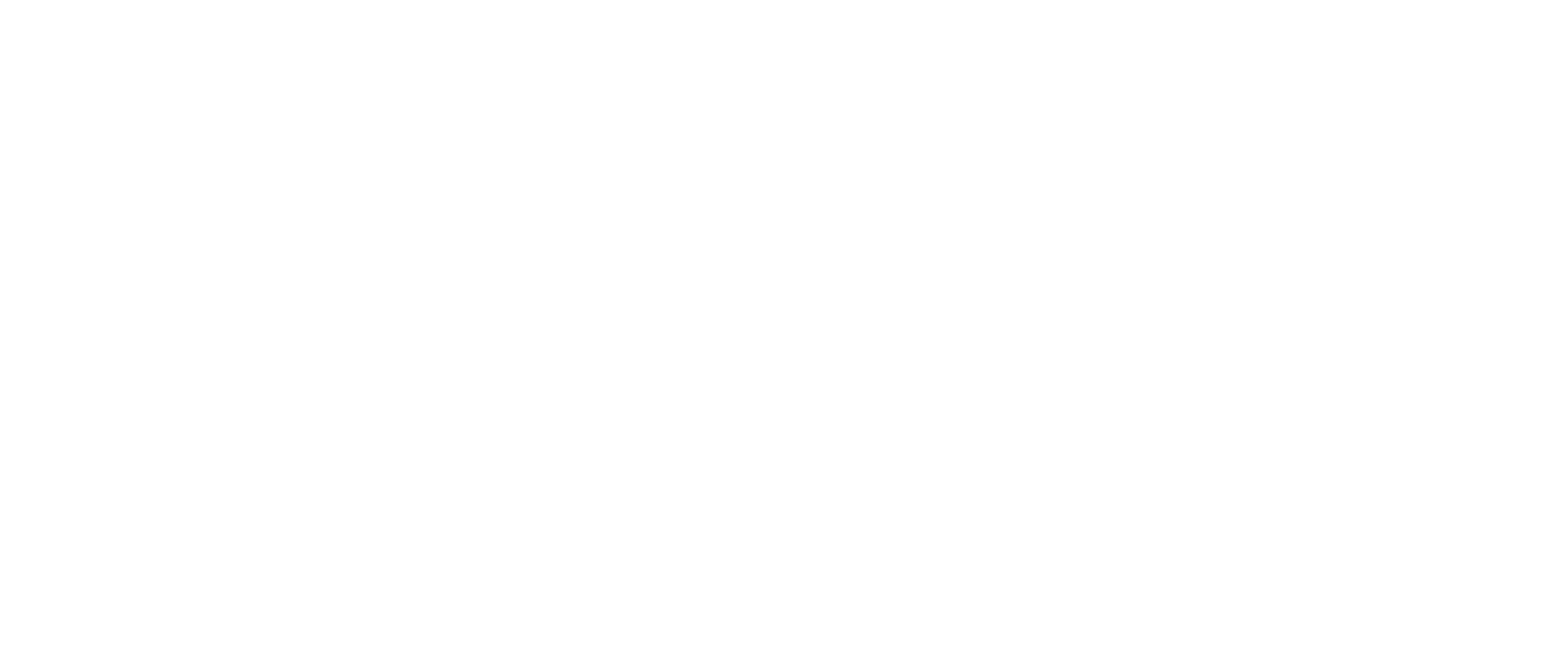

 Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français
Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français

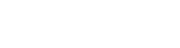
Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !