
« Une bonne négociation est une négociation où tout le monde est satisfait du résultat final. Je pense que c'est le cas », s'est félicité, ce matin, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, lors d'une conférence de presse présentant l'accord entre EDF et l'exécutif sur la nouvelle régulation encadrant le prix de l'électricité nucléaire.
Cet accord intervient après de longs mois de négociations sous haute tension entre l'électricien historique et le gouvernement, alors que le mécanisme actuel de l'Arenh, qui contraint EDF à vendre une grande partie de son électricité nucléaire à prix cassé (42 euros du mégawattheure), va s'arrêter fin 2025.
La déclaration du locataire de Bercy a de quoi faire grincer des dents Frank Roubanovitch, le président de la CLEEE, une association d'entreprises grandes consommatrices d'énergie issues de secteurs variés, allant de l'industrie métallurgique à l'agroalimentaire, en passant par les semi-conducteurs, l'automobile, les télécoms ou encore les grands transporteurs et l'hôtellerie. Loin d'être satisfaite par cet accord, la CLEEE dénonce, au contraire, « un grand pas en arrière pour les entreprises françaises ».
Un doublement du prix par rapport à l'Arenh ?
Dans les faits, le gouvernement assure que l'accord trouvé avec EDF doit permettre de « garantir un prix de l'électricité nucléaire moyen de l'ordre de 70 euros le mégawattheure sur toute la production ». Or, selon la CLEEE, il y a « un abîme entre la communication du gouvernement (...) et la réalité de ce dispositif ».
« Je ne conteste pas le prix de 70 euros le mégawattheure. Si on devait payer ce prix là, cela ne me choquerait pas, même s'il est beaucoup plus élevé que les 42 euros mis en place dans le cadre de l'Arenh. Mais, en réalité, nous allons payer beaucoup plus cher que ces 70 euros », s'inquiète Frank Roubanovitch.
Dans le détail, la nouvelle réglementation repose sur un mécanisme de compensation qui prévoit que les ventes d'électricité nucléaire d'EDF soient taxées à hauteur de 50% dès lors que le prix du mégawattheure sur le marché dépasse la barre des 78-80 euros, puis à hauteur de 90% au-delà de 110 euros du mégawattheure.
« Dans les conditions de marché actuelles, cela reviendrait à un doublement du prix du mégawattheure par rapport à l'Arenh », estime Frank Roubanovitch, démonstration à l'appui.
« Prenons le prix de marché du jour pour 2024. Celui-ci est de 120 euros le mégawattheure. Cela signifie qu'EDF va vendre en moyenne son électricité à 120 euros. Avec le nouveau mécanisme, nous ne serons protégés qu'à partir de 80 euros. Et nous le serons à hauteur de 50% entre 80 et 110 euros. Cela signifie que, sur un écart de 30 euros, nous serons remboursés de 15 euros. Donc aux 80 euros que nous devrons payer, s'ajouteront les 15 euros restants. Ce qui fait un total de 95 euros. Nous payerons donc le double par rapport à l'Arenh », fustige-t-il.
« Un manque catastrophique de visibilité »
Outre ce niveau de prix très élevé, la CLEEE, dont les entreprises adhérentes représentent près de 400 milliards d'euros de chiffre d'affaires et environ 2 millions d'employés, estime que ce nouveau mécanisme les protègera moins en cas de crise sur la production d'électricité nucléaire.
Surtout, elle s'inquiète « d'un manque catastrophique de visibilité pour les entreprises ». « Pour les prix d'électricité en 2026, nous ne connaîtrons que début 2027 le montant qui nous sera rétrocédé. Nous avancerons donc à l'aveugle, alors que nous aurions besoin de connaître vers mi-2025 les prix de l'électricité de 2026 pour établir notre budget, fixer nos propres prix de ventes. Cela va être très compliqué pour prendre des décisions d'investissements. Ce manque de visibilité est délétère pour les entreprises. Cela fait des semaines que je le répète », déplore-t-il.
« Le fait que ce soit régulé a postériori peut être effectivement un problème », reconnaît Philippe Darmayan, l'ancien président d'ArcelorMittal France et auteur d'un rapport destiné à favoriser les contrats d'approvisionnement à moyen et long terme pour les industriels dits électro intensifs, regroupé pour la plupart au sein de l'Union des industries utilisatrices d'énergie (Uniden)
Les entreprises électro-intensives plus réservées
Pour l'heure, ses adhérents, qui représentent environ 70% de la consommation énergétique industrielle en France, sont beaucoup moins critiques à l'égard de l'accord trouvé avec EDF. Et pour cause, ces derniers devraient pouvoir bénéficier de prix bien plus compétitifs et d'une visibilité suffisante pour la décarbonation de leurs activités grâce à la mise en place de contrats d'approvisionnement de très long terme avec EDF (à travers lesquels ils participeront au financement du nucléaire). Contrats, dont les modalités d'applications n'ont toutefois pas encore été révélées.
Mais cette alternative « ne correspond pas au besoin de 99% des entreprises françaises », déplore Frank Roubanovitch. « Les hyper électro-intensifs sont des entreprises qui peuvent se projeter sur 20 ans, ce qu'une ETI ne peut absolument pas faire », poursuit-il. Alors que cette régulation devra être adoptée dans le cadre d'une loi, le président de la CLEEE mise sur le débat parlementaire pour obtenir « une révision importante » de ce mécanisme. « Toutes les entreprises vont se mobiliser derrière ces belles annonces. Je suis certain que les lignes vont bouger », assure-t-il.
De son côté, le gouvernement a prévu une clause de revoyure dans un délai de six mois et le lancement d'une consultation auprès des industriels, des consommateurs et des fournisseurs.

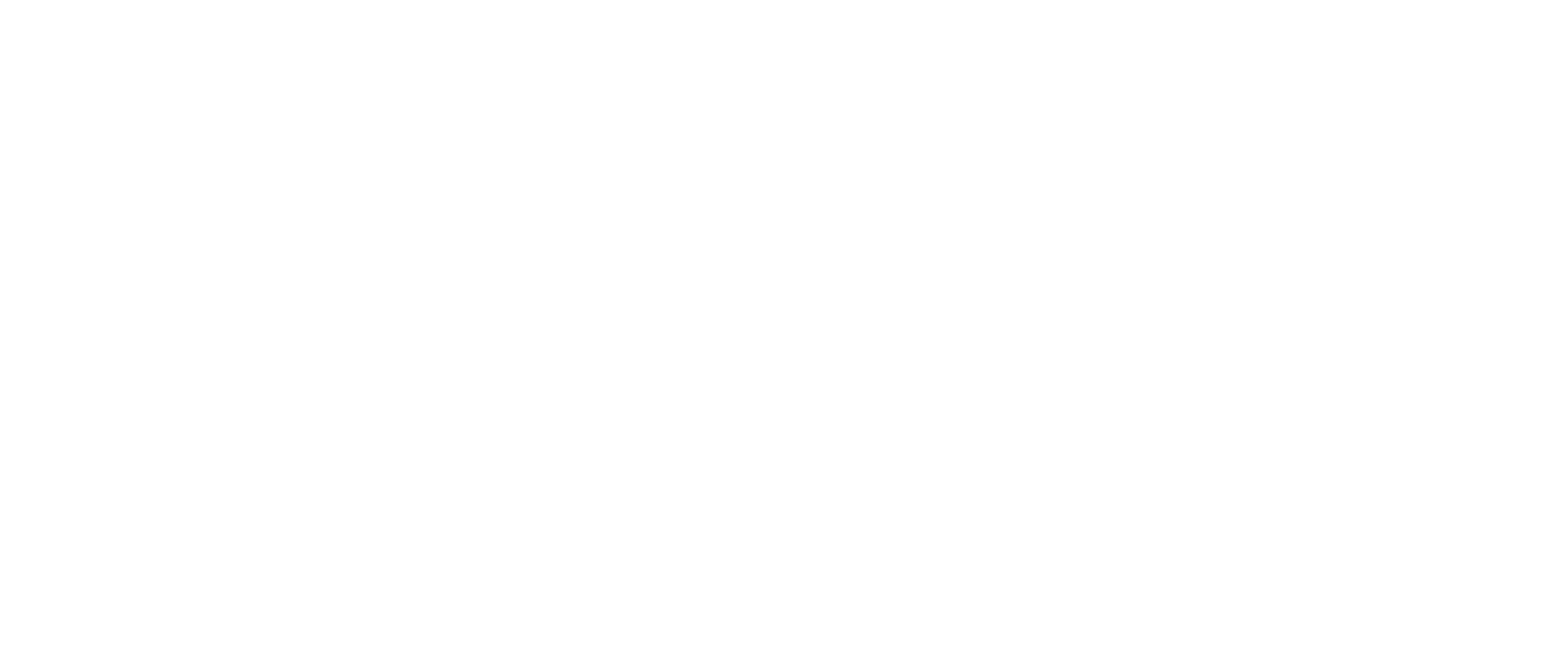

 Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français
Emploi : les vraies raisons des vagues de départs des salariés français

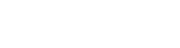
Sujets les + commentés