
LA TRIBUNE DIMANCHE - Vous n'aviez jamais voulu traiter le thème de la Shoah auparavant. Qu'est-ce qui vous a convaincu?
MICHEL HAZANAVICIUS - Le génocide juif n'est pas le sujet principal du film, c'est son contexte. Je suis issu d'une famille de Juifs d'Europe de l'Est, c'est une question intime pour moi, sur laquelle je n'avais pas envie de faire des films. Je ne suis pas obsédé par le devoir de mémoire : je ne suis pas prof, je n'ai pas cette mission, moi, je fais du « spectacle ». Et puis, soudain, j'ai lu le livre de Jean-Claude Grumberg, et la beauté de cette histoire m'a bouleversé. Il est le meilleur ami de mes parents, je le connais bien. Puis le producteur Patrick Sobelman m'a proposé d'en faire un film d'animation, et c'était une évidence. Je dessine depuis mes 10 ans... Cette agrégation de choses intimes m'a décidé à y aller.
La simplicité de cette histoire cache une grande puissance philosophique... C'est toute la magie du conte?
Et de l'histoire de Jean-Claude... Le devoir de mémoire est naturellement ancré en lui et, quand il m'a dit avec simplicité : « J'ai seulement voulu montrer que, même dans cette horreur, il pouvait y avoir des belles choses », je n'ai plus hésité. J'ai le sentiment qu'il a mis soixante ans à écrire cette histoire, qui a toujours été là, comme les contes oraux qui ont fini par être écrits par quelqu'un. J'ai l'intuition que ce récit préexistait à son écriture et, avec ce film, j'ai essayé de recréer l'idée d'une mémoire qui ressurgit, qu'on exhume.
La représentation des camps de la mort au cinéma est une question délicate... L'animation permet-elle une évocation moins frontale?
L'un des gros enjeux du film était la représentation des camps, des convois de déportés, de toute cette souffrance... C'est très compliqué car, si vous représentez ce qui s'est réellement passé, vous montrez des images insoutenables et, si vous ne le faites pas, il y a un risque de mensonge, d'image tronquée, quasiment de révisionnisme... Je n'aurais donc pas pu tourner avec des vrais acteurs essayant de « jouer » cela : il y a quelque chose de trivial et d'obscène là-dedans qui me gêne. Mais la question ne se pose pas avec l'animation, car elle laisse faire l'imagination du spectateur. J'ai donc travaillé au maximum ce pouvoir de suggestion, grâce au dessin, qui permet des images plus symboliques.
On voit le sacrifice d'un homme qui jette son enfant du train dans l'espoir de lui sauver la vie. Est-ce le propre des récits yiddish, où la beauté côtoie toujours le pire?
Oui, dans ce film, il y a le sacrifice invivable de cet homme et aussi la beauté des Justes. Le film ne porte pas sur la dénonciation des bourreaux ni sur la glorification des victimes, mais sur ces Justes qui vont se sacrifier pour sauver une enfant: ils incarnent cet endroit où l'homme et la femme ont du sublime en eux et révèlent, dans des contextes horribles, toute l'humanité dont nous sommes encore capables.
Est-ce que ce film a remué des questions personnelles chez vous ?
Bien sûr. Longtemps, les survivants de la Shoah se sont tus, parce que ce qu'ils ont dit sur les camps était inaudible. Puis, dans les années 1970, il y a eu des travaux d'historiens, la traque des nazis et l'apparition des négationnistes... On a donc recherché la parole des survivants, et j'ai passé mon enfance dans l'émergence de cette parole. Depuis, je porte en moi un imaginaire particulier : pour moi, Auschwitz, c'est la vision de l'enfer, je suis allé sur place, j'ai lu Primo Levi... Il me fallait réussir à transcender ce sujet, car se contenter d'enregistrer la réalité n'aurait pas eu de sens pour moi.
C'est votre premier film d'animation. Comment s'est-il passé ?
J'ai appris un métier : c'est un travail d'équipe et un mode d'expression incroyable. Le dessin est dans ma vie depuis toujours, je l'ai toujours assimilé à de la méditation, ce moment où l'on est en soi-même. Pendant des années, j'ai jeté mes dessins, mais Bérénice [Bejo, sa compagne] m'a demandé de faire des carnets pour pouvoir les garder.
Comment s'est passée votre rencontre avec le narrateur, Jean-Louis Trintignant?
C'est la première chose que j'ai faite : dire au producteur que je voulais Trintignant, la plus belle voix du cinéma français. C'était extrêmement émouvant de rencontrer cet homme et de l'entendre dire ce texte. J'ai commencé à travailler sur ce projet il y a cinq ans, le Covid l'a interrompu, mais j'ai enregistré sa voix très tôt. Je réécoutais souvent l'enregistrement du texte de fin sur l'amour : mon émotion était intacte à chaque fois, cela me remettait dans l'axe.
Vous deviez travailler avec Gérard Depardieu mais c'était impossible ?
Depardieu s'est mis dans une situation où plus personne ne peut travailler avec lui aujourd'hui...
Le film a été fait avant les attentats du 7 octobre 2023 en Israël et le déclenchement de la guerre... Craignez-vous que ce contexte pèse sur la sortie en salles, en novembre ?
Il n'est pas question de changer quoi que ce soit au film. Mais malheureusement, il prend aujourd'hui une couleur différente pour certains, compte tenu du parfum d'avant-guerre qui règne actuellement... Ce film n'a rien à voir avec les questions d'actualité internationale, il arrive avec une voix humaniste, apaisée, il apporte de la nuance et de la beauté. Sa morale parle de l'amour que l'on porte aux autres.
Vous aviez pris position en 2018 en faveur d'une implication des hommes dans le mouvement MeToo, êtes-vous toujours sur cette ligne ?
J'y suis plus que jamais ! Et si on me l'avait proposé, j'aurais signé la tribune dans Elle [en avril, 100 hommes ont soutenu MeToo]. Le soutien des hommes est essentiel : certaines féministes pensent que c'est un domaine réservé aux femmes, mais c'est une erreur car le problème vient des hommes, ils doivent faire ce travail. Par ailleurs, on ne peut pas dénoncer des actes quand on n'en a pas été soit le témoin direct, soit la victime : on ne peut donc pas parler d'omerta, mais il faut continuer à accueillir de la meilleure manière possible les paroles de victimes, il n'y a qu'elles qui puissent réellement dénoncer ces actes. Les mœurs changent, même si parfois il y a un fossé entre générations : j'ai des copains plus âgés qui ne comprennent pas ce qui se passe. Je leur réponds que tout ce qui arrive, c'est pour le mieux. Nous vivons une révolution majeure dans l'histoire de l'humanité, pas un éphémère phénomène de société.
C'est donc un film d'animation qui a clôturé le 77e festival de Cannes. Et quel film : un conte adapté du livre de Jean-Claude Grumberg, qui montre que ce genre cinématographique mérite toute sa place en compétition officielle. À côté de films qui manient souvent la provocation et la surenchère comme des armes de persuasion, la sobriété limpide et l'art de la suggestion déployés ici par Michel Hazanavicius confèrent à cette histoire une puissance philosophique bien plus efficace. Sans que jamais le trait soit forcé - ni celui du dessin ni celui de ce chapitre sombre de l'Histoire -, on accompagne, en pleine forêt, un couple de bûcherons polonais qui recueille une petite « marchandise » tombée d'un train fonçant vers Auschwitz : un bébé juif jeté à travers les barreaux par son père, dans l'espoir de lui sauver la vie. Un film à la fois bouleversant, poétique et simple, qui parle de l'humanité des Justes et qui, dans une veine très ashkénaze, choisit de montrer la beauté et la vie, même au milieu de l'horreur. De Michel Hazanavicius, avec les voix de Jean-Louis Trintignant, Dominique Blanc, Grégory Gadebois et Denis Podalydès. 1 h 21. Sortie en novembre.Destins animés

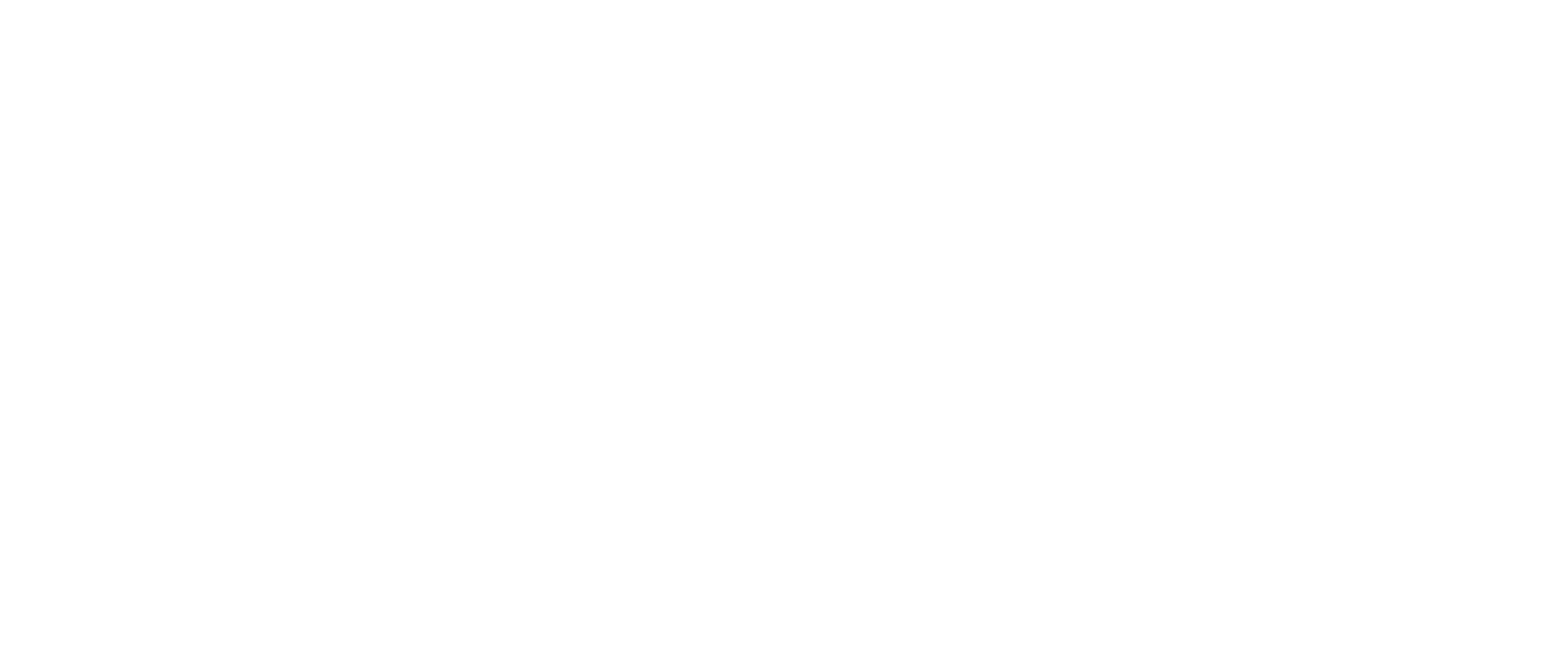
 Dissolution : la France est attaquée sur les marchés financiers
Dissolution : la France est attaquée sur les marchés financiers

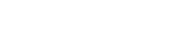
Sujets les + commentés