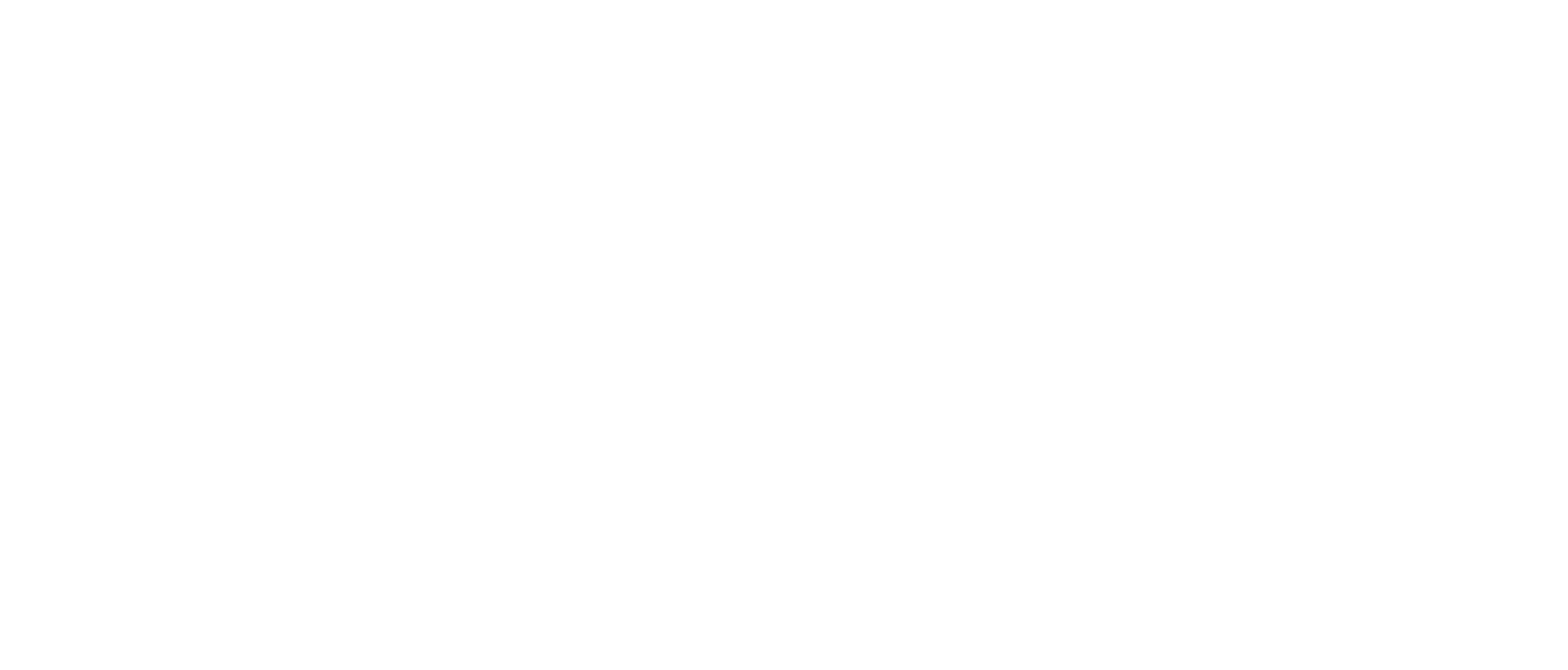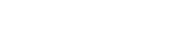Les mesures drastiques de confinement décidées à la mi-mars ont jeté une lumière crue sur les inégalités en France. Rapidement, de nombreux travailleurs ont dû continuer à se rendre sur leur lieu de travail tandis que d'autres ont pu travailler depuis leur domicile limitant ainsi les risques d'exposition. Au delà des conditions de travail, la mise sous cloche de l'économie a amplifié les disparités sociales antérieures à la crise.
Dans une récente étude très documentée passée relativement inaperçue, la direction générale du Trésor rattachée à Bercy a passé au crible les effets terribles de la pandémie sur ces inégalités criantes. Avec la récession en cours, de nombreux ménages déjà en difficulté se retrouvent au bord du gouffre financier. La mise en oeuvre de filets de sécurité ne devraient pas suffire pour beaucoup de familles qui risquent de passer outre.
Mal logement et surpeuplement
La pandémie a d'abord mis en exergue les inégalités de logement au sein de population. Beaucoup de personnes sans abri (estimées à 150.000) ou migrants ont été en première ligne pour affronter sans logement la circulation importante du virus au printemps. Ce qui a d'ailleurs provoqué de vives inquiétudes entre autres chez les professions médicales.
Du côté des personnes qui bénéficient d'un logement, il existe d'amples disparités. Selon le document du ministère de l'Economie, plus de 900.000 personnes sont mal-logées en France. Par ailleurs, de multiples écarts sont liés aux catégories socioprofessionnelles. Les familles de cadres ont en effet un logement en moyenne 1,5 à 2 fois plus grand que les inactifs (hormis les retraités), les ouvriers et les employés. En outre, les difficultés de logement et les conditions de surpeuplement vont de pair avec les catégories sociales. Ainsi, 45% des ménages du premier quartile (ménages modestes) ont rencontré des difficultés de logement contre seulement 16% chez les cadres durant les dernières années.
La situation alarmante des personne isolées
Outre les conditions de logement, l'auteure de l'étude Marie-Apolline Barbara s'est également intéressée aux conditions de vie des personnes isolées qui peuvent rapidement se retrouver dans situations difficiles pour se soigner ou faire leurs courses. Selon la note de Bercy, 10,5 millions de personnes vivent seules sur le territoire français (soit environ 16% de la population). Elles sont d'abord plus exposées que les autres aux phénomènes de pauvreté. "Le taux de pauvreté (au seuil de 50 % du revenu médian) est de 9,6 % chez les personnes vivant seules, contre 8 % dans la population générale". Les mesures de confinement et la limitation des déplacements dans des périmètres restreints ont pu accroître l'isolement de ces individus. "Si vivre seul et se sentir isolé ne vont pas nécessairement de pair, les conditions de vie des personnes objectivement isolées ont été fragilisées par le confinement. En effet, les 10 % de Français isolés ont aussi un moindre recours aux moyens de communications virtuels pour rester en contact avec leur famille ou leur entourage", explique Marie-Apolline Barbara.
Le confinement avec enfant
Là encore, la composition du foyer peut jouer un grand rôle sur les conditions de vie en période de confinement. La fermeture des établissements scolaires a chamboulé le mode de vie de milliers de parents contraints parfois de trouver des modes de garde pour ceux qui étaient obligés de se rendre sur leur lieu de travail. Pour ceux qui télétravaillaient, la garde des enfants s'est avérée parfois difficilement compatible avec l'organisation du travail. "La charge des enfants pèse aussi différemment selon l'âge de ces derniers (en matière de suivi pédagogique notamment) et le nombre d'adultes disponibles (télétravail, familles monoparentales...). À cet égard, les aides à la prise en charge des enfants des travailleurs « essentiels » ont cependant permis de réduire les contraintes du confinement pour certaines familles", indique l'étude du ministère de l'Economie.
Des inégalités parentales aggravées
Le confinement a amplifié les inégalités entre les parents. Une enquête de l'Insee rendue publique au mois de juin dernier rappelait que la prise en charge des enfants était globalement plus assurée par les femmes. 83% des femmes interrogées affirment y avoir passé plus de 4 heures par jour contre 57% des hommes. Sur l'ensemble des personnes en emploi, les mères ont deux fois plus souvent que les pères renoncé à travailler pour garder leurs enfants (21 % contre 12 %).
Des conditions de travail inégales
La mise sous cloche de l'économie tricolore a eu des répercussions disparates sur l'organisation du travail selon les métiers et catégories professionnelles. Ainsi, une récente enquête de l'Insee rappelait que si 35% des personnes en emploi ont continué de se rendre sur leur lieu de travail, 34% ont télétravaillé. Ainsi, une majorité des cadres et professions intermédiaires ont pu télétravailler (58%) contre 20% chez les employés et 2% chez les ouvriers. "De telles différences se retrouvent également sur les conditions de travail selon le niveau de vie. 21 % des personnes les plus modestes ont télétravaillé pendant le confinement contre 53 % des plus aisés (dernier quintile). À l'inverse, les personnes les plus modestes ont davantage continué à aller travailler sur site. Ce fut en particulier le cas des ouvriers (53 %), devant les employés (41 %), agriculteurs, chefs d'entreprise et indépendants (40 %), les cadres et professions intermédiaires étant nettement en retrait (21 %)."
Des conditions financières dégradées
Si les mesure de chômage partiel ont permis de préserver une grande partie des revenus de la population active, beaucoup de foyers modestes ont pu subir une perte de revenus en raison de l'activité partielle, d'un arrêt de travail pour maladie ou garde d'enfant. Parmi les personnes interrogées par l'Insee, ce sont les plus modestes qui déclarent le plus souvent que leur situation financière s'est dégradée.