En serait-il de la crise financière comme des grands conflits mondiaux?? Après chacun d'entre eux, que n'a-t-on juré, la main sur le c?ur, sur le mode du "plus jamais ça". Et pourtant, on connaît la suite... Pour la finance, au moment où, aujourd'hui, certains croient déjà pouvoir augurer d'une sortie de crise rapprochée, tel pourrait bien être aussi le cas. Certes, le secteur bancaire, fortement aidé par l'Etat, a apparemment évité le "bug" majeur du blocage de la distribution du crédit. Mais, en dépit d'une contraction de l'économie réelle qui pourrait bientôt emprunter les pas de celle de 1929 (Eichengreen-O'Rourke), une petite musique pernicieuse se fait de plus en plus entendre?: celle du retour au statu quo ante.
Les signes de cette attitude ne manquent pas. C'était hier, à New York ou à Zurich, les annonces d'augmentation des rémunérations fixes des cadres bancaires pour compenser la baisse des bonus, parfois dans des proportions considérables. En France, dans plus d'un établissement, la même tendance se dessine. Autre signe, peut-être encore plus lourd de conséquences?: la décision de dix banques américaines de rembourser 68 milliards de dollars au Trésor, soit le quart des sommes reçues à l'automne dernier de l'Etat, est perçue comme la preuve que les banques concernées ne sont plus en situation de danger et qu'elles peuvent faire, dès à présent, appel au marché pour se recapitaliser tout en évitant d'être contrôlées au plus près par les pouvoirs publics.
En outre, les banques ont réussi à obtenir la modification des normes comptables qui leur imposaient de valoriser leurs actifs douteux strictement au prix du marché. Les prêts bancaires à effet de levier leur font aussi à nouveau gagner de l'argent. Elles ont aussi passé l'épreuve des tests de résistance ("stress tests"). C'est donc tout le paysage bancaire qui, au moins en apparence, devrait connaître une embellie.
En fait, tout cela ne rassure pas vraiment. Réajuster dans de telles proportions les salaires des cadres supérieurs au nom d'une volonté de retenir (ou de séduire) les meilleurs ne peut que scandaliser les millions de chômeurs qui ont perdu leur emploi suite à la débâcle financière. Comment peut-on également accepter qu'aucune réflexion approfondie ne soit menée sur la rémunération des ces banquiers responsables?? De même, la crédibilité des "stress tests" réalisés sur la base de chiffres non contrôlés et à partir de modèles dont la crise a démontré l'indigence et l'inanité, paraît bien limitée. Se dégager enfin du contrôle de l'Etat tout en continuant d'emprunter à taux zéro auprès de la Fed est plus que suspect.
C'est en outre imprudent dans un contexte maintenu de contraction de l'économie réelle. En France, pas question, pour l'instant au moins, de restituer les 24 milliards d'euros prêtés par l'Etat. La formule de la dette subordonnée, même coûteuse en intérêts, présente en effet un avantage?: l'Etat n'est pas actionnaire. Quoi qu'il en soit, la décision de remboursement de l'Etat aboutit à ne pas donner la priorité à l'assainissement des bilans, en particulier de ce que Paul Krugman, le dernier Nobel, a appelé de façon très crue "le foutoir des actifs toxiques". Or, ceux-ci se comptent par centaines de milliards de dollars (ou d'euros) et nul n'en connaît les contours exacts, ni ne peut dire ce qu'il adviendra de leur valorisation finale.
La même préférence en faveur du statu quo ante se vérifie à propos de "l'ardente obligation" de l'après-crise?: la réforme de la régulation. Réclamée à cors et à cris partout et par tous, y compris par les acteurs eux-mêmes lors du G20, la réforme se hâte fort lentement et l'empressement initial fait place à la procrastination. Les rapports et les commissions de tout poil n'ont pas manqué et il ne semble pas qu'ils aient été suivis de décisions tangibles. En particulier sur l'essentiel?: la nécessité de réformer la titrisation, d'en comprendre les bénéfices, d'en exclure les comportements opportunistes qui transforment une technique utile en un vaste schéma de Ponzi.
Même aux Etats-Unis, la réforme Obama annoncée, intéressante sur certains points (organe de protection des épargnants) apparaît tout à fait cosmétique pour la titrisation, avec une obligation de rétention du risque de crédit par les banques de seulement 5%. Sans doute, certains ajustements en interne ont-ils été réalisés par les banques. Citons, par exemple, l'abandon des dérivés de crédit les plus complexes, la gestion des avoirs en compte propre, l'introduction de la variable liquidité dans les modèles, etc. Mais les méthodes de démarchage pour le placement des produits auprès de la clientèle restent pour l'essentiel inchangées et, avec le temps qui passe, l'idée d'un "grand soir" pour la réforme de la finance paraît bien lointaine. Il reste peu de temps pour se reprendre avant que le facteur ne sonne une deuxième fois.

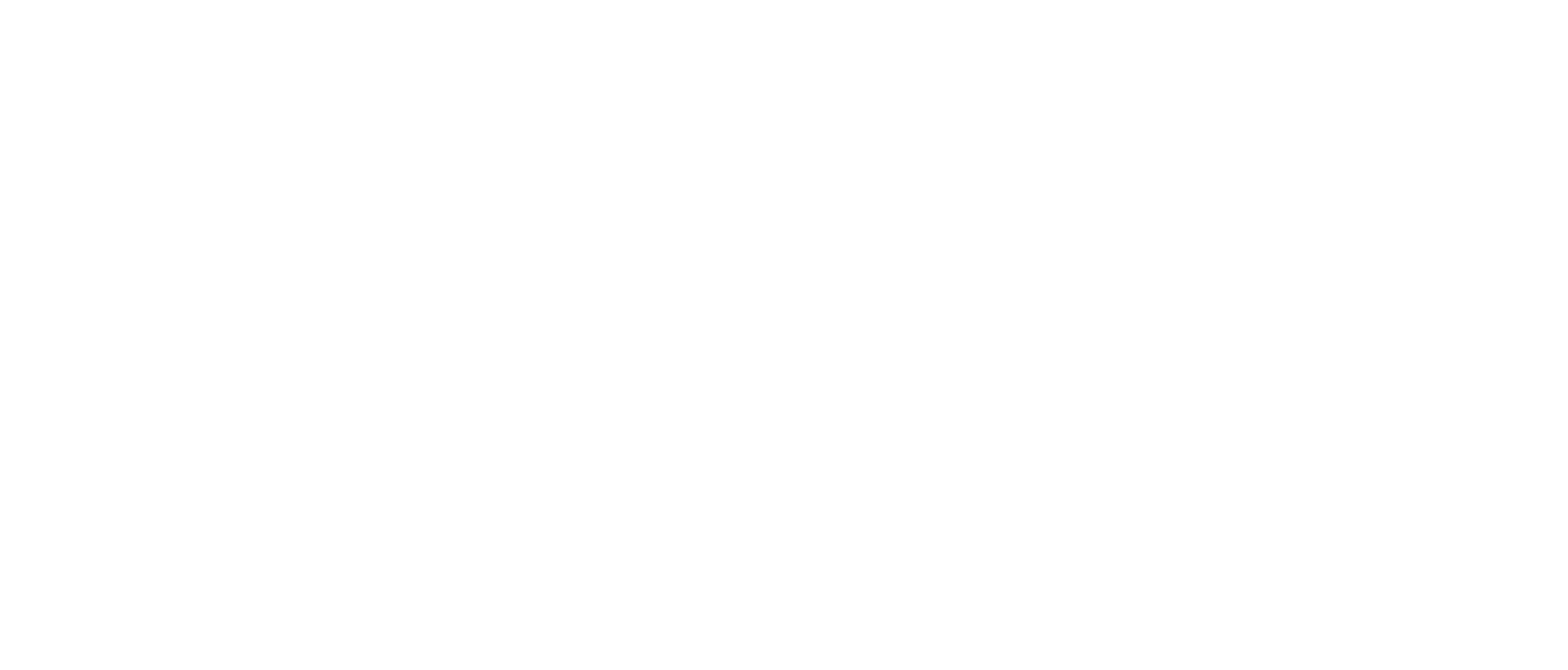
 Vers l'irréversibilité de la construction du porte-avions de nouvelle génération
Vers l'irréversibilité de la construction du porte-avions de nouvelle génération

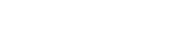
Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !