
La scène se passe en juillet dernier, lors du deuxième sommet de l'Université de la Ville de Demain, organisé par la Fondation Palladio. Les responsables de l'axe de la Seine expliquent comment, avec les infrastructures existantes, ils pourraient transporter quatre fois plus de marchandises pour un impact carbone très inférieur à celui des autres moyens de transport, mais qu'ils ne le font pas. Pourquoi ? La réponse sort comme un cri du cœur, « on ne nous aime pas ». La scène pourrait être répétée sur des centaines de sujets différents - on pourrait mais on ne le fait pas -, à la différence près que, cette fois-ci, la solution ne demande ni investissements conséquents ni sacrifices, car l'axe est aménagé depuis longtemps. Que fait-on généralement dans ces cas-là ? On fait appel à des sociologues pour analyser la perception des populations et à des artistes pour mettre en valeur les solutions proposées.
Mais n'est-ce pas faire les choses à l'envers ? C'est-à-dire partir des solutions techniques au lieu de commencer par les acteurs sociaux et ce qui fait sens pour eux afin de structurer un nouveau public ? À quoi servent des mesures si elles ne sont pas souhaitées ? Et comment, dans une démocratie, endosser ce qui ne rencontre pas une majorité ? La vraie question du transport fluvial n'est pas le peu de soutien qu'il reçoit aujourd'hui mais de comprendre comment, alors que les nations européennes se sont construites au XIXe siècle autour de leur réseau de fleuves et de canaux, elles s'en sont détournées à un moment pour lui préférer la route.
Une difficile transformation
Tout jeune État créé en 1870, l'Italie lance dès 1876 la réalisation de sa carte hydrographique, qui sera publiée entre 1888 et 1920. La Belgique publie son atlas des cours d'eau navigables et non flottables en 1884. Pour deux nations, qui n'existent pas tout à fait, il faut s'affirmer matériellement par la réalisation et le spectacle d'un réseau national fluvial. Quant à la France, on connaît les origines du Dessein napoléonien, formulé par le premier avec le projet de faire de Paris l'égal portuaire de Londres, et développé par le second à travers de grandes voies de circulation dont Paris est le nœud. Comment cette physicalité de la Nation est-elle devenue invisible pour être remplacée par une configuration matérielle plus rusée car les constructeurs de voitures, à la différence des compagnies de chemins de fer et de voies navigables, ne payent pas les infrastructures qu'elles empruntent, bénéficiant de ce fait d'un combat à armes inégales.
Il ne s'agit pas ici d'un point d'historien ni d'érudition, mais d'une question plus fondamentale : comment une société se transforme-t-elle ? Ou, pour le dire autrement, comment des formes héritées, matérielles et symboliques, se bloquent-elles ou, au contraire, sont-elles mises en mouvement grâce à leur réinvention ? Michel de Certeau a formulé la difficulté de ce processus car « on dirait qu'une société entière dit ce qu'elle est en train de construire avec les représentations de ce qu'elle est en train de perdre ». Et c'est bien ce qui nous arrive. Ce n'est pas la première fois, mais, cette fois-ci, l'enjeu est encore plus fondamental que celui de la puissance, car il s'agit de l'habitabilité même de notre pays. Et puis, rappelons que, historiquement, et à la différence d'autres pays, la France se transforme difficilement d'elle-même, et plutôt à la faveur des défaites militaires, des révolutions et des effondrements de régime. Le succès public et générationnel de la collapsologie fait écho à d'autres moments, comme les deux décennies qui précèdent la Révolution française, lorsqu'une société qui se pense bloquée rêve elle-même de sa propre destruction comme condition de sa régénération, et se passionne pour les volcans sous toutes les formes, picturales, littéraires, scientifiques et politiques. L'histoire ne se répétant jamais, remarquons que l'anxiété écologique ressemble plus aujourd'hui à une forme d'abattement et de sidération qu'à un déferlement d'actions et d'agitation.
Or, le blocage est ici produit pour partie par l'approche elle-même qui repose sur le couple « atténuation et adaptation ». Aucune société dans l'histoire n'a jamais été adaptée à son climat ni à son environnement. La nôtre devrait être la première à le faire ? Elle a donc peu de chance d'y parvenir. La raison est assez simple à comprendre : la forme d'une société tient d'abord à ce qui lui fait faire société, les liens familiaux et sociaux, les rites et le symbolique. Philippe Descola a longuement expliqué dans son petit livre L'écologie des autres pourquoi, mis à part une certaine branche de l'anthropologie nord-américaine, l'anthropologie rejette fortement le concept d'adaptation vu au mieux comme une forme de fonctionnalisme (une forme sociale répondrait à un problème écologique donné), au pire comme un retour du déterminisme (les conditions écologiques seraient la cause des caractéristiques sociales). L'infinie diversité des sociétés humaines existantes pour des mêmes caractéristiques physiques en est la traduction, sans compter l'habileté des groupes humains à jouer avec la complémentarité entre différents milieux pour ne jamais s'enfermer dans une niche écologique. Ceci étant dit, cet argument ne signifie pas du tout qu'il n'est pas possible à une société de faire des efforts pour atténuer son impact ni pour être moins inadaptée, mais simplement qu'il faut retourner la démarche. Au lieu de partir de ce qu'il faudrait faire pour répondre à telle situation climatique et environnementale, il faut partir de comment nous voulons faire société pour être plus en résonance avec toutes les entités qui peuplent le monde.
Qu'est-ce qu'une vie meilleure ?
C'est précisément ce que nous ne faisons pas, débattre collectivement de la société que nous voulons être, et force est de reconnaître que l'absence de vision des responsables politiques et des partis ne nous y aide pas. Plus de moyens sont consacrés à l'adaptation des villes aux changements climatiques qu'à se demander si nous voulons une métropolisation inéluctable ou plutôt défendre les échelles du territoire. Les méthodes agricoles concentrent les débats alors que la clé est la propriété de la terre au moment où le départ à la retraite de la moitié des agriculteurs d'ici dix ans va dessiner pour très longtemps la nature écologique de l'exploitation de la terre. Le débat sur les modes de transport ne prend pas en compte les raisons pour lesquelles la voiture est devenue si indispensable dans les territoires ruraux - la fermeture des services publics et des commerces - et péri-urbains - l'étalement urbain et le mitage encouragés par la construction neuve et les fonctions tertiaires.
Tout ceci explique pourquoi la transformation est le point aveugle de la durabilité et de la transition écologique, alors même que ces approches fixent le point auquel il faudrait parvenir. Il y a bien un point de départ - la situation actuelle et ses limites écologiques - et un point d'arrivée - ce qu'il faudrait faire pour ne pas dépasser ces limites -, mais rien entre les deux, ou plutôt une fiction de société, un storytelling qui n'accroche pas. Comme me le disait un jour un responsable écologiste à propos de la campagne présidentielle d'Eva Joly, « elle aurait fait la même en Norvège, les écologistes n'ont jamais rencontré la France ». Il n'est pas certain qu'ils y soient parvenus depuis, laissant donc toute leur place à des visions de la société française qui n'ont rien d'écologique.
Comme l'a fait remarquer Bruno Latour dans son Mémo sur la nouvelle classe écologique, il suffit de regarder le travail collectif qui a été accompli afin de penser le monde industriel, pour mieux mesurer l'absence de travail de fond sur la question écologique. Rien de comparable à ce que philosophes, historiens, sociologues, artistes, écrivains ont fait pour la question sociale. Reste donc la même interrogation sans réponse : comment le défi écologique peut-il nous permettre de mieux faire société en incluant l'ensemble des entités de la Terre ? Ou, pour le dire autrement, qu'est-ce qu'une vie meilleure ?
ACTUELLEMENT EN KIOSQUE ET DISPONIBLE SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

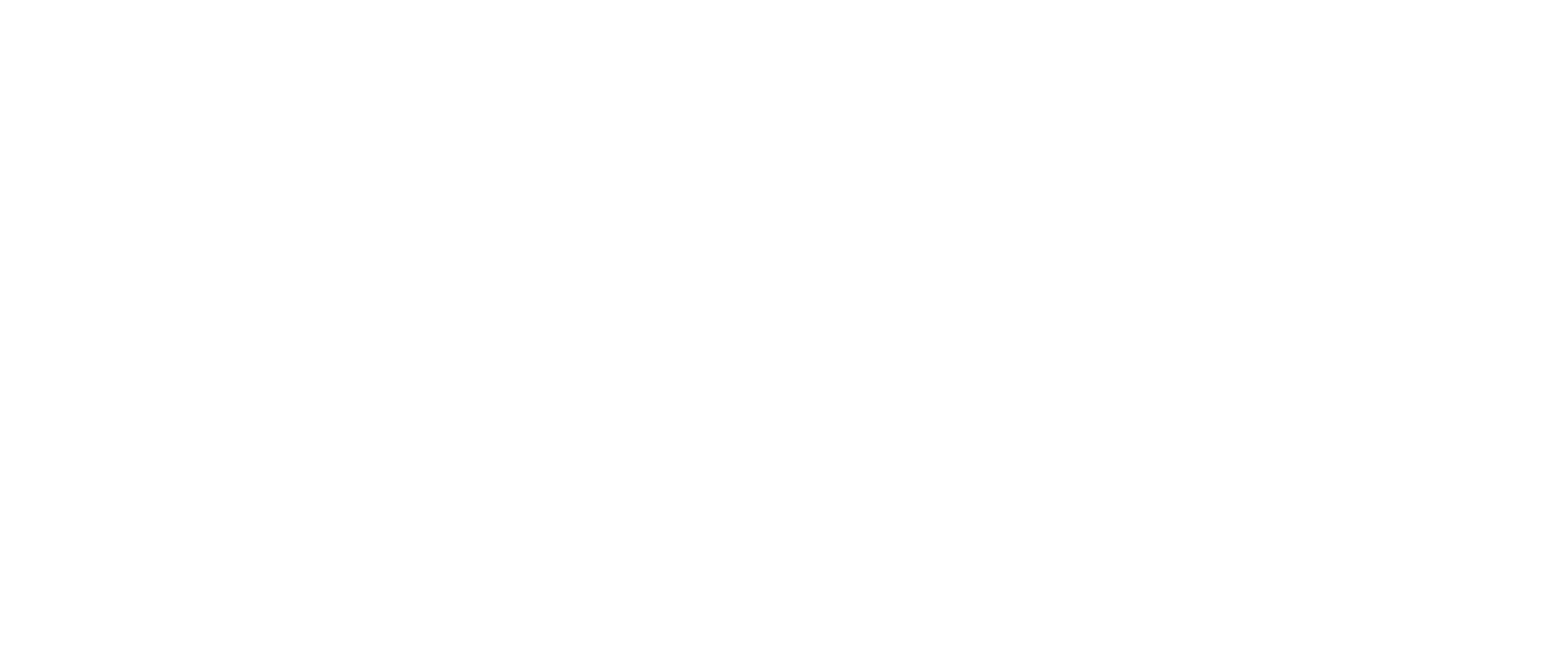

 Plan d'urbanisme à Paris : les professionnels dénoncent « une aberration », le premier adjoint d'Hidalgo leur répond
Plan d'urbanisme à Paris : les professionnels dénoncent « une aberration », le premier adjoint d'Hidalgo leur répond


Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !