
Avec la multiplication des épisodes de canicule, la ruée vers les climatiseurs que l'on a connu au cours des dernières années a toutes les chances de se reproduire. Elle n'est pas sans susciter quelques inquiétudes. Au train où vont les choses, la planète file même tout droit vers un « cold crunch », un choc du froid dans la langue de Molière, pour reprendre les termes de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE).
En cause, l'accroissement du parc de ces appareils voraces en énergie qui ont, en outre, une fâcheuse tendance à renvoyer un air bouillant dans les rues des villes. L'AIE a fait les comptes. Au rythme actuel, le parc mondial de climatiseurs devrait atteindre 5,6 milliards en 2050 contre 1,6 aujourd'hui jusqu'à consommer plus que les systèmes de chauffage. « Leur demande énergétique équivaudra à la demande électrique actuelle de la Chine », alerte l'Agence dans un rapport publié en 2018, toujours d'une actualité brûlante. Face à cette équation, les milieux scientifiques ne restent pas les bras croisés.
Une autre climatisation est possible
Depuis quelques années, une galaxie de laboratoires et de startups planchent sur des solutions de substitution. L'une des plus prometteuses repose sur la technologie dite du « refroidissement radiatif » connue depuis l'antiquité et documentée dès le 18ème siècle. Cette dernière consiste à refroidir des objets en renvoyant vers l'espace (où la température est d'environ -270°) la chaleur qu'ils émettent sous forme de rayonnement infrarouge. Le tout grâce à des matériaux réfléchissants. Dans sa forme la plus simple, c'est ce principe qui est utilisé lorsque des toits sont peints en blanc.
L'Université de Stanford aux Etats-Unis a été dans les premières à exploiter les propriétés de la technologie radiative pour rafraichir des bâtiments, avec un certain succès. En France aussi, des chercheurs transpirent sur cette thématique. Parmi les équipes en pointe, celle du laboratoire CIMAP (Centre de Recherche sur les MAtériaux et la Photonique) rattaché à l'université de Caen, au CNRS et au CEA.
Au terme de cinq ans de travaux, le CIMAP a breveté une surface réfrigérante de quelques micromètres, fruit de l'empilement de plusieurs couches minces de minéraux. Le logiciel permettant de modéliser l'ensemble a également été protégé. Le procédé a ceci d'intéressant qu'il a recours à des matériaux abondants. « Contrairement à Stanford, notre choix s'est porté sur des oxydes non critiques et non soumis à des tensions géopolitiques et tels que le silicium, l'aluminium ou le titane dans le but d'arriver à un assemblage durable et peu coûteux », détaille Julien Cardin, chef de projet.
Pour quelques degrés de moins
Les résultats en laboratoire se sont révélés très encourageants. Le laboratoire estime, en effet, être en capacité de rafraichir sensiblement un bâtiment dont le toit serait équipé de panneaux assemblés grâce à son procédé.
« Nous visons un abaissement de 10° de la température intérieure, moyennant une consommation d'énergie minime et pour une durée de vie de 25 à 30 ans équivalente à celle d'un panneau solaire », indique son concepteur.
L'intéressé juge possible une industrialisation à un horizon de cinq ans. D'ici là, il espère réunir les moyens pour fabriquer un premier démonstrateur « pourquoi pas avec l'aide d'un partenaire industriel ».
Les perspectives sont engageantes. Outre la climatisation de nos centres villes en surchauffe, le refroidissement radiatif pourrait trouver des applications dans le textile pour réguler la température corporelle mais aussi dans le camouflage d'engins de défense tels que les sous-marins. « Il peut aussi être utilisé pour rafraichir des data centers et pour sur-refroidir la surface des panneaux photovoltaïques qui perdent en productivité en période de fortes chaleurs », complète Julien Cardin. A méditer à l'abri du soleil.

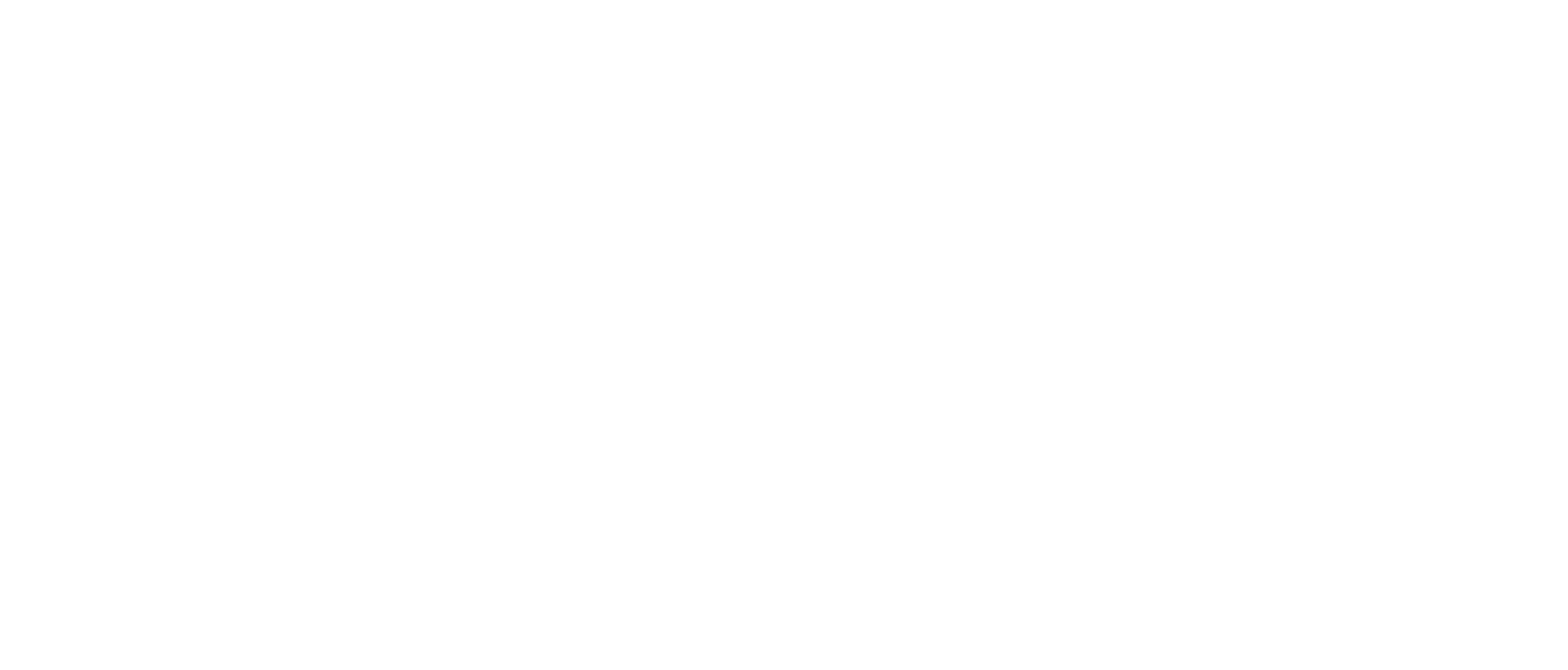
 Fraude aux prélèvements bancaires : pourquoi les données des clients français sont à la portée des escrocs
Fraude aux prélèvements bancaires : pourquoi les données des clients français sont à la portée des escrocs

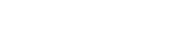
Sujets les + commentés