
Comme tous les grands utilisateurs d'hydrogène « gris », le site havrais du groupe norvégien Yara est sous pression. Implanté dans l'estuaire de la Seine depuis les années 60, il fait partie du club des 50 industriels avec qui Emmanuel Macron a conclu « un pacte de décarbonation ».
L'établissement produit, à partir d'un mélange d'azote et d'H2, 400.000 tonnes d'ammoniac qu'il livre aux autres entités du groupe pour la fabrication d'engrais. Septième plus gros émetteur français de gaz à effet de serre, il s'est engagé à réduire de 45% ses émissions d'ici 2030. Une promesse accueillie avec circonspection par le Réseau Action Climat.
« Les efforts se font attendre »
Dans un rapport paru il y a quelques jours, l'ONG pointe les maigres résultats de l'usine normande accusée de ne pas se montrer à la hauteur des aides publiques dont elle bénéficie. « L'ambition climatique du site reste pour le moment théorique et les efforts de décarbonation se font attendre », déplorent ses auteurs.
De fait. Les émissions de l'établissement n'ont guère varié à la baisse depuis 2013 hormis lorsque les prix du gaz ont atteint un pic. Elles ont même augmenté de plus de 35% entre 2019 et 2022 en raison d'un « fonctionnement à pleine capacité consécutif non pas à une dégradation mais à la résolution de problèmes techniques », justifie sa direction.
Electrification
Malgré cette hausse qualifiée « d'alarmante » par le Réseau Action Climat, Yara affirme tenir son cap. « Notre feuille de route est l'une des plus détaillées et l'une des plus abouties, assure à La Tribune Johan Labby, patron du site (et bientôt vice-président exécutif de Yara France). Nous allons réellement commencer à infléchir la courbe l'an prochain, lors du prochain grand arrêt technique ».
Raccordée depuis peu au réseau à haute tension de RTE, l'usine s'apprête en effet à entamer sa bascule vers l'électrification avec la mise au rebut en 2024 de l'une de ses deux chaudières au gaz. À la clef la promesse d'une réduction de 10% de ses rejets de CO2 dans l'atmosphère. « Des mesures d'économies d'énergie en complément permettront de réduire de 10 autres pourcents », fait valoir son directeur.
La capture du CO2, passage obligé
Reste que l'entreprise sera encore loin du compte. Pour franchir un palier supplémentaire, il faudra obligatoirement passer la capture et le stockage du CO2, explique Johan Labby. « C'est une solution de transition. À ce stade, il n'y a ni suffisamment de puissance électrique, ni suffisamment d'électrolyseurs (pour la production d'hydrogène ndlr) et de réseaux pour espérer faire sans ».
On ne s'étonnera donc pas de trouver Yara parmi les cinq membres fondateurs du consortium havro-rouennais dont l'objectif est de construire une infrastructure mutualisée de transport, de liquéfaction et de stockage du CO2. Le consortium qui associe également Air Liquide, Borealis(*), TotalEnergies et ExxonMobil ambitionne d'expédier dans des couches géologiques profondes quelque 3 millions de tonnes de CO2 en 2030 dont 200.000 (sur 750.000) pourraient provenir du site de Yara.
La technologie étant revenue en grâce au ministère de la transition énergétique, le projet vient d'obtenir une aide de l'Etat pour mener à bien les études détaillées mais l'investissement final promet d'être très lourd. « Sans un puissant soutien public, nous n'y arriverons pas », souligne Johan Labbby. Là est la question.
(*) L'usine rouennaise vient de changer de main à la faveur de la vente des activités azote du groupe Borealis au tchèque Agrofert.

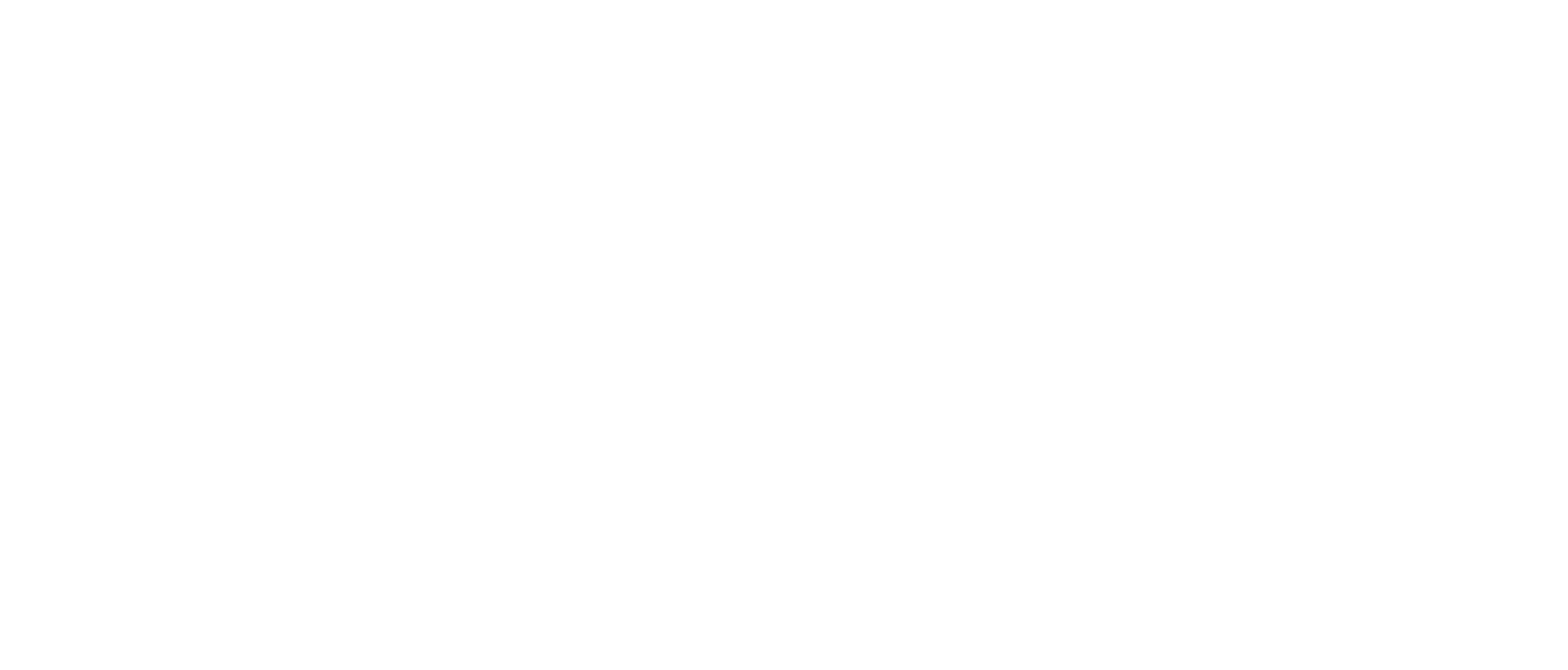
 Les « dark stores » sont bien des entrepôts, le Conseil d'Etat donne raison au gouvernement
Les « dark stores » sont bien des entrepôts, le Conseil d'Etat donne raison au gouvernement

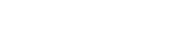
Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !