
La startup Legalstart a réalisé le 12 mars dernier une levée de fonds estimée entre 15 et 20 millions d'euros auprès du fonds Isai. Soit pratiquement autant que l'ensemble des legaltech en 2018. La startup fondée en 2013 propose aux TPE-PME, artisans et micro-entrepreneurs d'effectuer en ligne des démarches juridiques, administratives et comptables. Par exemple, créer son entreprise, déposer une marque ou encore recouvrer des impayés. La société se dit rentable depuis sa création et revendique plus de 100.000 entrepreneurs accompagnés et 15.000 abonnés.
Cette annonce confirme le dynamisme des legaltech, ces startups qui utilisent les outils numériques et l'intelligence artificielle pour faciliter l'accès aux décisions de justice, trouver un avocat en un coup de fil ou rédiger son testament en ligne. Une expansion récente favorisée par les articles 20 et 21 de la loi d'Axelle Lemaire pour une République numérique du 7 octobre 2016, qui institue un régime spécial de mise à disposition au public de la plupart des décisions de justice.
« Nous sommes face à un big data judicaire. Il y a trop de données et personne n'arrive à les comprendre ni les rendre intelligibles. Les plateformes comme la nôtre peuvent aider particuliers et professionnels du droit à s'y retrouver », estime Nicolas Bustamante, président de Doctrine, moteur de recherches juridique qui se présente comme le Google du droit.
Selon le baromètre 2018 des legaltech françaises, une étude réalisée par Wolters Kluwer et Maddyness*, le montant des levées de fonds des legaltech a bondi en 2018 de + 92,2% à 24,6 millions d'euros, contre 12,8 millions en 2017. Une hausse spectaculaire à relativiser, puisqu'un seul acteur, Doctrine (dont le nom signifie l'ensemble des travaux juridiques destinés à exposer ou à interpréter le droit), pèse 40% de ce montant, avec les 10 millions levés en juin 2018. De plus, les legaltech restent une niche dans le paysage français des startups : les fintech ont levé l'année dernière 162 millions et Deezer 161 millions à lui seul.
Petit segment en plein boom, ces jeunes pousses intéressent néanmoins les investisseurs, qui vont pouvoir continuer à y injecter de l'argent puisque 71,4% d'entre elles n'ont pas encore levé de fonds. En 2018, plus de la moitié des investisseurs sont des fonds d'investissement et des business angels, alors qu'en 2017 il s'agissait principalement de professionnels du droit. Les grandes entreprises commencent à lorgner sur ces nouveaux arrivants dans l'univers encore très cloisonné de la justice, puisque 63,5% des legaltech ont signé un partenariat avec un grand groupe ou envisagent de le faire.
Legaltech contre monopoles
Ce marché d'une centaine de jeunes pousses est très centralisé (66,7% sont en Île-de-France). Les services proposés sont principalement la mise en relation (19%), la création d'actes (17,5%), la création et la gestion d'entreprises (15,9%) et la digitalisation des processus métier (12,7%). Soit des services classiques mais propulsés par des technologies innovantes, le Web (60,3%) et l'IA (19%).
En France, le droit est un secteur très contrôlé. Trop même pour un tiers des legaltech, qui se plaignent d'être bloquées dans leur développement par des contraintes réglementaires : l'open data qui n'est toujours pas généralisé, l'absence de reconnaissance de la signature électronique par l'administration ou la réticence des professions réglementées (avocats, notaires, huissiers) à partager leurs informations.
Comme d'autres secteurs qui ont vu les plateformes numériques venir bousculer leurs habitudes tout en gagnant rapidement des parts de marché - les taxis avec les VTC, l'hôtellerie avec Airbnb et Booking.com, la banque avec les fintech -, l'univers du droit et ses monopoles séculaires (avocats, notaires, huissiers), dont certains remontent à l'antiquité, ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de ces jeunes sociétés plus agiles qui viennent leur disputer une part d'un gâteau plutôt conséquent.
Le notariat, par exemple, emploie selon le Conseil d'État plus de 57.000 personnes qui établissent chaque année 4 millions d'actes authentiques et traitent plus de 600 milliards d'euros de capitaux. Les 70.000 avocats en exercice ont eux généré 4,6 milliards d'euros de revenus (en 2015, source Conseil national des barreaux). Quant aux 3.251 huissiers (qui vont devenir en 2022 des commissaires de justice après fusion avec les commissaires-priseurs) ils font travailler 10.000 personnes, ont signé 11 millions d'actes en 2018 et recouvré 8 milliards d'euros. De quoi susciter les convoitises des nouveaux acteurs du droit 2.0. « Ce que l'on nomme parfois "l'uberisation" du droit est un phénomène protéiforme et diffus, qui touche directement les professions juridiques et, notamment, celle des avocats et des notaires », confirme le Conseil d'État. Mais contrairement aux taxis ou aux hôtels, les avocats, notaires et huissiers possèdent des statuts protecteurs qui empêchent les legaltech de proposer aux justiciables, particuliers ou professionnels, le même type de services.
« Les legaltech ne peuvent pas faire n'importe quoi, comme le conseil, réservé aux avocats, ou certains actes que seuls les notaires ou les huissiers sont autorisés à rédiger. D'où les tensions entre ces professions et certaines startups, comme Doctrine et DemanderJustice.com, accusée par les avocats de faire du conseil », analyse Gaëlle Marraud des Grottes, rédactrice en chef du site actualitesdudroit.fr.
Les avocats déboutés
Le Conseil national des barreaux (CNB) et le Conseil de l'ordre des avocats de Paris ont assigné DemanderJustice.com, qui met à la disposition de ses clients des formulaires-type de mise en demeure et permet de saisir, sans recourir à un avocat, une juridiction de proximité, un tribunal d'instance ou un conseil des prud'hommes. Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris les a déboutés en janvier 2017. La cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en novembre 2018, considérant que la legaltech « n'effectue pas d'activité de représentation en justice réservée aux avocats, ni de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique ». Mais le Conseil national des barreaux ne baisse pas les bras et vient d'annoncer qu'il allait se pourvoir en cassation.
Doctrine, elle, a eu maille à partir en juin 2018 avec les avocats sur la pratique du « typosquatting », soit la modification d'une ou plusieurs lettres d'un nom de domaine pour utiliser la confusion à son profit. Un crawler (robot d'indexation) allait chercher auprès des greffes des informations sur les décisions de justice via des fausses adresses mail ressemblant fortement à celles de cabinets d'avocats ayant pignon sur rue ou d'universités. La startup a reconnu son erreur, cessé cette pratique et recruté trois juristes pour éviter les récidives. Une autre polémique visant Doctrine a eu lieu avec Infogreffe, le Groupement d'intérêt économique (GIE) des greffiers des tribunaux de commerce, qui possède des informations sensibles sur la situation financière, les activités et les processus de fabrication des entreprises. Doctrine a conclu avec cet organisme un partenariat qui lui a donné accès à deux millions de documents. Un coup de maître quand on sait que seule une infime minorité des décisions de justice est accessible en ligne.
« Tous les éditeurs juridiques essaient depuis longtemps d'avoir accès à ces décisions. Et tout à coup, Doctrine arrive et signe un partenariat avec le GIE Infogreffe. La réaction des autres acteurs a été immédiate », explique Gaëlle Marraud des Grottes. Face à la controverse, Infogreffe a dénoncé le partenariat avec Doctrine.
Concernant ces frictions avec les professionnels du droit, Nicolas Bustamante reconnaît avoir secoué le milieu des éditeurs juridiques, dominé par trois acteurs (LexisNexis, Dalloz et Wolters Kulwer). Mais pour les avocats, il rappelle « qu'ils sont nos clients et que beaucoup sont abonnés à notre service. Nous aidons les professionnels du droit, mais en aucun cas nous ne cherchons à les remplacer ». Un avis partagé par Mathieu Davy, avocat et créateur de Call A Lawyer :
« Plus de mille décisions de justice sont produites par jour ! La recherche d'informations est onéreuse pour les professionnels. Les initiatives d'open source comme Doctrine sont positives. Derrière la polémique, il y a un vrai sujet politique qui est un accès plus simple et moins coûteux aux millions de décisions de justice. »
Un portail pour l'open data
Les greffes des tribunaux d'instance et de grande instance, qui traitent les affaires civiles, traînent les pieds pour fournir les documents demandés par les legaltech. Doctrine a interpellé la Cada (Commission d'accès aux documents administratifs) et celle-ci a rendu deux jugements en sa faveur qui enjoignent les greffes, dont celui du TGI de Paris, à lui communiquer les décisions de justice. En décembre 2018, la cour d'appel de Paris, puis celle de Douai en janvier dernier, ont confirmé ce droit d'accès aux décisions de justice.
Le « Doctrinegate », affaire classée ? Pas si sûr, car le ministère de la Justice confirme à La Tribune avoir introduit un référé-rétractation (demande à la juridiction qui a rendu la décision critiquée de l'annuler et de statuer à nouveau) devant la cour d'appel de Paris. Une audience est prévue en mai. Le feuilleton « legaltech contre administration judiciaire » continue. Si le droit garantit désormais la publicité des décisions de justice, il doit aussi assurer la protection des données à caractère personnel. Or, le numérique a totalement chamboulé cette notion de « privacy » en jargon numérique. « Le législateur a tranché ce débat sur l'accès massif aux décisions de justice en exigeant que la puissance publique mette à disposition ces décisions mais pseudonymisées pour protéger les personnes », explique Thomas Andrieu, directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice.
Problème, dans les tribunaux de grandes cours d'appel, il n'existe pas de bases centralisées des décisions. La transmission intégrale de ces données aux particuliers ou aux startups qui en font la demande désorganise l'activité de greffes déjà bien occupés et en sous-effectifs (1.400 postes vacants), qui opposent aux legaltech le motif de « bonne administration de la justice » pour justifier la non-transmission des documents. Pour soulager les greffes tout en assurant une diffusion des décisions de justice garantie par la loi, le ministère de la Justice est en train de construire depuis 2015 une infrastructure numérique consacrée à l'open data nommée Portalis (du nom d'un des rédacteurs du code civil), le portail des justiciables et des magistrats. « Nous allons déployer les premiers modules en fin d'année, en commençant par les conseils des prud'hommes. Les modules pour les TGI et les tribunaux de commerce seront disponibles l'année prochaine », précise Thomas Andrieu.
L'article 19 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, qui a été publiée le 24 mars au Journal Officiel, précise que « les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique » mais que « les tiers peuvent se faire délivrer une copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique ». Autrement dit, ce que réclament les legaltech.
« Il y a encore beaucoup de travail à faire pour trouver les meilleurs logiciels d'anonymisation du marché », estime le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice, qui veut « parvenir à un équilibre entre la transparence dans la diffusion des données et la protection de la vie privée ».
Des notaires méfiants
Les notaires, autre profession réglementée en situation de monopole, a vu l'émergence de ces startups numériques d'un œil soupçonneux. Les legaltech n'allaient-elles pas casser les prix, voire les remplacer sur certaines opérations ?
« Les notaires avaient l'habitude de tout faire par eux-mêmes. Quant les legaltech sont arrivées, leur premier réflexe a été de se méfier de ces startups qui apportent des services supplémentaires, comme suivre l'avancement de son dossier en ligne par exemple », explique Nicolas Tissot, directeur du numérique et des systèmes d'information du Conseil supérieur du notariat.
Une partie de ces legaltech, comme FoxNot, MyNotary ou Testamento, fournissent des outils plus intuitifs aux clients sur les démarches qui relèvent du monopole. « La bonne approche est de coopérer avec elles d'autant que ces dispositifs sont souvent collaboratifs : le client peut inviter son notaire dans le processus. Mais pour la promesse de vente immobilière, par exemple, qui peut être faite sous seing privé, il n'est pas obligé de le faire. Les notaires ont donc tout intérêt à travailler avec ces startups. » Le Conseil supérieur du notariat a mis en place en novembre 2018 la charte pour le développement éthique notarial, qui vise à formaliser les engagements que vont prendre les startups.
« Nous sommes en train de transformer cette charte en label, plus contraignant. Par exemple, il sera interdit de revendre les fichiers clients et il faudra respecter des normes d'interopérabilité avec nos logiciels », ajoute Nicolas Tissot. En contrepartie, les notaires fournissent une API (interface de programmation) pour accéder en temps réel à l'annuaire des notaires. Un label qui devrait apporter un avantage commercial aux legaltech qui l'auront accepté. Le plus compliqué sera la circulation des dossiers d'un point A à un point B entre les offices notariaux et les legaltech. Cette transformation culturelle sera longue, car le notariat n'est pas habitué à s'ouvrir vers l'extérieur.
« Il ne faut rien exclure. Avec l'intelligence artificielle, les actes pourraient être produits à 95% par des outils automatisés. Mais il faudra de plus en plus d'expertise pour les contrôler », conclut Nicolas Tissot.
Comme bon nombre d'autres secteurs qui ont vu le numérique disrupter leur business, les professionnels du droit n'ont d'autre choix que de s'adapter à l'arrivée de ces nouveaux concurrents s'ils ne veulent pas se faire « uberiser ».
___
(*) Questionnaire adressé par mail entre juin et décembre 2018 à 101 startups dont 63 correspondaient aux critères.
___
ENQUÊTE LEGALTECH
- Partie I : "Les legaltech à l'assaut de la forteresse justice"
- Partie II : Ces avocats "geek" plaident en faveur du numérique
- Partie III : La justice prédictive, avancée ou danger ?

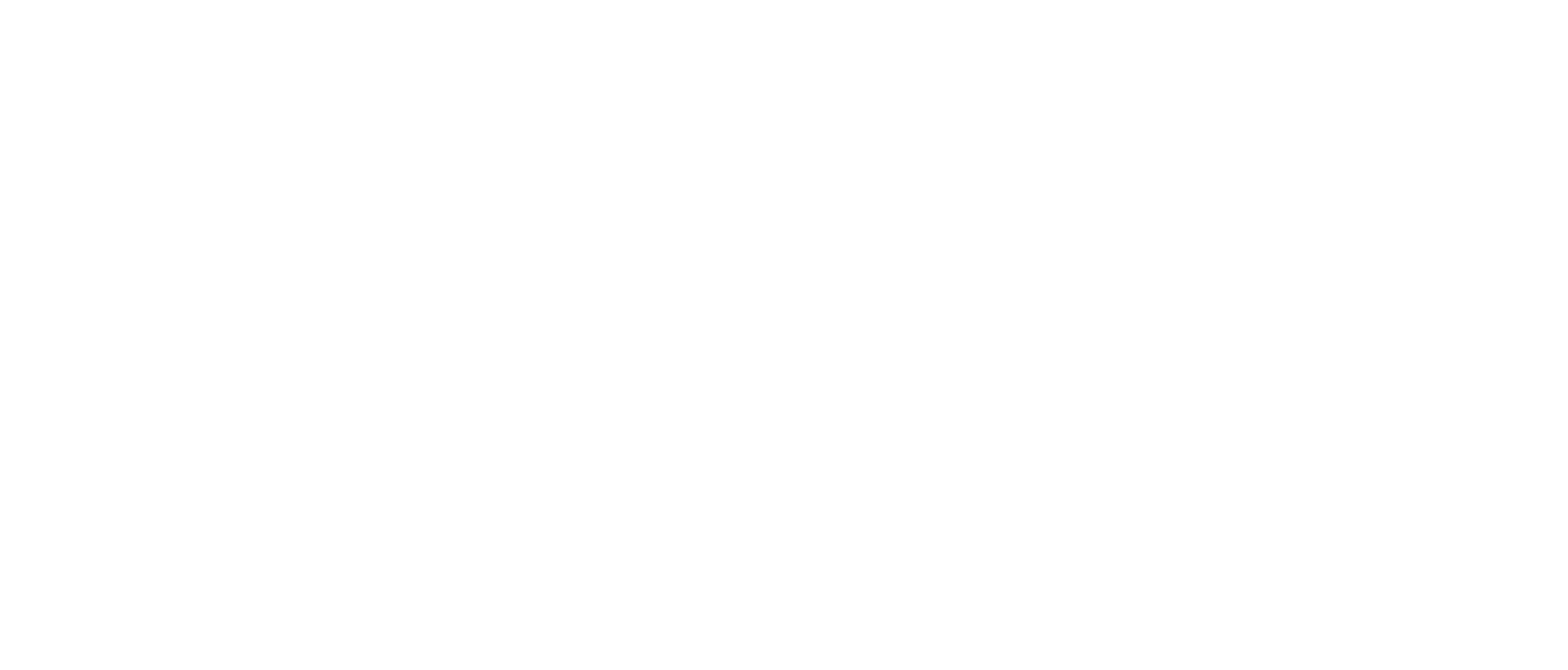
 Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville
Nucléaire : après 12 ans de retard, EDF va enfin mettre en service l’EPR de Flamanville

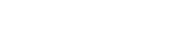
Sujets les + commentés