
Alors qu'il est perçu comme réaliste, un chef d'entreprise est en fait quelqu'un qui a des visions. Ou plus exactement : une vision. Et c'est avec cette vision qu'il peut embarquer tout le monde derrière lui, pour donner corps à cette vision. Cet état de fait est rendu encore plus décisif dans le cadre de l'innovation et de la transformation numérique.
Car cette dernière transforme le business, bien sûr. Mais, au préalable, cette véritable thérapie pour l'entreprise exige aussi du dirigeant une profonde transformation psychologique. En effet, transformer numériquement son entreprise suppose souvent de se transformer soi-même. Les schémas de pensée, les habitudes, les méthodes, tout doit pouvoir être remis en question du jour au lendemain, tant l'accélération technologique et l'âpreté de la compétition sont fortes. Il faut en permanence être d'une certaine manière capable de « disrupter d'avec soi-même ». Réunir les conditions de l'innovation suppose de réussir à s'appliquer à soi-même, et à son cadre de pensée, le processus de destruction créatrice cerné par Schumpeter. Il s'agit en quelque sorte d'accepter de « se détruire soi-même pour se créer soi-même ».
Aussi, un dirigeant doit-il aujourd'hui être à même de lâcher prise de façon très rapide pour pouvoir s'adapter en permanence. Ceci est très compliqué pour de nombreux dirigeants, parce que dans leur esprit diriger équivaut à avoir des certitudes - et à donner à ses équipes la confiance qui leur vient de la perception de ces certitudes. Le chef d'entreprise est a priori le sachant, le porteur de la certitude. Or, les certitudes sont aujourd'hui ce qui est sans doute le plus dangereux puisque la certitude conduit tout droit à l'ennemi de l'entreprise et de la croissance : la fixité.
Une nouvelle sagesse
L'entreprise doit être agile. Et la seule certitude qui devrait désormais prévaloir dans l'esprit de celle ou de celui qui la dirige est que toute certitude est faite pour être dépassée ou remise en question, ainsi que l'exige la logique de l'innovation.
Il convient donc d'adopter la certitude que, dès que l'on pense que ce que l'on sait peut durer, on est potentiellement ou pour partie dans l'erreur. En effet, ce savoir, même s'il est à la pointe de l'évolution, quel que soit le secteur de l'industrie ou des services considéré, est destiné à être remplacé ou modifié à moyen ou (très) court terme par des vagues d'innovation successives sans cesse plus rapprochées. Là où autrefois la sagesse équivalait à occuper mentalement la position la plus stable possible - être sage consistait à ne pas se laisser entrainer dans la spirale du changement, lié notamment aux passions -, la nouvelle sagesse est de se mettre soi-même dans une position constante d'équilibre instable.
Dans le cadre ultra-mouvant du monde numérisé, cette attitude produit, non plus des blocages ou des dysfonctionnements comme dans le modèle antérieur, mais des effets de croissance, de nouveauté. Sortir de la fameuse « zone de confort », rompre avec les habitudes, le savoir et la certitude sont aujourd'hui les conditions, sinon la garantie, du succès.
Mais cette posture - cette nouvelle sagesse - est difficile à atteindre puisque nombreux sont les freins qui la contrarient.
La malédiction du savoir
Un dirigeant aux prises avec la transformation nemérique est confronté à des freins multiples. Certains viennent du marché, de la concurrence, ou de l'état géopolitique du monde. Mais d'autres sont internes à la culture d'entreprise, voire au système de pensée du chef d'entreprise lui-même, à sa psychologie. Et, bien que « subjectifs », ils sont susceptibles d'impacter objectivement le résultat du compte d'exploitation de la société, son image, la satisfaction de ses clients, sa position d'influence sur son marché. Bref, le subjectif agit de façon directe sur l'objectif aussi bien que sur les objectifs.
Parmi tous ces freins, l'un des plus notables est le savoir lui-même qui, loin d'être toujours un atout, peut fonctionner comme un cache empêchant de voir ce qu'il se passe. Comme l'expliquent Andrew McAfee et Erik Brynjolfsson, deux des directeurs du Center for Digital Business du MIT, dans un livre remarquable*, « Le savoir peut fonctionner comme une malédiction ».
Prenant l'exemple du passage de la vapeur à l'électricité dans l'industrie des années 20, les auteurs montrent comment les entreprises les plus puissantes de leur époque, pourtant dirigées par des professionnels intelligents et compétents, étaient incapables de voir ce qui était en train d'arriver.
Pourquoi ? La réponse prend la forme d'un intéressant paradoxe :
« Ils ne pouvaient pas voir parce qu'ils connaissaient très bien leur sujet et parce qu'ils regardaient la situation du point de vue de leur réussite ».
Ceux qui ont alors disparu n'ont rien vu venir, car ils avaient devant les yeux un écran qui leur bouchait la vue. Et cet écran était celui qui semblait le moins susceptible de les tromper ou de les abuser : c'était celui formé par leur succès, leur réussite ou leur puissance. « L'arrogance » qui venait de leur certitude d'avoir raison leur coûta cher.
« C'est leur succès qui devint la cause de leur défaite, leur réussite, celle de leur échec, leur domination et leur maîtrise, celle de leur effondrement. »
La réticence à adopter une nouvelle technologie ou une nouvelle source d'énergie dont la supériorité leur apparaissait comme marginale reposait sur une impossibilité de renoncer à une énorme quantité de savoir et de savoir-faire qu'ils considéraient comme leur capital le plus précieux.
Ainsi, bloqués dans leurs certitudes, ils ne pouvaient pas « comprendre le potentiel non réalisé et l'évolution probable d'une technologie nouvelle* ». Ils étaient alors incapables de challenger leurs fondamentaux pour s'adapter à une nouvelle réalité émergente. Leur position dominante les a persuadés que le fait d'être bons dans leur domaine n'allait pas être mis en question à moyen terme. C'est ainsi qu'ils ont disparu. Cette difficulté qui touche plus spécifiquement des entreprises puissantes et bien gérées se nomme « la malédiction du savoir » ou encore « le biais du statu quo ». McAfee et Brynjolfsson prophétisent que ceux qui ne s'inscriront pas intelligemment dans la transformation numérique, et qui « s'accrochent au statu quo technologique et organisationnel d'aujourd'hui (...) connaîtront le même sort* ».
L'écran qui rendait aveugle à la réalité de la situation était formé par l'orgueil de penser savoir. Cet orgueil est bien plus dangereux au temps de la transformation numérique et de l'innovation tous azimuts. Un tel aveuglement menace tout à fait se reproduire de nos jours pour beaucoup de chefs d'entreprise, d'autant plus que la révolution numérique avance à une vitesse bien plus grande que celle de l'électricité.
Dans un tel contexte, penser que l'on peut s'adosser durablement sur le savoir que l'on a acquis est bien téméraire. Croire aujourd'hui que l'on sait quelque chose revient à se replier sur des certitudes, et se mettre soi-même en danger. En effet, dans le monde de l'innovation, « dès qu'un savoir se constitue, il est déjà potentiellement périmé ».
Ainsi, la remise en question permanente est une nécessité impérieuse. Elle est même vitale. Il s'agit donc surtout d'une révolution mentale, une révolution culturelle. Il faut apprendre à voir autrement, et ensuite à faire perdurer cette nouvelle manière de voir, ne pas oublier en route que le présent est condamné à être le passé d'un futur qui arrive de plus en plus vite.
Il faut donc accepter de penser que l'on ne sait jamais vraiment quelque chose, et accueillir le déséquilibre qui en découle (celui de la pensée comme de l'organisation) comme une force positive, et pas comme un facteur de destruction. Aujourd'hui plus encore qu'il y a un siècle, celui qui pense qu'il sait est foutu. Tout simplement parce que ce qu'il sait sera ubérisé aujourd'hui ou demain - ou dans cinq minutes.
Cela oblige à la fois à la modestie et à l'efficacité. Qui s'en plaindrait ?
--
[*] Andrew McAfee et Erik Brynjolfsson, [Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future, New York, Norton & Company, 2017], Des Machines, des plateformes et des foules, Maîtriser notre avenir numérique, Paris, Odile Jacob, 2018.
_____
Par Alain Conrard, auteur de l'ouvrage "Osons ! Un autre regard sur l'innovation", un essai publié aux éditions Cent Mille Milliards, en septembre 2020, CEO de Prodware Group et le Président de la Commission Digitale et Innovation du Mouvement des ETI (METI) (LinkedIn).

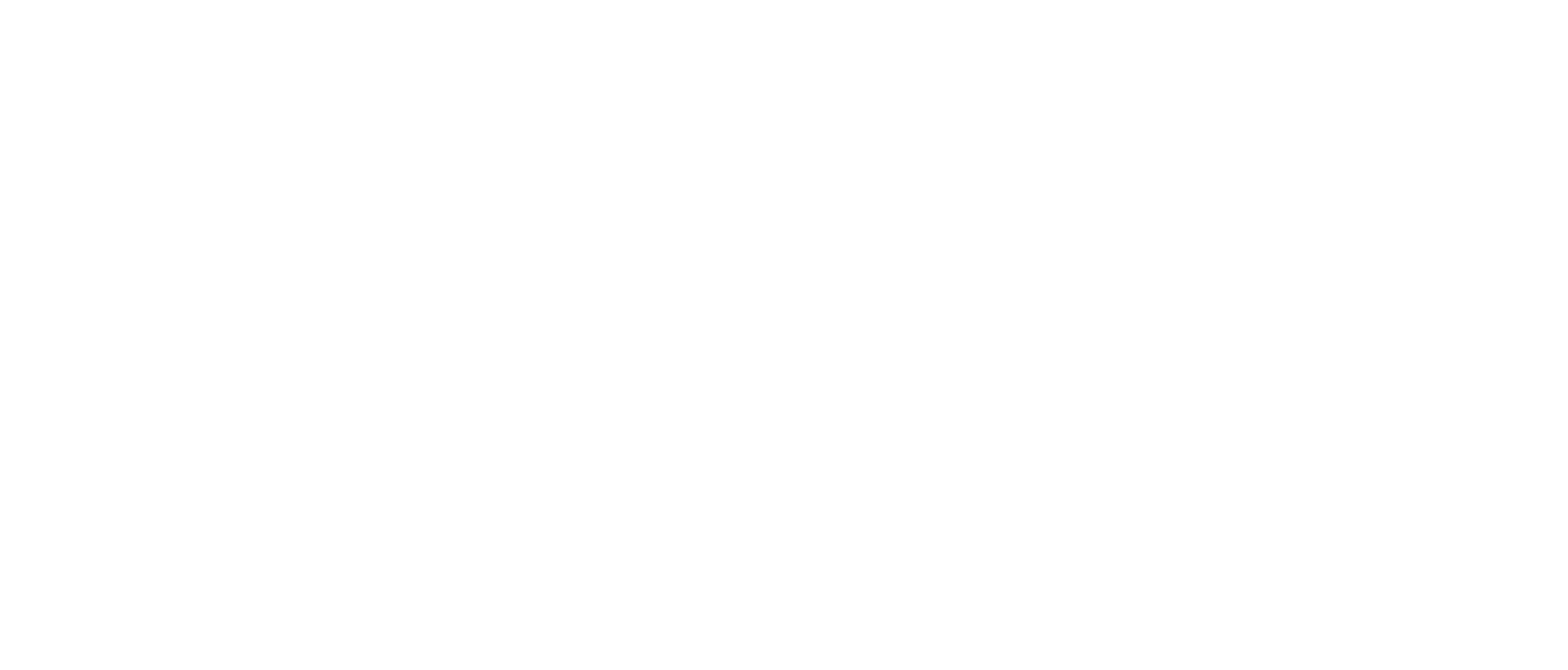
 « C’est une décision difficile, mais nous avons décidé d'arrêter des "Chiffres et des lettres" » (Stéphane Sitbon-Gomez, France Télévisions)
« C’est une décision difficile, mais nous avons décidé d'arrêter des "Chiffres et des lettres" » (Stéphane Sitbon-Gomez, France Télévisions)

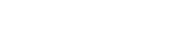
Sujets les + commentés