Alors que les chefs de file du monde des affaires se réunissent à Davos, un changement de paradigme très en retard sur la politique monétaire se dessine lentement, en vue de subordonner l'optimisation de l'inflation à l'optimisation de la croissance.
Dans ce que certains appellent un « moment de Volcker inversé », le Président de la Réserve fédérale américaine Ben Bernanke a indiqué un objectif du taux de chômage à 6,5%, parallèle à son objectif d'inflation. Le nouveau gouvernement du Japon a proposé un objectif d'inflation minimum. Et Mark Carney, le prochain gouverneur de la Banque d'Angleterre, a affirmé « [qu']il ne pouvait pas y avoir de situation plus favorable pour l'objectif du PIB nominal. » En outre, la Chine s'est engagée à doubler son revenu national moyen par habitant d'ici 2020.
Malheureusement il a fallu sous-estimer pendant quatre ans l'impact de l'austérité budgétaire et un déficit chronique de la demande (avec un potentiel d'approvisionnement de l'économie qui commence à diminuer en conséquence) pour nous mettre d'accord sur la ciblage d'une croissance que le G-20 avait prévue en 2009.
Alors pourquoi, alors que le changement se matérialise, y a-t-il si peu d'optimisme à propos de la croissance en ce début d'année 2013, et pourquoi entend-on autant parler d'une « décennie perdue » ? La réponse est que le problème de la basse croissance exige plus qu'un changement dans les politiques monétaires nationales : il nécessite également un accord pour coordonner la croissance mondiale, et cette solution n'a pas été trouvée.
Naturellement une part du pessimisme résulte de la faiblesse de l'Europe, qui a seulement convenu que la Banque Centrale Européenne serait le prêteur en dernier recours. Et l'autre part provient d'avoir reconnu des limites à l'assouplissement quantitatif. Nous sommes en partie victimes d'une prophétie de pessimisme qui s'auto-accomplit : la perspective d'un surendettement nous condamne au chômage et à la stagnation, et ne nous laisse rien à gagner si nous tentions d'employer la relance budgétaire ou l'innovation financière pour la contrer.
Mais je crois qu'il existe une raison plus fondamentale à l'empêchement d'une croissance plus rapide. En d'autres termes, il y a dix ans, les Etats-Unis pouvaient proposer une relance mondiale. Peut-être que dans dix ans, les dépenses de consommation de l'Asie viendront combler ce vide. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies, aucune économie ne peut à elle seule faire avancer l'économie mondiale.
Depuis 150 ans, jusqu'en 2010, l'Occident (les Etats-Unis et l'Europe) étaient responsables de la majorité du rendement, de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de la consommation mondiale. Nous sommes à présent dans une ère de transition, où le reste du monde externalise la production, l'industrie, le commerce et les investissements en Europe et aux Etats-Unis, mais sans pour autant externaliser la consommation.
Ce déséquilibre signifie que les producteurs de la plupart des biens et des services sont en dehors de l'Occident, mais comptent sur les consommateurs occidentaux pour absorber leur production. Jusqu'à ce que la transition soit terminée, nous dépendons les uns des autres : personne ne peut réussir tout seul. Mais en l'absence de coordination mondiale, le monde est coincé dans une impasse et se comporte selon une déclinaison à l'échelle mondiale du « dilemme du prisonnier » : un monde dans lequel aucune économie principale ne peut réussir seule, mais dans lequel pourtant aucune économie ne fait assez confiance à aucune autre pour tenter une coopération et une coordination de ses actions.
Les objectifs de PIB nominaux représentent peut-être une avancée nécessaire, mais ils ne sont pas une réponse suffisante à une croissance mondiale lente. Même les plus audacieuses initiatives nationales peuvent échouer, non pas parce que l'optimisation de la croissance économique est une mauvaise approche, mais parce qu'il n'existe aucune manière de maintenir les niveaux plus élevés de croissance dont nous avons besoin sans une meilleure coordination globale. En l'absence d'un contexte mondial favorable, tout changement purement national touchant la politique économique (comme les objectifs en matière d'emploi) aura des avantages limités (et pourra discréditer la poursuite de plans nationaux pour l'emploi).
Donc le vide politique fondamental d'aujourd'hui, auquel il s'agit bel et bien de trouver un remède, réside dans la réticence des gouvernements nationaux à envisager un leadership mondial. Certains cyniques pourraient arguer du fait qu'il s'agit d'une prise de décision nationale dysfonctionnelle reproduite à un niveau mondial. Mais il existe une explication plus persuasive : personne ne souhaite faire face à un protectionnisme généralisé.
Naturellement le nationalisme économique ne fait aucun doute aux Etats-Unis, où la nervosité au sujet de la Chine et l'hostilité envers des accords mondiaux sont patents. Mais l'Europe connaît à son tour une vague d'opposition à l'immigration et une résistance croissante à sa volonté de venir en aide aux pays les plus pauvres.
En effet, il est plus sûr pour les politiciens de proposer le contraire d'une vision mondiale : renationaliser chaque problème économique et tous les attribuer aux erreurs de l'opposition nationale. Ainsi pendant quatre ans les déficits budgétaires, qui doivent être naturellement traités par des plans à long terme de réduction de la dette, ont pratiquement monopolisé le débat sur la politique économique en Europe et aux Etats-Unis, aux dépens de discussions constructives sur la croissance, l'emploi et le commerce.
Pour le dire sans détours, il est plus salutaire politiquement pour un politicien d'opposition de prétendre que les problèmes de son pays sont auto-infligés, causés par la dilapidation nationale, et qu'ils ont peu de rapport avec les faillites financières mondiales. Les citoyens seront excusés d'en conclure que la crise financière mondiale de 2008 n'avait rien à voir avec un effondrement mondial des opérations bancaires, et qu'elle a été entièrement provoquée par quelques gouvernements nationaux dépensiers qui ont accumulé les déficits.
En conséquence, des millions de personnes sont sans emploi inutilement et des millions d'autres font face à la diminution de leur niveau de vie. L'économie est désormais mondiale, mais la politique reste locale. Les défis mondiaux se développent, alors que les ordres du jour des sommets internationaux se resserrent, et renforcent le mythe selon lequel leurs débats sont sans objet.
Mais alors même que le sentiment protectionniste empêche la coopération, l'enjeu de la croissance mondiale attend une solution. Cela commence par le fait de reconnaître la nécessité de mobiliser les forts excédents de l'épargne et une importante capacité inutilisée, et de reconnaître aussi la demande croissante des consommateurs de la classe moyenne émergente en Asie comme la clé de l'expansion. Pourtant la Chine, dont les consommateurs peuvent parfaitement absorber des importations de l'Occident, veut rester circonspecte avant d'amplifier la demande de sa classe moyenne, car elle craint de perdre certains marchés d'exportation en Occident. Le gouvernement de l'Inde veut ouvrir son économie aux importations vers l'Occident, mais le reste du monde ne prend pas en compte ses craintes de surexposition à l'instabilité mondiale.
Seule une réponse politique coordonnée, englobant toutes les économies du G-20, peut briser ce cycle vicieux de confiance faible et du ralentissement de la croissance commerciale. Si la Chine pouvait être assurée que ses marchés d'exportation ne faibliront pas, elle pourrait augmenter une demande nationale du consommateur et acheter des marchandises en Occident. De même, si les Etats-Unis étaient assurés de pouvoir vendre en Asie, la confiance des consommateurs occidentaux se renforcerait.
Il y a trois ans, le Fonds Monétaire International a montré qu'en coordonnant l'expansion de la demande de l'Asie et de l'investissement dans l' infrastructure en Occident, nous pouvions mobiliser des fonds privés pour de grands projets de partenariat entre secteur privé et secteur public. La production mondiale augmenterait de 3%, l'emploi augmenterait de 25 à 30 millions d'euros et 100 millions de personnes échapperaient à la pauvreté.
La coordination économique mondiale n'est plus un luxe. La raillerie de Winston Churchill à propos de la politique des années 1930 peut aussi s'appliquer à nous. Les gouvernements, disait alors Churchill, ont été « résolus à ne rien résoudre, ont mis toute leur énergie à se laisser dériver, ont fait tous les efforts pour être malléables, ont été tout-puissants à se montrer impuissants. » En 2013, c'est à cette irrésolution, à cette dérive et à l'impuissance qui en découle que nous devons à notre tour faire face.
Gordon Brown a été Premier Ministre et Ministre des Finances du Royaume-Uni.
Copyright : Project Syndicate, 2013.
www.project-syndicate.org

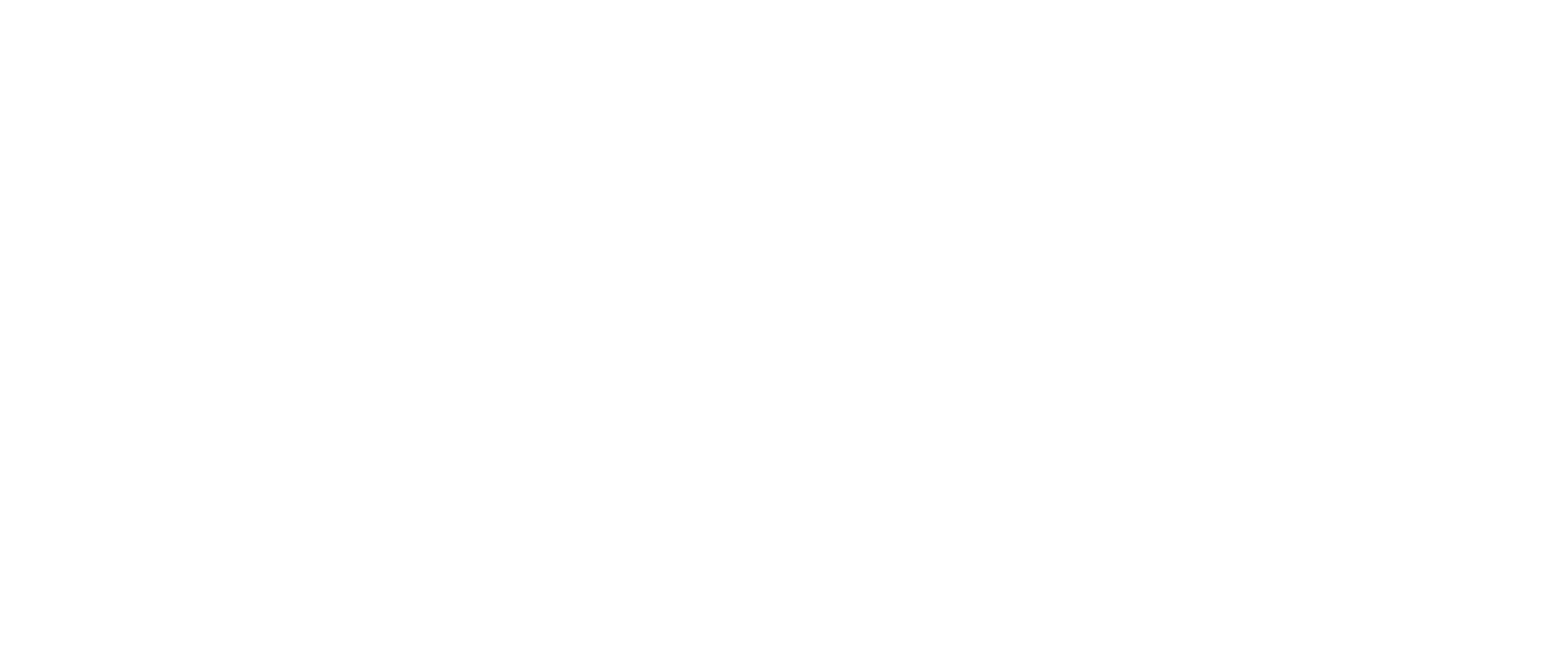
 Retraités : la volte-face des favorisés d'Emmanuel Macron (45)
Retraités : la volte-face des favorisés d'Emmanuel Macron (45)


Sujets les + commentés